vendredi, 14 mars 2008
L'autoroute (extrait 2)
Il termine la suite de clichés par une vue de trois-quarts des grillages qui délimitent l’aire, puis laisse aller son regard sur le paysage extérieur. Il y a, derrière les clôtures, une sorte d’espace neutre, une zone rapportée de graviers entre lesquels une herbe folle et forte a poussé, avec quelques arbustes acharnés à survivre. Des chardons des ronces des orties. Des nids de vipères qu’on pressent sous la caillasse. C’est une zone tampon, désolée, désertée, comme démilitarisée, un périmètre utile de protection et de transition. On n’y compte que de rares excroissances. Des hangars de tôle et de moellons. Des monuments nains de ciment qui doivent avoir une secrète utilité, pour le service des eaux, l’électricité ou le téléphone. Des bouches d’incendie surnageant rouges sur des lits de fougères, ou parmi un entrelacs de ronces grises. Le paysage résiduel de l’activité morte des hommes.
Car ici, à cette place, sous ses pieds, de part et d’autre de son corps, à l’est et à l’ouest, au sud et au nord, sur une zone bien plus large que l’actuel tracé goudronné, des engins jaunes de terrassement ont dû venir, tout saccager comme dans le paysage de son enfance, faire une trouée dans le décor naturel, retourner le sol, arracher les arbres et la végétation, tuer ou chasser les animaux, percer une voie large, avant de remblayer, aplanir, goudronner, bétonner, clôturer un ruban de terre qui est devenu une frontière artificielle infranchissable. Oui, sûrement, comme dans son enfance, d’énormes camions-bennes, très hauts sur roues, ont dû charrier des tonnes de gravier, défonçant les voies communales, les transformant en chemins creux, boueux. C’est un trafic et une industrie dont la mémoire s’est perdue, maintenant que l’autoroute s’impose dans le paysage, encastrée, enracinée comme si elle était de toute éternité. Et pourtant il a bien dû exister un avant, une histoire de l’autoroute, des étapes de sa conception et de sa construction : des projets, des plans, des enquêtes d’utilité publique, des actes administratifs, des arrêtés, des décrets – les autorités après une consultation formelle imposant leur volonté – puis des préparatifs, des repérages, des bornages avant l’irruption des lourds engins motorisés, avant les tranchées, les destructions, les exactions. Des maisons évacuées, éventrées, démolies au bulldozer, à la boule ou à l’explosif ; des champs dévastés, des vergers anéantis, des chemins supprimés, des souvenirs rasés, des mares, des étangs et des biefs comblés, des buttes rasées, des dénivellations annulées, l’horizontal triomphant ; il y a bien eu une chose à la place d’une autre – naturelle et originale – une substitution de beauté par un acte violent, un acte écrit de violence publique.
(extrait d'un roman inédit)
18:39 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, culture, nouvelles et textes brefs
mardi, 03 juillet 2007
Le cagibi (dans le Codex Atlanticus)
 Le texte Le cagibi vient d'être republié dans le numéro 16 du Codex Atlanticus, anthologie annuelle de littérature fantastique. C'est l'occasion de remettre en ligne cette courte nouvelle parue sur ce blog le 22 avril 2006.
Le texte Le cagibi vient d'être republié dans le numéro 16 du Codex Atlanticus, anthologie annuelle de littérature fantastique. C'est l'occasion de remettre en ligne cette courte nouvelle parue sur ce blog le 22 avril 2006.
Les temps étaient durs. L'hiver n'en finissait pas. On mangeait des pommes de terre tous les jours. Le dimanche seulement, la mère ajoutait aux tubercules un morceau de viande bouillie que l'on dévorait des yeux, car il était réservé au père. Les économies avaient fondu à Noël. La misère gagnait comme une gangrène. Il fallait absolument que le père livre son manuscrit à temps à l'éditeur, pour toucher son à-valoir.
Afin qu'il puisse se concentrer sur son travail, et que rien ne vienne distraire son regard ni sa pensée, la mère avait imaginé un moyen radical pour l'isoler du monde et de ses tentations, comme pour l'empêcher de sacrifier à la boisson, qui constituait avec les femmes l'une de ses faiblesses. Elle ne manquait jamais de ressources quand la situation devenait grave et, une fois encore, son idée se révéla judicieuse. Elle aménagea un cagibi sous l'escalier.
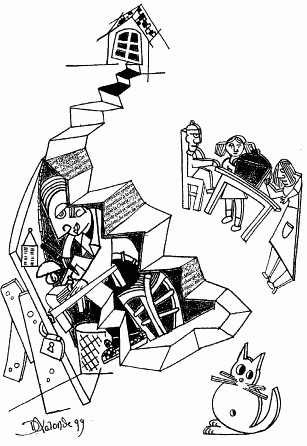 Quelques planches récupérées dans la cave, des panneaux de contreplaqué, des chevrons, des clous, une porte sur deux charnières, le réduit fut vite créé - on le découvrit en rentrant de l'école. Elle y installa une chaise raide en bois, une petite table de fer, et sur celle-ci, tous les accessoires qu'elle jugeait nécessaires à l'activité d'écrivain : une rame de papier blanc, un stylo plume, un encrier rempli d'encre noire, deux crayons, une gomme, un taille-crayon, un dictionnaire. Depuis la cuisine fut tiré un fil électrique, au bout duquel pendait une simple ampoule dépolie. Une petite corbeille à papier compléta l'ensemble. La surface minuscule n'aurait guère pu être meublée davantage. Rien ne filtrait du dehors. Ni bruit, ni air, ni lumière. Extérieur eût été ici un mot déplacé.
Quelques planches récupérées dans la cave, des panneaux de contreplaqué, des chevrons, des clous, une porte sur deux charnières, le réduit fut vite créé - on le découvrit en rentrant de l'école. Elle y installa une chaise raide en bois, une petite table de fer, et sur celle-ci, tous les accessoires qu'elle jugeait nécessaires à l'activité d'écrivain : une rame de papier blanc, un stylo plume, un encrier rempli d'encre noire, deux crayons, une gomme, un taille-crayon, un dictionnaire. Depuis la cuisine fut tiré un fil électrique, au bout duquel pendait une simple ampoule dépolie. Une petite corbeille à papier compléta l'ensemble. La surface minuscule n'aurait guère pu être meublée davantage. Rien ne filtrait du dehors. Ni bruit, ni air, ni lumière. Extérieur eût été ici un mot déplacé.
L'escalier menait aux chambres de l'étage, celles des enfants, des chambres étroites et mansardées, glaciales en hiver, des fournaises l'été. On devait éviter de l'emprunter de jour, lorsque le père écrivait. En cas d'absolue nécessité, si l'on avait oublié là-haut un livre d'école ou son cache-nez, il était permis de monter, avec d'infinies précautions, après avoir chaussé les pantoufles, ou en chaussettes. Le moindre craquement d'une marche, et une gifle tombait. La mère avait la main leste, et lourde.
Chaque matin, après le petit-déjeuner, à huit heures trente, trente-cinq au plus tard, elle se tournait vers le père et, sans prononcer une parole, pointait son index vers le cagibi. A ce signal, il se dirigeait vers ce qui lui tenait lieu de bureau et se contorsionnait pour pénétrer à l'intérieur et s'installer à sa table : la faible hauteur ne lui permettait pas de tenir debout ; assis, sa tête frôlait la marche de l'escalier. Elle fermait la porte du réduit avec un petit cadenas, et conservait la clé dans une poche de son tablier. Le père ne pouvait ensuite sortir que pour satisfaire ses besoins naturels. Il écrivait tout le matin, sans pouvoir changer de position, à la lumière artificielle qui lui chauffait le visage. Défense lui était faite de fumer, pour d'évidentes raisons de sécurité. A midi la mère le libérait pour le déjeuner qu'il prenait en famille, en silence, immobile, le regard fixé sur le fond de l'assiette ; on devait éviter de parler pour ne pas le distraire de sa réflexion. Il prenait un café, parfois deux. Puis il retournait dans le débarras, muni d'une bouteille d'eau du robinet, de quelques gâteaux et fruits secs, jusqu'au début de soirée - à dix-huit heures précises - où la mère venait enlever le cadenas. Il écrivait tout l'après-midi, sous l'ampoule brûlante, en se servant du recto et du verso des feuilles, par économie. On entendait le doux crissement de la plume. On entendait parfois le froissement d'un papier, qu'il jetait dans la corbeille.
Le père travaillait au moins huit heures par jour, dans une solitude absolue. On n'avait pas le droit de lui rendre visite ; même le chat était interdit de séjour. Il ne connaissait ni samedi, ni dimanche, ni jour férié. Chaque soir, après le dîner, il passait au rapport, devant faire à la mère le compte-rendu de l'évolution de son œuvre. Il lui montrait les pages manuscrites, ainsi que son journal intime, qu'il était autorisé à tenir, en parallèle, à condition que cette activité annexe ne lui prenne qu'un temps limité et ne le détourne pas de sa tâche principale. Le livre avançait avec une grande régularité, selon le calendrier prévu et punaisé sur la cloison de planches. On coulait des jours quasi paisibles, dans une maison redevenue calme et silencieuse, après ce difficile automne qui n'avait été qu'une longue saison de crise. Le père ne se plaignait pas, sauf un peu des yeux et de quelques courbatures. La mère semblait contente, et confiante. On se reprenait à espérer. L'hiver touchait à sa fin. On rêvait d'améliorer l'ordinaire des patates.
Extrait du recueil Portraits d'écrivains, Editinter, 2002. La nouvelle était précédemment parue dans la revue La Grappe, accompagnée de cette illustration de Dominique Laronde.
18:20 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : litterature, culture, nouvelles et textes brefs
samedi, 20 janvier 2007
L'adieu près du pont du Change
(Démoli en 1974, ce pont de pierre à Lyon traversait la Saône à hauteur des quais de la Pêcherie et de Bondy.)
Jacques remonte la rive. Il retourne vers la scène finale, au bord de la Saône. Le jour est presque anniversaire, à en juger par la lumière d’un même degré d’or, à la couleur des platanes, au poids des ombres. Ils s’étaient séparés sur le quai de Bondy. La dernière étreinte, les pleurs, les silences pires que les pleurs. Elle partait à l’autre bout du monde, à deux océans de distance. Le quai de Bondy. Jacques est sûr du nom du quai, du côté droit de la rivière, de la Saône en contrebas, mais il ne peut fixer qu’approximativement la place de leurs deux corps. D’après son souvenir, ils s’étaient dit adieu entre le pont La Feuillée et le pont du Change, très près de ce dernier. Depuis, le pont du Change avait été démoli. Le repère le plus visible de la scène n’existait plus. Le temps se plait à briser certaines piles matérielles du souvenir, comme pour le noyer. Mais il ne fait rien que rendre les contours plus estompés ; il ne peut rien contre la pile de la souffrance qui soutient le souvenir tout entier.
Jacques a cherché le pont du Change, il l’a cherché en fermant les yeux, dans les images d’archives de la mémoire. Il revoit un pont de pierre, bas, d’aspect solide. Près du pont La Feuillée mais non parallèle à celui-ci, il s’en écartait vers la rive gauche. Mais il ne parvient plus à situer le lieu précis du drame. La mémoire est incertaine. La ville s’est déplacée. Sa douleur est devenue diffuse dans le brouillard du temps.
Ce court texte est paru dans l’anthologie Ecritures en confluences que vient de réaliser l’UERA (Union des Ecrivains Rhône-Alpes). Cet annuaire 2007, qui présente une cinquantaine de membres de l’association, a été édité chez Jacques André éditeur.
18:10 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : litterature, culture, nouvelles et textes brefs
samedi, 02 septembre 2006
L'autoroute (extrait 1)
La station où il échoue en ce début d’après-midi est vaste et quasi déserte ; un mini-centre commercial la jouxte : autour d’un hall circulaire aux lumières de couleur, quelques boutiques spécialisées sur deux étages. L’une d’entre elles propose des livres et des journaux. Il entre, lit les titres, les quatrièmes de couvertures, feuillette à peine. Ce n’est pas l’une de ces immenses librairies du centre-ville qu’il fréquentait autrefois, ces vastes librairies réparties sur plusieurs étages, PRIVAT-FLAMMARION, FNAC, DECITRE, où il retrouvait les classiques, s’informait des nouveautés. Mais cette boutique étroite mérite cependant l’appellation de librairie, au moins par la variété et le choix des livres de poche exposés, parmi lesquels il reconnaît quelques titres qu’il a tant aimés, comme Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry.
Il ne lit plus de littérature, aucun livre ne traîne dans la voiture, aucun dans son sac de voyage, qui ne contient que des effets utiles. La littérature aussi est un leurre, les mots sont de trop, ils ne sont d’aucun réconfort ni d’aucun secours quand la vie se déchirant s’ouvre sur le vide, quand il ne reste plus qu’à fuir.
En piles sur les tables ou alignés sur leurs tranches dans les rayonnages, les livres ne sont plus que des objets matériels de papier, d’encre et de colle, clos sur eux-mêmes : des boîtes de stockage, des mémoires commodes, infréquentées, des stocks de signes noirs recroquevillés, desséchés, qui ont perdu toute signification ; en les tenant ouverts à une distance suffisante, ou même à bout de bras pour ceux qui sont écrits en plus petits caractères, on ne distingue plus qu’un grisé typographique, une alignée de bandes grises sur le champ de la page blanche.
Lire, écrire. Toute son existence, hors le temps compté du travail salarié, tenait entre ces deux pôles, dans ces deux passions. Il imaginait une vie dans les livres. Leur présence rassurante, dressant des murs, des briques de papier autour de lui, l’isolant de la violence et du désordre du monde. Il voulait en écrire, en éditer ; il a essayé, échoué, essayé encore entre les phases de découragement, des projets de livres qui sont restés à l’état de manuscrits, des fantômes de livres, des esprits errant sans sépulture, loin de tout corps édité. Tout est resté en lui, pour lui, comme un souvenir non partagé. Ce fut longtemps le regret de sa vie, cet échec dans la littérature, mais désormais ça n’a plus de sens, des œuvres même éditées ne lui seraient d’aucun secours, les livres ne sont que des objets sans importance, des petites briques, édifiées sur un gouffre, sur la margelle du gouffre qu’ils prétendent en leur déraison folle contenir, mais c’est le gouffre qui les happe et les digère. Il ne croit plus au pouvoir de la littérature. Les livres sont tombés. Le gouffre l’a rattrapé. Il est dans son œil, aspiré dans son tunnel. Entre ses bandes blanches latérales et ses rails d’acier nu, sur la lame de bitume noir horizontal dont le rayon droit plonge sous l’horizon froid, rejoignant le fond du monde visible. Il n’y a pas d’autre voie, celle-ci suffit à son attente. La voiture s’y engage, lestée de son corps déjà vieux, de sa vie passée, de son impénétrable destin. Il s’en remet à cette course, au seul mouvement, qui ne va jamais que dans un seul sens, vers l’avant, vers la fin qui vient à notre rencontre même si l’on est immobile. Il n’y a pas d’autre sens. Les choses sont irréversibles. Et si par la pensée ou par la magie de l’écriture on croit parfois retourner dans le passé, retrouver l’oasis du souvenir, remonter sa vie, le courant à rebours, ce n’est qu’une illusion, on croit remonter le cours du temps alors qu’on le descend inexorablement, c’est encore un mouvement vers l’avant qui permet à l’esprit d’aller vers l’arrière, c’est toujours par le détour du futur que l’on revient dans le passé, sur la page vierge à venir que l’on consigne les mots d’une vie déjà morte.
(extrait d'un roman en cours d'écriture)
07:10 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture, Nouvelles et textes brefs






