mardi, 06 mars 2007
Joséphin Soulary, un poète lyonnais (3)
Après l'introduction de l'ouvrage, je republie un extrait de la dernière partie "Une oeuvre à redécouvrir".
Si l’oeuvre de Soulary est aujourd’hui oubliée, elle connut dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle un grand succès et une renommée qui ne fut pas que locale. Baudelaire, dont on a toujours salué, parallèlement à son génie poétique, l’intelligence critique, écrivait dans une lettre à Armand Fraisse du 18 février 1860 : « Que M. Soulary soit un grand poète, cela est évident aujourd’hui pour tout le monde, et cela a été évident pour moi dès les premiers vers que j’ai pu lire de lui. »
En introduction à ses Oeuvres poétiques, publiées chez Lemerre, Soulary a reproduit la lettre que lui avait adressée Sainte-Beuve le 8 janvier 1860.
« Monsieur,
« J’ai un remerciement, déjà bien ancien, mais bien sincère, à vous adresser pour le présent qui m’a été fait en votre nom par M. Delaroa du charmant volume de vos admirables sonnets. Je ne serai content que lorsque j’aurai dit tout haut ce que j’en pense.
« J’ai quelque droit sur le sonnet, étant des premiers qui aient tenté de le remettre en honneur vers 1828 ; aussi je ne sais si je mets de l’amour-propre à goûter cette forme étroite et curieuse de la pensée poétique, mais je sais bien (et je crois l’avoir écrit) que j’irais à Rome à pied pour avoir fait quelques sonnets de Pétrarque, et maintenant j’ajoute : - quelques sonnets de Soulary. »
L’un des plus célèbres critiques du temps égalait ainsi Soulary aux plus grands.
*
Certes, toute l’oeuvre du poète n’est pas d’un égal intérêt. La cinquantaine de pages qui composent la partie anthologique de cet ouvrage est extraite de nombreux recueils différents, non seulement parce que nous avons voulu extraire le meilleur de chacun d’eux, mais aussi parce qu’aucun recueil ne peut se lire entièrement avec plaisir par un lecteur contemporain. De très nombreuses pièces apparaissent mièvres et emberlificotées. Il est à ce sujet curieux de constater - mais cela se vérifie chez bien d’autres écrivains, dont de très célèbres - que les poèmes les plus appréciés de son temps sont précisément ceux qui nous touchent le moins aujourd’hui, comme si notre sensibilité s’était transformée, déplacée.
On a vu, dans les précédentes pages, à quel point Soulary avait été éprouvé par l’éreintement implacable auquel se livra Jules Lemaître, l’un des critiques de l’époque qui faisait autorité - éreintement dont notre poète ne se remit jamais.
« Toute chose, en passant par les mains de M. Soulary, se rapetisse, s’amignote, s’amenuise, s’amignardise. »
Après de multiples exemples, parfois mal choisis, destinés à montrer les défauts du poète, Lemaitre achève par des propos plus constructifs et pertinents.
« Soulary est un italien. Ses aïeux littéraires sont les poètes de la Pléiade, les précieux du dix-septième siècle et les concettistes italiens, Guarini ou Le Tasse de l’Aminta. Son sonnet des Rêves ambitieux rappelle par la facture tel sonnet de Joachim du Bellay ; ses Métaux font songer aux Pierres précieuses de Rémy Belleau. Il a, comme Ronsard, un fonds gaulois qui perce çà et là sous la mignardise transalpine. Et par delà ces poètes raffinés il se rattache aux troubadours. Il est dans notre siècle le représentant inattendu du gai savoir et de la poésie menue des cours d’amour. Bref, et pour ne retenir que ses traits essentiels, M. Soulary est un concettiste et un provincial. »
« Il se pourrait bien que M. Soulary fût le roi des poetae minores. Et n’allez pas croire que ce soit peu de chose ! »
Cette fin ne sauve rien, au contraire, et l’on comprend que Soulary en ait été si abattu.
Une large part de l’inspiration de l’auteur ne correspond plus du tout à ce qu’un lecteur de poésie moderne aime à lire aujourd’hui. Soulary se situait même largement à part du mouvement poétique de son temps, n’ayant que très peu subi l’influence de ses contemporains, et se rattachait à une veine italienne, qui venait de la Renaissance ; il avait une vision panthéiste de la Nature et s’inspirait plus d’Horace et d’Anacréon que de Lamartine ! L’oeuvre des poètes de la Pléiade nous est étrangère pour les mêmes raisons.
*
La caractéristique première de Soulary, c’est la perfection de la forme, parfois la virtuosité. Tous les articles du temps consacrés au poète le définissent comme un "ciseleur", un "orfèvre", et on le compare à d’autres grands sculpteurs de vers qui lui sont contemporains : Théophile Gautier, Leconte de Lisle. On ne saurait réduire Soulary à un pur tenant de l’art pour l’art (car son art, nous le verrons, n’était pas vide de sens) mais il a mérité sa réputation de "plus grand sonnettiste du siècle" et non pas, comme le disait méchamment Lemaitre, parce qu’il en a écrit plus que les autres, mais bien parce qu’il a écrit le plus grand nombre de chefs-d’oeuvre du genre.
Dans un poème intitulé Le sonnet, Soulary expose son art poétique et ses « doux combats » avec la Muse, d’abord rétive :
Je n’entrerai pas là, - dit la folle en riant -
Je vais faire éclater cette robe trop juste !
mais la patience du poète, son travail sans cesse recommencé viennent à bout de cette résistance.
Là, serrant un atour, ici le déliant,
J’ai fait passer enfin tête, épaules et buste.
Cependant le résultat, s’il est obtenu à force de travail, n’a rien de laborieux ni de pesant : Soulary construit une poésie simple, gracieuse et attentive au détail concret. L’oeuvre est toujours solidement et parfaitement construite. L’opposition (nous en avons vu un bon exemple avec Les deux cortèges) est le procédé favori du poète, et on le voit tour à tour conjuguer vie et mort, jeunesse et vieillesse... Son sens de la construction confine parfois à la virtuosité ; ainsi dans Le faiseur de cercueils, il effectue un ingénieux montage entre le rêve et la réalité : le menuisier est endormi ; tout-à-coup, ses outils, animés par d’invisibles mains, découpent les planches et assemblent un cercueil.
Un fantôme apparaît :
Ohé ! maître, debout ! Tes morts t’ont fait ta bière !
Le coq chante. Il s’éveille. - Il est au cabaret.
« Debout ! criait sa femme ; ohé ! vieux sac à bière ! »
Baudelaire, dans sa lettre précitée à Armand Fraisse, fait un éloge de Soulary et dresse à son propos une magnifique étude de l’art du sonnet :
« Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense. Tout va bien au sonnet : la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique. Il y a là la beauté du métal et du minéral bien travaillés. Avez-vous observé qu’un morceau du ciel, aperçu par un soupirail, ou entre deux cheminées, deux rochers, ou par une arcade, etc., donnait une idée plus profonde de l’infini que le grand panorama vu du haut d’une montagne ? Quant aux longs poèmes, nous savons ce qu’il en faut penser ; c’est la ressource de ceux qui sont incapables d’en faire de courts.
« Tout ce qui dépasse la longueur de l’attention que l’être humain peut prêter à la forme poétique n’est pas un poème. »
Ces considérations de forme une fois énoncées, on doit continuer de lire aujourd’hui Soulary pour d’autres excellentes raisons - raisons qui ne sont plus les mêmes qu’au dix-neuvième siècle.
Si une large partie de son inspiration nous est aujourd’hui étrangère, il reste heureusement des domaines où les poèmes sont portés par un sentiment qui n’est pas mièvre ni désuet. Il échappe alors à ses défauts, entraîné par une violence d’émotion qui nous touche encore.
Lorsque Soulary s’emporte contre les injustices, contre la bêtise humaine, il le fait avec une rare violence verbale.
Il dénonce les catholiques trop zélés :
« Je hais ces preux portés à faire entrer leur foi
Dans le ventre des gens, comme une arme aiguisée,
Et j’entends qu’on me laisse agir à ma visée,
Dieu seul nous jugeant tous , chacun plaidant pour soi. »
(Je hais ces preux, in Les diables bleus)
les horreurs de la violence et de la guerre :
« Soit qu’il lave un affront, soit qu’il venge un Etat,
Qu’il dresse un guet-apens ou gagne une bataille,
Sous la balle qui troue ou le couteau qui taille,
L’assassinat toujours est un assassinat ! »
(Ira, in L’hydre aux sept têtes)
ou le patriotisme :
« Il n’est qu’un sol, le globe ; il n’est qu’un Dieu, l’Amour,
Confins des nations, croulez ! fuis sans retour,
Dernier culte imposteur, culte de la patrie. »
(Pro Aris et focis, in Ephémères)
Le Soulary le plus émouvant est celui qui dépeint la misère des pauvres gens, leur désespoir, leur dénuement, leur envie de révolte. Sonnet de décembre nous apparaît ainsi comme l’un de ses plus beaux textes, et peut-être son plus pur chef-d’oeuvre. Ajoutons Au dehors, c’est l’hiver, dans lequel mère, enfants, affamés même en rêve / Songent de pains volés et de vins défendus. Et cette magnifique introduction à Nunc Vivendum :
J’ai souvent admiré que la pauvreté fière,
Quand le travail lui manque, et que la faim la mord,
Ne sache pas gaîment se ruer à la mort
Dans un beau suicide en bloc, par rue entière.
Cette attention aux pauvres gens ne se limite pas à la ville de Lyon et aux canuts, la campagne aussi connait ses pauvres. Dans Le vieux pauvre (in Paysages), Soulary dresse un tableau poignant et nous donne en même temps, chez un poète dont on a souvent dénoncé le maniérisme et l’affectation, un exemple d’une belle sobriété verbale :
Pour ne regretter rien je n’ai rien désiré ;
Où la mort me prendra, là je m’endormirai,
Sans vouloir qu’après moi ce bon soleil s’éteigne.
Cette attention chaleureuse pour les pauvres gens s’accompagne d’une dénonciation des puissants. Sans admirations évoque les "assis au large"et les "haut perchés" pour les traiter de "fantoches" et de "fanges"; on ne peut s’empêcher de penser que Soulary, dans son poste de secrétaire particulier du préfet, devait les voir de bien près ! Ephémérides, Justice boiteuse, Gula (tous reproduits dans l’anthologie) contiennent la même dénonciation des grands personnages, depuis le bourgeois "auguste pourceau" jusqu’aux rois, "qui ne daignent signer l’histoire / qu’avec du sang au bout des doigts".
Il y a chez Soulary des accents très libertaires. Son ami Vingtrinier dit qu’il se proclamait libre-penseur et qu’il ne voyait dans le monde que des loups, des ingrats et des méchants.
Dans un tel rôle, et à la même époque, les lyonnais ont un autre poète, Pierre Dupont. On connaît encore quelques-unes de ses chansons, et Charles Baudelaire lui a consacré des articles élogieux, dont deux études reproduites dans L’Art romantique. Dupont reste une figure très vivante à Lyon ; malgré la qualité souvent médiocre de son oeuvre, il n’est pas oublié comme Soulary. Probablement bénéficie-t-il, à travers le temps, d’une image toujours vivace de poète prolétarien.
Bien loin des ingéniosités et des préciosités qui le rapprochent des poètes de la Pléiade, nous rencontrons aussi chez Soulary des poèmes de l’ennui de vivre et d’élans vers l’infini, dont l’inspiration nous fait penser à Baudelaire, le poète du Voyage, qui voyait notre existence comme "une oasis d’horreur dans un désert d’ennui".
Relisons Charles Baudelaire :
O Mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre !
Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons !
(...)
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe ?
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau !
Rapprochons ce texte de Sub sole quid novi ? où nous retrouvons les mêmes thèmes, les mêmes accents :
Aujourd’hui vaut hier. Comme un collier morose
L’Ennui soude le jour qui passe au jour qui suit ;
A la description de l’ennui (le spleen baudelairien), succède le même appel vers l’inconnu :
N’est-il donc nulle part un monde où l’inconnu
Déconcerte l’attente, où, sur le cadran nu,
La Fantaisie en fleur fasse la folle aiguille ?
Mais ce qui apparaît au lecteur moderne comme la plus grande richesse de Soulary, son originalité et sa meilleure veine, reste l’humour. Cette dimension, certes remarquée à son époque, n’avait pas été suffisamment perçue, et on aimait Soulary pour d’autres raisons. Le sonnet le plus célèbre, Les deux cortèges, n’est-il pas de l’anti-humour par excellence ? Du bon sentiment, un peu risible, comme toute naïveté. Si l’on en rit, c’est aux dépens de l’oeuvre, et de l’auteur.
Mais, comme disait Lemaitre, « heureusement pour lui, il a fait beaucoup mieux » ; le meilleur est dans d’autres pièces, dans l’humour précisément. Soulary le revendiquait d’ailleurs : n’a-t-il pas titré l’un de ses ouvrages Sonnets humouristiques ? Et un autre Les rimes ironiques ? Les pièces humoristiques, très nombreuses dans ses recueils, sont autant de chefs-d’oeuvre que l’on admire sans réserve. Ces tableaux parfaits, finement observés, solidement construits, sont servis par la forme sans faute. La construction est souvent la même, une large exposition, descriptive ou narrative - et le dernier vers, en rupture absolue, décoché comme un trait, vient éclairer ou contrecarrer tout le reste du poème.
Certes le fond de cet humour n’est pas gai : présence de la mort, inconstance féminine, amertume... « L’humour chez lui est un composé de fantaisie italienne et de brume lyonnaise qui découle le plus souvent d’une veine d’amertume. » (Marieton) Le meilleur de Soulary est ainsi imprégné de tristesse et de l’idée de la mort :
Pour chaque enfant qui naît ici-bas, Dieu fait naître
Un petit fossoyeur expert en son métier,
Qui creuse incessamment sous les pieds de son maître
La place où l’homme un jour s’abîme tout entier.
(Le fossoyeur, in Pastels et mignardises)
ou encore dans ce credo philosophique :
Le germe est la marche vers l’être,
Et l’être est l’essor vers souffrir ;
Souffrir, c’est commencer de naître,
Et naître, c’est déjà mourir.
(Le gland, in Poésies diverses)
Ces mots sont ceux d’un blessé de la vie. « La dure condition de sa vie, écrit Marieton, a toujours pesé sur son oeuvre ; elle y a marqué d’autant plus profondément qu’il y avançait davantage. » Il ajoute que la lecture du poète, pour riche et intéressante qu’elle soit, n’est pas un exercice de sérénité : « après une fréquentation assidue du poète, on découvre en lui un humoriste, et sous cet humoriste un attristé. »
Les constantes de Soulary, ce " fond de tristesse", produit de son enfance malheureuse et de sa vie grise, le désenchantement, se retrouvent dans ses poèmes, font un excellent et subtil ménage avec l’humour, pour composer une peinture un peu amère de la vie. De la tristesse est né l’humour, sombre et violent parfois, mélancolique en général. Et cette note finale, drôle et désabusée, éclaire le poème, le sauve de l’académisme de sa forme et nous rapproche de son auteur.
Voir également :
18:15 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, poésie, Soulary
dimanche, 04 mars 2007
Joséphin Soulary, un poète lyonnais (2)
Je reproduis ici, après le rappel du texte de quatrième de couverture, l'introduction de cet ouvrage publié en 1997 aux Editions lyonnaises d'art et d'histoire, et aujourd'hui « définitivement indisponible ». J'en publierai bientôt d'autres extraits, ainsi qu'une sélection de poèmes de Soulary, et mettrai en ligne une émission de radio consacrée à ce livre, enregistrée avec Louis Muron sur RCF.
Lorsqu’on évoque la littérature à Lyon, on pense immanquablement à l’époque de la Renaissance, où la ville d’entre Rhône et Saône fut un temps la capitale poétique de la France. Louise Labé, la belle cordière, qui nous a laissé d’impérissables sonnets de passion violente, tenait salon dans sa somptueuse demeure près de l’Hôtel-Dieu. Elle y reçut Marot et les plus grands poètes de son temps. Maurice Scève, auteur de La Délie, fut le Mallarmé de son siècle ; Pernette du Guillet, son inspiratrice, eut le temps, avant sa mort prématurée à l’âge de vingt-cinq ans, de composer des vers douloureux et fragiles, dans un Lyon où les imprimeurs, Jean de Tournes ou Sébastien Gryphe entre autres, attiraient les plus beaux esprits. Le magnifique musée de l’imprimerie (l’un des trois seuls en Europe) que l’on visite dans cette ville témoigne de la formidable vitalité de cette période. En 1532, Rabelais, qui exerçait la médecine à l’Hôtel-Dieu, fit imprimer chez le libraire lyonnais Claude Nourry, dit « Le Prince », son fameux Pantagruel, Les horribles et espoventables faictz et prouesses du très renommé Pantagruel, Roy des Dipsodes, filz du Grand Géant Gargantua, composez nouvellement par maistre Alcofribas Nasier. Deux ans plus tard, il publie dans la même ville La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel.
Cette période faste, d’une densité extraordinaire, a éclipsé tous les autres moments de l’histoire littéraire de Lyon. Ainsi, de la poésie lyonnaise du siècle passé, peu de noms sont aujourd’hui connus du public, si ce n’est celui de Pierre Dupont, resté dans la mémoire populaire pour ses chansons et ses sympathies révolutionnaires. La ville de la soie connut pourtant une vie littéraire active au dix-neuvième siècle. Deux poètes, Victor de Laprade, titulaire d’une chaire à la Faculté des Lettres, et Jean-Jacques Ampère (le fils du physicien), professeur au Collège de France, entrèrent à l’Académie française. Louisa Siéfert, Paul Marieton, les trois frères Tisseur, Barthélémy, Jean et Clair (ce dernier encore localement célèbre pour ses livres d’histoires lyonnaises parus sous le pseudonyme de Nizier du Puitspelu) laissèrent des oeuvres poétiques de grande qualité. Mais la figure dominante de cette période fut sans conteste celle de Joséphin Soulary, apprécié alors par Sainte-Beuve, Baudelaire et Barbey d’Aurevilly, et aujourd’hui assez injustement oublié.
Que reste-t-il en effet de Soulary dans sa ville ? Le nom d’une rue dans le quartier de la Croix-Rousse, un buste de bronze jadis édifié place Saint-Clair et qui se retrouva, suite au percement d’un tunnel routier, sur sa tombe au cimetière de la Croix-Rousse. 1991 a vu le centenaire de sa mort, mais nul n’a songé à le célébrer. Et cependant, cent ans plus tôt, ses funérailles furent officielles et grandioses !
Les oeuvres de Soulary, jamais rééditées depuis le siècle passé, sont malheureusement aujourd’hui introuvables ; il ne reste qu’à les consulter au fonds ancien des bibliothèques. Aucun éditeur local n’a eu l’idée de republier quelques-uns de ses sonnets, alors que Pierre Dupont est fréquemment cité, réédité ou chanté. Seuls, de-ci, de-là, paraissent quelques articles rédigés par des chroniqueurs en mal du passé, qui exhument parmi d’autres personnages trop morts pour se plaindre la figure de Soulary, recopiant les mêmes anecdotes, les mêmes historiettes, et taxant au passage de mineure ou démodée une oeuvre qu’ils n’ont probablement jamais lue !
Cette lecture vaut cependant le détour. Certes, comme chez tout auteur, de nombreuses pièces ont mal vieilli. C’étaient souvent les préférées de son époque, et elles apparaissent les plus datées. Mais au fil des pages, on rencontre de purs chefs-d’oeuvre, qui nous parlent encore et ne méritent pas d’être oubliés.
Cet ouvrage comprend une anthologie qui donne à lire une cinquantaine de pages de Soulary. Sous le classicisme impeccable de la forme, le lecteur aimera à découvrir l’humour si particulier, amer et désabusé, du poète croix-roussien. Une première partie aborde la vie de Soulary, presque entièrement passée à Lyon et dans le Bugey, puis tente d’analyser et de situer son oeuvre parmi celles de son siècle.
Que ce livre puisse remettre en circulation une oeuvre ensevelie sous le temps, et rendre à la mémoire un auteur important du patrimoine culturel lyonnais - telle aura été mon ambition, modeste mais têtue.
Voir aussi :
10:05 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, poésie
vendredi, 10 mars 2006
Charles Fontaine (1514 - après 1588)
Je remets en ligne ce billet paru le 14 mai 2005, m’étant aperçu, grâce à ce site érudit, que la version retenue du beau poème de Charles Fontaine était fautive. Il convient de préciser qu’à l’époque à laquelle j’avais conçu mon anthologie de poètes lyonnais, voici bien plus de vingt ans, Internet n’existait pas ni Gallica qui donne l’accès à de très anciens textes numérisés, jadis quasi introuvables. Je crois me rappeler avoir déniché ce poème dans une anthologie de poésie composée par André Gide.
Je rétablis donc le poème dans sa version originelle, comme dans son intégrité de 7 strophes.
*
Né à Paris le 13 juillet 1514, Charles Fontaine s’attacha à Renée de France (fille cadette de Louis XII et d'Anne de Bretagne) et séjourna quelques années auprès d’elle à Ferrare. Il regagna ensuite la France pour se fixer à Lyon où il passa la plus grande partie de sa vie.
Chant sur la naissance de Jean, second fils de l'auteur
Mon petit fils qui n’as encor rien vu,
A ce matin ton père te salue :
Viens t’en, viens voir ce monde bien pourvu
D’honneurs et biens, qui sont de grand value :
Viens voir la paix en France descendue :
Viens voir François, notre Roi, et le tien,
Qui a la France ornée, et défendue :
Viens voir le monde où y a tant de bien.
Viens voir le monde, où y a tant de maux,
Viens voir ton père en procès, et en peine :
Viens voir ta mère en douleurs, et travaux,
Plus grands que quand elle était de toi pleine :
Viens voir ta mère, à qui n’as laissé veine
En bon repos : viens voir ton père aussi,
Qui a passé sa jeunesse soudaine,
Et à trente ans est en peine et souci.
Jean, petit Jean, viens voir ce tant beau monde,
Ce ciel d’azur, ces étoiles luisantes,
Ce Soleil d’or, cette grand terre ronde,
Cette ample mer, ces rivières bruyantes,
Ce bel air vague, et ces nues courantes,
Ces beaux oiseaux qui chantent à plaisir,
Ces poissons frais, et ces bêtes paissantes :
Viens voir le tout à souhait, et désir.
Viens voir le tout sans désir, et souhait,
Viens voir le monde en divers troublements,
Viens voir le ciel, qui jà la terre hait,
Viens voir combat entre les éléments,
Viens voir l’air plein de rudes soufflements,
De dure grêle et d’horribles tonnerres :
Viens voir la terre en peine et tremblements :
Viens voir la mer noyant villes, et terres.
Enfant petit, petit et bel enfant,
Mâle bien fait, chef-d’œuvre de ton père,
Enfant petit en beauté triomphant,
La grand liesse, et joye de ta mère,
Le ris, l’ébat de ma jeune commère,
Et de ton père aussi certainement
Le grand espoir, et l’attente prospère,
Tu sois venu au monde heureusement.
Petit enfant peux-tu le bienvenu
Etre sur terre, où tu n’apportes rien ?
Mais où tu viens comme un petit ver nu ?
Tu n’as ni drap, ni linge qu soit tien,
Or, ni argent, n’aucun bien terrien :
A père et mère apportes seulement
Peine et souci : et voilà tout ton bien.
Petit enfant tu viens bien pauvrement.
De ton honneur ne veuil plus être chiche,
Petit enfant de grand bien jouissant,
Tu viens au monde aussi grand, aussi riche
Comme le Roi, et aussi florissant.
Ton Trésorier c’est le Dieu tout puissant,
Grâce divine est ta mère nourrice :
Ton héritage est le ciel splendissant :
Tes serviteurs sont les Anges sans vice.
in S'ensuivent les ruisseaux de Fontaine, Lyon, chez Thibauld Payan, 1555
08:50 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (1)
mercredi, 01 février 2006
Louis Garon (17e siècle)
De cet écrivain fécond, on trouve encore au fonds ancien des bibliothèques municipales quelques œuvres aux titres savoureux (Colloque des trois suppôts du Seigneur de la Coquille, 1610 ; Le chasse ennuy ou l’honnête entretien des bonnes compagnies, 1628…)
Les Stances sur l’ancienne confrérie du Saint-Esprit, ci-dessous reproduites, ont été rééditées au 19e siècle dans la Revue du Lyonnais (1837, tome 5).
*
Les « Stances sur l’ancienne confrérie du Saint-Esprit » présentent un double intérêt, poétique et historique : elles relatent un soulèvement populaire qui survint à Lyon, en 1403, durant les fêtes de Pentecôte. Le petit peuple de la ville se révolta contre les bourgeois et prétendit gouverner à leur place. La sédition fut vite et sévèrement réprimée. L’année suivante, à Pentecôte, on institua la fête du Cheval fol qui rappelait en le tournant en dérision le soulèvement populaire ; Louis Garon fut témoin de l’une des dernières célébrations de cette fête.
Sous Charles sixième on vit la populace
De Lyon mutinée et remplie d’audace,
Voulant fouler aux pieds tous les supérieurs,
Disant il ne faut plus qu’ores on nous commande ;
Nous avons notre tour, sus, sus, qu’on se débande,
Mettons dessous nos pieds et rois et gouverneurs.
Deux cents ans sont passés que la tourbe mutine
Renversant l’équité, la conduite divine,
Voulut le consulat à son tour gouverner ;
Et voulant saccager, brûler, mettre au pillage
Les plus riches bourgeois, par un conseil volage,
On la vit comme folle en armes s’élever.
Justice est sans respects où règne violence.
On ne peut tout soudain abattre l’insolence
D’un peuple mutiné, débandé de raison.
Il faut que peu à peu il passe sa furie,
Et comme ja vaincu par sa même folie,
On le trouve à loisir dans sa propre maison.
Pour fuir la fureur de cette hydre cruelle,
Les tours et les clochers servent de citadelle
Aux plus riches bourgeois ja de frayeurs tremblants.
Même l’abbé d’Ainay, en ces célèbres fêtes,
Se cantonne en ses tours, et à coups d’arbalètes,
Abat de ces mutins les assauts violents.
Encor ne parlait-on de l’horrible furie
Du canon, de la poudre, ennemis de la vie.
Le salpêtre subtil ne montrait ses efforts
Aux furieux combats, aux assauts, aux alarmes.
L’arbalète, l’épieu, l’épée étaient les armes
Qui mettaient les humains au royaume des morts.
(…)
Comme la populace est soudain animée,
Elle est en un moment abattue et domptée,
Connaissant à loisir son vice et son erreur ;
Tout ainsi qu’un torrent débordé par la pluie,
Ruine tout un pays en sa propre furie,
Tout de même est un peuple étant en sa fureur.
Ce feu du tout éteint, et clamé cet orage,
La tourbe ayant changé en douceur cette rage,
Comme un loup prisonnier, on la voit filer doux.
Le prévôt de l’hôtel mandé du roi arrive
Qui fait bien étonner cette race craintive,
Ayant tout à loisir apaisé son courroux.
Comme juge équitable envers telles canailles,
Il en juge plusieurs à passer aux pendailles ;
Le reste se sauva çà et là en exil.
Pour déchasser le mal et garder la police,
Il faut des vicieux faire bonne justice,
Surtout des boutefeux qui donnent le fusil.
Le peuple bien souvent se rend par trop facile
A croire un fol conseil, et d’un cœur malhabile,
Il cherche au désespoir son plus certain appui,
Et savourant les fruits de sa propre folie,
Souvent il s’y ruine ou il y perd la vie.
Le fol profite au sage et n’apprend rien de lui.
Pour suivre donc le cours de mes emprises belles,
L’abbé d’Ainay dévot rend grâces immortelles
A Dieu, accompagné du peuple qui le suit,
Et rendant de tel bien la mémoire éternelle,
Les gardes, le quartier consacrent la chapelle
Toute proche du pont, dite du Saint-Esprit.
Lors on institua la sainte confrérie
De l’heureux Paraclet, esprit qui vivifie
Les chrétiens réchauffés de la dévotion,
Confrérie séjour de joie et de liesse
Qui, d’un feu tout divin, comble notre allégresse,
Brûlant au ciel tout l’heur de notre affection.
Quant à ce cheval fol qui sautelle, qui danse,
Qui, au son du hautbois, cabriole et cadence,
C’est en dérision de ces fols mutinés
Qui, comme chevaux fols, couraient parmi la ville,
Voulant, à qui mieux mieux paraîtrait plus habile,
S’enrichir des trésors qu’ils auraient butinés.
Jadis les rois français portaient grand chevelure,
D’une riche couronne ils avaient la parure,
L’habit bleu aux lys d’or, et l’épée à la main.
Ces fols croyant jouir d’autorité égale,
Ont en dérision la parure royale,
Pour montrer à jamais leur malheureux dessein.
L’ancien souvenir d’une telle victoire
Se grave sur le front de l’heureuse mémoire
Pour tenir en raison tous les séditieux ;
Comme nouveaux Titans, comme enfants de la Terre,
Ils veulent au Très-Haut faire mortelle guerre,
Mais ils goûtent enfin un plaisir odieux.
Les rois sont fils du Ciel, Dieu garde leur couronne.
Un ange gardien toujours les environne.
Comme les oints sacrés du Seigneur des seigneurs,
En vain contre eux s’élève une troupe mutine ;
Puisqu’ils ont avec eux l’assistance divine,
Ils jouissent heureux des célestes faveurs.
18:16 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (1)
samedi, 15 octobre 2005
Jeanne Gaillarde
La postérité littéraire peut emprunter des voies détournées… ainsi le nom de Jeanne Gaillarde a traversé les siècles dans le sillage de Clément Marot. Lorsque ce dernier vint à Lyon, vers 1524, il noua amitié avec Jeanne Gaillarde, poète de bonne renommée dans la société lettrée de la ville. Ses poésies se sont malheureusement égarées dès le seizième siècle, à l’exception d’une courte pièce – une réponse à un rondeau que lui adressa Marot – qui fut toujours reproduite dans les œuvres du célèbre rhétoriqueur, assurant ainsi sa conservation.
V.L. Saulnier attribue par ailleurs à Jeanne Gaillarde six rondeaux qu’il nous donne à lire dans son article « Documents nouveaux sur Jeanne Gaillarde et ses amis : Clément Marot, Jacques Colin, Germain Colin » (in Bulletin de la Société historique de Lyon, tome 18, 1952)
*
De Clément Marot :
A JEANNE GAILLARDE LYONNAISE
D’avoir le prix en science et doctrine
Bien mérita de Pisan la Christine
Durant ses jours ; mais ta plume dorée
D’elle serait à présent adorée,
S’elle vivait par volonté divine.
Car tout ainsi que le feu l’or affine,
Le temps a fait notre langue plus fine,
De qui tu as l’éloquence assurée
D’avoir le prix.
Donques ma main, rends-toi humble et bénigne,
En donnant lieu à la main féminine :
N’écris plus rien en rythme mesuré,
Fors que tu es une main bienheurée
D’avoir touché celle qui est tant digne
D’avoir le prix.
REPONSE DE LADITE GAILLARDE
De m’acquitter je me trouve surprise
D’un faible esprit, car à toi n’ai savoir
Correspondant : tu le peux bien savoir,
Vu qu’en cet art plus qu’autre l’on te prise.
Si fusse autant éloquente, et apprise,
Comme tu dis, je ferais mon devoir
De m’acquitter.
Si veux prier la grâce en toi comprise,
Et les vertus, qui tant te font valoir,
De prendre en gré l’affectueux vouloir
Dont ignorance a rompu l’entreprise
De m’acquitter.
23:55 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent
lundi, 15 août 2005
Pernette du Guillet (1520 – 1545)
Au début du 16e siècle, Lyon est un important centre intellectuel et littéraire, et l’école poétique lyonnaise, regroupant notamment Maurice Scève et Louise Labé, constitue un moment essentiel de l'histoire littéraire entre Marot et la Pléiade.
Née à Lyon en 1520, Pernette du Guillet reçoit une éducation soignée, parlant l’italien et l’espagnol. A seize ans, elle est l’élève de Maurice Scève et l’inspiratrice de son recueil Délie, objet de plus haute vertu. Mais l’amour entre eux se révèle impossible, Pernette étant promise à M. du Guillet qu’elle épouse en 1538.
Elle meurt à 25 ans, le 7 juillet 1545, emportée par une épidémie de peste. A la demande de son mari, l’érudit Antoine du Moulin examine les feuillets où elle consignait ses poésies et les fait éditer dans leur confusion originelle.
Rymes de gentille et vertueuse dame Pernette du Guillet, lyonnaise, Lyon, Jean de Tournes, 1545
*
Pour contenter celui qui me tourmente,
Chercher ne veux remède à mon tourment :
Car en mon mal voyant qu’il se contente,
Contente suis de son contentement.
*
Jà n’est besoin que plus je me soucie
Si le jour faut, ou que vienne la nuit,
Nuit hivernale et sans lune obscurcie ;
Car tout cela, certes, rien ne me nuit,
Puisque mon Jour par clarté adoucie
M’éclaire toute, et tant, qu’à la minuit
En mon esprit me fait apercevoir
Ce que mes yeux ne surent oncques voir.
*
La nuit était pour moi si très-obscure
Que Terre, et Ciel elle m’obscurcissait,
Tant qu’à Midi de discerner figure
N’avais pouvoir – qui fort me marrissait :
Mais quand je vis que l’aube apparaissait
En couleurs mille et diverse, et sereine,
Je me trouvai de liesse si pleine –
Voyant déjà la clarté à la ronde –
Que commençai louer à voix hautaine
Celui qui fait pour moi ce Jour au Monde.
*
Prenez le cas que, comme je suis vôtre -
Et être veux - vous soyez tout à moi :
Certainement par ce commun bien nôtre
Vous me devriez tel droit que je vous dois.
Et si Amour voulait rompre sa Loi,
Il ne pourrait l'un de nous dispenser,
S'il ne voulait contrevenir à soi,
Et vous, et moi, et les Dieux offenser.
*
01:20 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent
vendredi, 10 juin 2005
Joséphin Soulary (1815 - 1891)
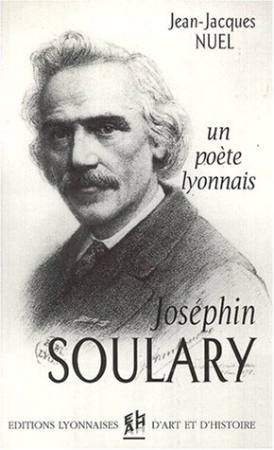 Joséphin Soulary a été l’un des poètes reconnus et célèbres du 19e siècle. Baudelaire et Sainte-Beuve l’appréciaient et lui ont consacré des études élogieuses. Né à Lyon, Croix-Roussien et contemporain de Pierre Dupont, il est aujourd’hui injustement oublié.
Joséphin Soulary a été l’un des poètes reconnus et célèbres du 19e siècle. Baudelaire et Sainte-Beuve l’appréciaient et lui ont consacré des études élogieuses. Né à Lyon, Croix-Roussien et contemporain de Pierre Dupont, il est aujourd’hui injustement oublié.
Après des années de jeunesse difficiles, Joséphin Soulary devient en 1840 chef de cabinet du préfet Jaÿr, puis chef de division à la préfecture du Rhône. Il termine sa carrière comme conservateur de la Bibliothèque municipale. N’ayant jamais cessé d’écrire, il connaît sa consécration littéraire en 1859 avec les Sonnets Humouristiques, parus chez Perrin. Auteur d’une œuvre importante, Soulary s’est surtout illustré dans l’art du sonnet, dans lequel il était passé maître. On l’a comparé en son temps à Théophile Gautier et Leconte de Lisle. Au-delà du classicisme impeccable de la forme, de nombreux poèmes de cet auteur séduisent encore le lecteur contemporain par leur originalité, leur force d’émotion et un humour, parfois mélancolique et désenchanté, qui les rendent très actuels.
Ses Oeuvres poétiques ont été rassemblées en 3 volumes chez Lemerre (1887).
*
SONNET DE DECEMBRE
L’hiver est là. L’oiseau meurt de faim; l’homme gèle.
Passe pour l’homme encor ; mais l’oiseau, c’est pitié !
Dans un bouquin rongé des rats plus qu’à moitié
j’ai lu qu’il paie aussi la faute originelle.
La bise a mangé l’air, durci le sol, lié
Les ruisseaux. - Temps propice aux heureux ! La flanelle
Les couvre ; au coin du feu le festin les appelle.
Mais les autres ?.. Sans doute ils auront mal prié !
Le soleil disparaît sous la brume glacée ;
C’est l’acteur des beaux jours qui, la toile baissée,
Prépare sa rentrée au prochain renouveau ;
et, tandis qu’on grelotte, il vient, par intervalle,
regarder plaisamment, l’oeil au trou du rideau,
La grimace que fait son public dans la salle.
in La chasse aux mouches d’or
*
UNE GRANDE DOULEUR
Comme il vient de porter sa pauvre femme en terre,
Et qu’on est d’humeur noire un jour d’enterrement,
Il entre au cabaret ; car la tristesse altère,
Et les morts sont bien morts ! - c’est là son sentiment.
Il se prouve en buvant que la vie est sévère ;
Et, vu que tout bonheur ne dure qu’un moment,
Il regarde finir mélancoliquement
Le tabac dans sa pipe et le vin dans son verre.
Deux voisins ses amis sont là-bas chuchotant
Qu’il ne survivra pas à la défunte, en tant
Qu’elle était au travail aussi brave que quatre.
Et lui songe, les yeux d’une larme rougis,
Qu’il va rentrer ce soir, ivre-mort, au logis,
Bien chagrin - de n’y plus trouver personne à battre.
in Les diables bleus
*
SUB SOLE QUID NOVI ?
Sous mes yeux vainement tout se métamorphose,
L’enfance en la vieillesse, et le jour en la nuit ;
Dans ce travail muet qui crée et qui détruit,
C’est toujours même loi, même effet, même cause.
Aujourd’hui vaut hier. Comme un collier morose
L’Ennui soude le jour qui passe au jour qui suit ;
Et l’immobile Dieu gouverne ce circuit,
Où l’acteur machinal quitte et prend même pose.
Sur le rayon de l’heure et dans le bruit des jours,
La vie a beau tourner, rien ne change son cours ;
Le pendule uniforme au front du Temps oscille.
N’est-il donc nulle part un monde où l’inconnu
Déconcerte l’attente, où, sur le cadran nu,
La Fantaisie en fleur fasse la folle aiguille ?
in Papillons noirs
Voir aussi :
Joséphin Soulary (2) : introduction de l'ouvrage
Joséphin Soulary (3) : une oeuvre à redécouvrir
Joséphin Soulary (4) : petite anthologie
06:10 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent






