mardi, 17 janvier 2006
Le nom (extrait 2)
Un nouvel article critique sur le roman Le nom, dans un numéro récent de la revue Hauteurs et sous la signature de Gilbert Millet, m’incite à mettre en ligne un deuxième extrait de ce bref récit, publié l’an dernier aux éditions A contrario.
Le passage se situe après que le personnage central du roman, un écrivain, a trouvé son inspiration définitive dans l’écriture de son propre nom, recommencé sans cesse.
*
Pendant près de deux heures il ne trouva rien d’autre à écrire que le nom. Il ne trouva rien de mieux. Sans précipitation mais sans hésitation, il le traçait avec un plaisir égal et constant, renouvelé, un plaisir sans mélange, sans arrière-pensée, sans cette ombre perpétuelle du doute et de l’insatisfaction qui plombe le travail de l’écrivain. Un plaisir qu’il n’avait que très rarement éprouvé jusqu’alors, sauf - le souvenir lui revint d’un coup - en écrivant un nombre dans le corps d’un texte.
L’écriture des nombres avait toujours été un plaisir intense, une authentique jouissance, un moment isolé et trop bref de délice au cœur des affres de la création littéraire. Il aurait aimé le prolonger. Si cela avait été possible (et de nature à constituer une œuvre), il aurait voulu n’écrire que des nombres, des suites immenses et recommencées de nombres en recopiant d’interminables additions, la litanie des tables de multiplication, des logarithmes, des fractions aux numérateurs et aux dénominateurs gigantesques, ou une division poussée très loin, sept chiffres après la virgule. Depuis l’enfance les nombres le fascinaient, et singulièrement les nombres écrits en toutes lettres - qu’il aimait à voir se développer sur une ou plusieurs lignes. La différence de traitement d’un nombre, entre le raccourci du chiffre et la longue écriture littérale, l’écart entre ses deux versions, se révélait vertigineuse et le ravissait toujours. Ainsi, pour donner l’exemple d’une date, passer de 27.11.1997 (en chiffres) à vingt-sept novembre mille neuf cent quatre-vingt dix sept (en lettres), passer de huit chiffres à quarante-huit lettres, sans compter les espaces et les traits d’union lesquels, si on les incluait dans le calcul, porteraient la date écrite à cinquante-sept signes, contre dix seulement pour la date chiffrée en ajoutant les deux points intermédiaires, soit un rapport de un à cinq virgule sept entre les deux versions de la même date, une telle transformation donnait l’impression, pour prendre une image empruntée au vocabulaire informatique, de passer d’un fichier compressé à un fichier décompressé.
Le plaisir de l’auteur avait une autre cause que le pur déroulé des lettres. Les nombres étaient parfaits et définitifs. (Il est plus facile de trouver le nombre juste que le mot juste, il suffit de savoir compter). Une fois choisis et retenus, ils n’étaient plus susceptibles d’amélioration. On n’allait pas revenir sur eux, comme on revient sans cesse sur le style, cent fois sur le métier remettant l’ouvrage de la phrase, dans un sentiment de souffrance, de découragement et d’échec. Il pouvait donc écrire les nombres lentement, mais sûrement, pour la première et dernière fois, dans la certitude tranquille et installée qu’il n’aurait plus à les corriger. Il en avait fini avec eux. Dans sa littérature en perpétuel chantier, mouvante comme la mer recommencée, les nombres représentaient des îlots de perfection, des barrières de récifs, des bribes de texte achevé. Dans les moments de doute il se raccrochait à eux.
De la même façon, le nom, ce mot inventé la veille et repris déjà plusieurs centaines de fois dans son cahier, lui paraissait définitif. Lui non plus n’était pas susceptible d’amélioration. Des siècles avaient été nécessaires pour parvenir à sa forme définitive et le garder jusqu’à nos jours, une chaîne ininterrompue, des générations et des générations, des vies et des morts innombrables d’ancêtres qui s’étaient transmis précieusement le nom, comme un coureur de relais qui passe le témoin, qui avaient su le conserver, le véhiculer, préserver ce trésor immatériel qui excédait leurs courtes et fragiles existences. Le nom était l’œuvre du temps. Le fruit d’un travail collectif, d’une sédimentation lente de la langue, après les glissements graphiques et phonétiques du Moyen Age, un mot enfin stabilisé, statufié. Tout le reste n’était que littérature : approximation, bavardage. Hésitation, mode, confusion. Insatisfaction. Le nom était la solution. Quelle œuvre plus achevée pourrait-il écrire que l’énoncé de ce nom ? Pourquoi ne pas réduire son œuvre à ce nom ? (le mot réduire n’ayant dans l’esprit de l’auteur rien de réducteur). A sa profération, sa scansion, sa prolifération. Maintenant qu’il en avait fait un nom commun, par l’oubli approprié de sa majuscule, il pouvait le reproduire, et même en nombre, et même à l’infini, car les choses communes sont infinies. Comme les fleurs, les feuilles, les fruits. L’herbe. Les insectes. Les poissons dans les eaux. Les oiseaux dans le ciel. Les bêtes sauvages et les reptiles. Les arbres dans les forêts. Comme les grains de sable et les étoiles. Son œuvre ne connaîtrait pas de limite. Et sa gloire non plus.
19:56 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (1)
dimanche, 20 novembre 2005
LE SENS et autres textes
LE GUET
Le ciel était constellé d'escales. L'une d'entre elles seulement recélait un piège, réputé mortel ; aussi le héros sans cesse devait se tenir sur ses gardes, au plus fort de la rencontre, de l'amour et de l'émerveillement.
BALANCE
Si l'on en croit les statistiques, on peut avancer que depuis l'irruption sur la terre de l'homme, ce mammifère intelligent, le nombre des naissances est à peu près équivalent à celui des décès parmi sa race. A noter toutefois un très léger excédent des naissances, dû probablement à leur antériorité sur les décès ; il aurait fallu en effet que l'agent recenseur comptabilise par anticipation les morts à intervenir pour ne pas fausser la balance. Mais le lecteur aura rectifié de lui-même.
LE PIEGE
Parvenu au milieu du désert, le fugitif s'aperçut qu'il n'avait plus assez de vivres et d'eau pour continuer sa route. Désormais, qu'il revienne sur ses pas ou poursuive devant lui, en quelque sens qu'il se tourne, il n'irait nulle part.
LE NOMBRE
Lors de la visite de la bibliothèque régionale, on lui montra les silos à livres, noires tours aveugles dans le ciel ; il pensa que ses trois ouvrages, qu'il avait mis quinze ans à écrire, reposaient là, étouffés par des millions d'oeuvres, et se sentit soudain plus insignifiant que la blatte qui courait sur le sol, entre la pelle et le balai.
UN CAS
En ce mois de novembre 1957, les clients du docteur L., psychanalyste de son état, connurent des séances particulièrement agitées. Le vieux docteur, devenu prostatique, devait se lever tous les quarts d'heure pour satisfaire un impérieux besoin d'uriner, et interrompait chaque fois le discours de ses patients. Il convient d'ajouter qu'une autre gêne, liée à la configuration des lieux, rendait la situation des malades encore plus inconfortable. Contrairement à ses confrères, l'analyste était très pauvre, n'ayant jamais voulu pratiquer les tarifs prohibitifs de la profession et oubliant parfois de réclamer son dû aux moins fortunés ; aussi n'occupait-il qu'un modeste logis. Son cabinet était une pièce minuscule, avec une seule fenêtre sous laquelle il avait installé son fauteuil, du côté opposé à la porte ; le divan, au milieu, s'étendait sur toute la largeur du réduit, sans qu'il reste d'espace pour le contourner. Cette singulière disposition expliquait une pratique du docteur, tout-à-fait unique parmi les analystes : en début de séance, il précédait le client dans la pièce, puis escaladait tant bien que mal le divan pour gagner son fauteuil. Le lecteur comprend mieux désormais combien cette hypertrophie de la prostate - maladie courante chez les hommes âgés - perturba les cures des clients, ceux-ci devant fréquemment se lever pour permettre au docteur d'accomplir, aller ou retour, ses laborieux franchissements.
LE SENS
On se regarde vieillir comme on suit des yeux le cours d'une rivière ; on se regarde écrire, la main avance vers la fin.
(Ces petits textes, écrits voici une vingtaine d'années, ont été publiés en revues et magazines.)
11:30 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 21 juin 2005
Le nom (extrait)
 Le nom est paru en février et a suivi son petit bonhomme de chemin de l'hiver à l'été, avec un relatif succès critique (je renvoie vers cette page dossier critique de mon site perso, où sont reproduits les articles obtenus dans la presse et sur internet). J'espère qu'il continuera à faire entendre sa petite voix, malgré la rotation rapide des livres qui le chassera bientôt des rares librairies où on peut le trouver, malgré la déferlante lame de fond de la prochaine rentrée littéraire ; mais pour moi, il est temps de m'atteler à de nouveaux projets.
Le nom est paru en février et a suivi son petit bonhomme de chemin de l'hiver à l'été, avec un relatif succès critique (je renvoie vers cette page dossier critique de mon site perso, où sont reproduits les articles obtenus dans la presse et sur internet). J'espère qu'il continuera à faire entendre sa petite voix, malgré la rotation rapide des livres qui le chassera bientôt des rares librairies où on peut le trouver, malgré la déferlante lame de fond de la prochaine rentrée littéraire ; mais pour moi, il est temps de m'atteler à de nouveaux projets.
Avec l'aimable autorisation des éditions A contrario, je livre un extrait de ce roman :
Depuis quelques jours (et après la douce euphorie du début de l’installation), l’écriture devenait de plus en plus difficile. Elle se réduisait. Elle se raréfiait. L’absence de réponse des éditeurs à ses envois de manuscrits ne l’encourageait guère ; il avait parfois des accès de dépression, de quasi désespoir, en ouvrant chaque matin sa boîte aux lettres sur le vide. Des accès de révolte aussi, qu’il ne savait contre qui diriger. Sa solitude ne se résolvait pas par l’écriture ; au contraire, il lui semblait qu’elle se refermait chaque jour davantage.
Prenant son paquet de Gitanes bleues sans filtre, il saisit une cigarette, qu’il contempla en la faisant tourner lentement entre ses doigts ; sur toute la longueur de l’étroit cylindre il traça avec son stylo plume un trait noir, perpendiculaire à la marque GITANE imprimée en petites capitales grises qu’il traversa entre le T et le A ; l’encre bava, absorbée par le papier léger et poreux, par le lit de tabac. Il alluma la cigarette avec son briquet Zippo, puis ne tira que deux ou trois bouffées rejetées aussitôt dans l’air, la laissant se consumer jusqu’au bout sur le bord du cendrier de verre où elle laissa une tache brune ; progressivement il vit disparaître la ligne noire, et la marque imprimée, rongées par l’avancée de la braise. Il ne subsista que de légères cendres grises, à peine chaudes, qu’il effleura du bout de ses doigts avant de reprendre le stylo.
Alors, les yeux perdus dans le blanc de la page et dans la fumée résiduelle, à court d’idées, à court de mots, d’une façon presque machinale, il écrivit son nom.
Lentement (ou comme au ralenti), en lettres noires, larges et liées, légèrement penchées à droite, il traça son nom sur le cahier, d’un geste familier et irréfléchi comme le réflexe d’une signature, comme il l’avait tracé sur la buée de la vitre, mais d’une façon plus fine et définitive, avec de l’encre après l’avoir esquissé avec de l’eau, avec une écriture appliquée après l’avoir grossièrement dessiné avec le doigt. Les quatre lettres du nom, d’un seul mouvement de la main droite. Au milieu d’une ligne. Comme en suspension. Comme en équilibre. Au milieu de la première ligne de la page blanche du cahier.
Le geste achevé, il posa le stylo, resta immobile, et observa sa création.
Il avait écrit son nom comme ça, par une sorte d’automatisme, une mémoire de la main. Il ne l’avait pas fait exprès. Ses yeux avaient vu sa main saisir le stylo et former le mot à l’encre noire ; il avait assisté à une création soudaine, ex nihilo, rappelant celle d’un artiste plasticien qui jette une tache de couleur ou une ligne sur la toile après une longue et intense méditation, ou après avoir fait le vide en lui.
Il regardait l’apparition. La concrétion d’encre. Il considérait la figure du mot, en examinait la ligne et le relief, la silhouette, la robe, la forme extérieure. Comme un peintre qui prend de la distance avec son tableau pour mieux en apprécier les proportions ou en discerner les défauts, il se leva et recula de quelques pas, jusqu’à ne plus voir sur le cahier qu’une forme incertaine et sombre. Le mot n’était plus lisible (à l’instar des plus petites lettres du tableau dans le cabinet de l’oculiste) ; l’auteur ne le déchiffrait plus que par mémoire. A travers le vague tremblé des signes noirs, il en reconstituait le sens. Mais il voyait très bien malgré la distance la quatrième et dernière lettre, sur la droite, dépasser les autres de sa hauteur triple, comme dans un paysage lointain le clocher d’une église domine les maisons environnantes.
Il revint à sa table de travail et saisit le stylo, décidé à reprendre son ouvrage. L’inspiration n’était pas revenue pour autant, après l’écriture de ce nom qu’il considérait comme un accident, une fantaisie. Une récréation. Il ne trouva pas de suite. Sa tête était vide, occupée par ce vide souverain qui l’avait envahie depuis le matin. Il n’y avait pas d’autre suite à ce nom isolé que ce blanc sur la gauche, ce blanc sur la droite, ce blanc au-dessus et au-dessous, ce blanc de toutes parts, cette absence de texte avant et cette absence de texte après, ce silence de la page, aucune autre suite à ce nom qui semblait se suffire à lui-même.
Ce corps étranger, cet intrus (qu’il aurait pu rayer d’un trait de plume, noyer sous l’encre, renvoyer au néant pour revenir à son œuvre) l’intrigua à la fin ; et il l’examina de plus près. C’est alors, revenu du moment d’ivresse et de cécité de la création, qu’il le vit concrètement et que les détails lui apparurent dans toute leur objectivité.
Il avait écrit le nom au milieu de la première ligne, sans majuscule à la première lettre, sans point après la dernière lettre.
Il l’avait écrit comme un nom commun, sans capitale à l’initiale. Un nom commun isolé, en travers de la page, un objet incongru, hors de tout contexte, vestige rescapé d’une phrase disparue. Le nom formait un bloc. Les quatre lettres, liées les unes aux autres par l’élégante écriture anglaise, semblaient forgées du même fil d’encre noire, unies étroitement pour ne pas se perdre, pour ne pas perdre le sens qui circulait en elles et entre elles.
Il n’avait pas mis de majuscule à la première lettre. Sans le faire exprès, sans volonté délibérée ou mûrement réfléchie, il avait transformé le nom propre en nom commun. Et créé du même coup un néologisme, car le mot obtenu n’existait pas dans les dictionnaires usuels, ni dans le Petit Robert alphabétique et analogique de la langue française, ni dans le Petit Larousse, il en était sûr mais il les vérifia tous deux absurdement, par un souci maniaque – s’attardant sur les deux mots entre lesquels le nom aurait pu s’intercaler, le précédent et le suivant virtuels, qui en son absence se succédaient étroitement. Il pointa du doigt la place qui serait celle du mot nouveau, avec sa définition, ses exemples, décalant de quelques lignes toute la suite du vocabulaire. Maintenant que ce nom était décapité de sa majuscule, comme un noble amputé de sa particule, il pouvait rentrer dans le rang, se mêler à la foule de ses semblables, rejoindre incognito la masse des noms communs et gagner ainsi, comme des dizaines de milliers d’autres mots déjà existants, sa place dans le dictionnaire à l’endroit précis que lui assignait un classement alphabétique rigoureux et sans faille - une place qu’il n’aurait sans doute jamais pu conquérir dans la seconde partie du Petit Larousse illustré réservée aux noms propres, dans cette partie réduite, perpétuellement élaguée, renouvelée, des noms de famille illustres. Au contraire, le nom ayant changé de statut était maintenant susceptible de survivre dans le lexique, cette large famille d’accueil, car tous les mots y ont leur place exacte uniquement déterminée par le classement alphabétique, d’une élasticité totale, qui s’applique à tous, grands ou petits, usuels ou rares, vieux ou modernes, précieux ou familiers, quelle que soit leur origine nationale ou raciale, dans un égalitarisme exemplaire.
in Le nom, éditions A contrario, 2005
disponible en librairies ou sur 

________________________________________________________________________________________
Adam nomme les animaux
Physiologus
Cambrai, vers 1270-1275
Douai, Bibliothèque municipale, ms. 711, fol. 17
07:35 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent
mercredi, 04 mai 2005
Le café de la gare de Quincieux-Trévoux
Les dimanches d’été vers dix-sept heures, le père enfilait une chemise propre, une salopette propre, se coiffait d’une casquette propre, changeait ses bottes pour des mocassins et proposait à Jacques d’aller boire une bière. Tous deux montaient dans la deux-chevaux et rejoignaient le petit café de la gare de Quincieux-Trévoux. C’était la récompense et le repos qu’ils s’accordaient après avoir sacrifié aux travaux du jardin et de la maison, un des rares intermèdes que s’autorisait le père entre le curage des fossés, le débroussaillage, le sarclage des allées, le tri des pommes de terre et l’arrosage. La mère n’y trouvait rien à redire.
Roulant comme toujours à faible allure, ils quittaient la nationale au lieu-dit La Thibaudière, où subsistaient en contrebas de la route les restes d’un lavoir communal, pour emprunter l’étroite départementale sinueuse qui conduisait vers les paysages de l’Ain. La voiture bruyante et tremblante, souple et légère, se penchait dans les virages. Sur cet ancien modèle Citroën, la portière de Jacques s’ouvrait par l’avant et il advint qu’une fois, sur le parcours accidenté, cette portière mal bloquée s’ouvrit toute seule sur un cahot. Le vent la rabattit violemment sur la porte arrière. Les tôles claquèrent, l’air s’engouffra dans la voiture. En un réflexe salvateur, le père agrippa Jacques par son maillot et le plaqua contre le dossier du siège. Il ralentit, s’immobilisa sur le bas-côté de la route, très près du fossé, ôta sa casquette pour s’éponger le front et poussa de grands soupirs :
- On l’a échappé belle !
Dès lors, ils ne discutèrent plus que de l’événement, et d’abord, au café de la gare. Le père, encore tout remué, montrait son fils comme un miraculé. Il ne semblait pourtant pas à Jacques, vivement impressionné lui aussi par l’incident, qu’il ait risqué d’être expulsé de la voiture en marche…
- Il faut se méfier, confirmait un paysan accoudé au comptoir. L’autre jour, mon voisin roulait avec sa deux-chevaux quand son capot s’est soulevé et s’est rabattu sur le pare-brise ! Il ne voyait plus rien et n’a eu que le temps de s’arrêter avant l’accident.
A Quincieux aussi la plaine régnait. Mais les haies, les bosquets, les arbres avaient été préservés. La gare, à la frontière des départements du Rhône et de l’Ain, ressemblait à un poste douanier. Le passage à niveau, situé cinquante mètres avant le café, était très dangereux, avait dit le père à Jacques. Un dimanche qu’un garde-barrière remplaçant avait oublié de baisser la barrière à l’approche du train, trois hommes de la commune des Chères étaient morts, déchiquetés dans leur voiture par le rapide Paris-Lyon. Pendant quelques heures, ajoutait-il, on a cru que ton oncle Dodo faisait partie des victimes, car il était un ami du conducteur et se baladait souvent avec lui. On a eu très peur.
La salle était un peu sombre, toute de bois et de couleurs brunes, bruissante. Jacques et le père se tenaient de part et d’autre d’une table près du mur, le corps tourné vers le spectacle du café, comme assis en parallèle. Ils buvaient leur bière, une brune, une Pelforth, en silence, le regard perdu dans l'agitation des ombres et les volutes de fumée des pipes et des cigarettes. Ils ne disaient rien. Ils ne se disaient rien. Ou des choses convenues. Des choses qui semblaient vides, vaines, éphémères, décevantes. Mais Jacques emmagasinait des images, des lumières, des sons, la plénitude cuivrée de leur silence, les signes alors à peine sensibles de leur affection réciproque derrière la gêne et la pudeur.
Parfois un maquignon ou un paysan du coin reconnaissait le père, venait s’asseoir à leur table. Une conversation s’ensuivait, à laquelle Jacques se sentait résolument étranger : la dernière guerre, l’évocation de figures disparues ou inconnues, la taille des vignes, les conseils de jardinage, la croissance des veaux, les problèmes de remembrement rural… il décollait de la place et, dégustant sa bière à petits coups, se réfugiait dans ses pensées, la littérature, le lycée, les filles.
Ils rentraient de bonne heure, effectuant quelques détours par des chemins de terre, où le père laissait Jacques s’exercer à conduire au volant de la deux-chevaux. Ils mangeaient à sept heures au plus tard, et la mère n’aurait pas toléré que l’on déroge à cette régularité. Une salade de tomates et de haricots verts du jardin, agrémentée de persil et d'ail du jardin. Puis une fricassée de pommes de terre du jardin. Les pêches du verger. On prenait ensuite un peu le frais. Dans les rayons du soleil couchant, le père arrosait encore, se penchait sur la terre pour arracher une herbe isolée, inspectait une dernière fois son royaume végétal.
Jacques se couchait tôt. Le dimanche était toujours un mauvais soir, lourd de pensées sombres, d’angoisses diffuses, la veille anxieuse de la reprise du lycée. Le sommeil était difficile, contrarié. Plus tard, à n’en pas douter, à n’en juger que par les adultes autour de lui, le dimanche soir serait la veille de la reprise du travail, bien qu’il n’avait aucune idée du travail qu’il effectuerait. Serait-ce encore la veille mélancolique ? Serait-ce toujours cette même veille mélancolique, à intervalle régulier, cadencé, jusqu’au soir de sa vie ? Il en éprouvait une vague crainte, une prescience douloureuse, dans la solitude de sa chambre. La chatte Mireille n’était pas là, partie pour quelques jours ou quelques semaines, comme elle le faisait plusieurs fois par an, partie pour l’une de ces fugues amoureuses dont on craignait toujours qu’elle finisse par ne plus revenir.
Demain, il reverrait aussi ses amis. Hubert, Maurice, et les autres. Ils parleraient entre eux des programmes télévisés du dimanche, les extraits de films de La séquence du spectateur, le chanteur invité de Denise Glaser dans son émission Discorama. Dans son lit, il écoutait le transistor, tout près de son oreille. Au Club des Poètes, de Jean-Pierre Rosnay, on récitait des poèmes de Desnos, d’Apollinaire, d’Aragon. La musique assourdie des vers s’accordait bien avec la tristesse du dimanche soir.
extrait de La plaine des Chères, 1968 (inédit)
20:10 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent
jeudi, 14 avril 2005
110 poètes et moi
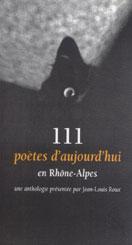 Je viens de recevoir une invitation pour le lancement à Saint-Martin-d'Hères (Isère) de cette anthologie "111 poètes d'aujourd'hui en Rhône-Alpes", coéditée par la Maison de la poésie Rhône-Alpes et l'éditeur Le Temps des Cerises. Ayant pu la feuilleter sur un stand du dernier Salon du Livre de Paris, j'ai pu vérifier que cet ensemble, réalisé et annoté par Jean-Louis Roux, comprenait quelques-uns de mes poèmes, que je lui avais envoyés à sa demande, tout en lui précisant que ces poèmes étaient anciens, très anciens, que je n'écrivais plus de poésie depuis vingt ans et que, dans ces conditions, je le laissais juge de les reproduire ou non, car j'ai quelque scrupule à passer pour un poète "d'aujourd'hui". Jean-Louis Roux a néanmoins retenu ces poèmes, et me consacre quelques lignes de commentaires. Etrange que ce passé refasse ainsi surface, et que l'on puisse encore me considérer comme un poète, alors que je suis défroqué depuis si longtemps !
Je viens de recevoir une invitation pour le lancement à Saint-Martin-d'Hères (Isère) de cette anthologie "111 poètes d'aujourd'hui en Rhône-Alpes", coéditée par la Maison de la poésie Rhône-Alpes et l'éditeur Le Temps des Cerises. Ayant pu la feuilleter sur un stand du dernier Salon du Livre de Paris, j'ai pu vérifier que cet ensemble, réalisé et annoté par Jean-Louis Roux, comprenait quelques-uns de mes poèmes, que je lui avais envoyés à sa demande, tout en lui précisant que ces poèmes étaient anciens, très anciens, que je n'écrivais plus de poésie depuis vingt ans et que, dans ces conditions, je le laissais juge de les reproduire ou non, car j'ai quelque scrupule à passer pour un poète "d'aujourd'hui". Jean-Louis Roux a néanmoins retenu ces poèmes, et me consacre quelques lignes de commentaires. Etrange que ce passé refasse ainsi surface, et que l'on puisse encore me considérer comme un poète, alors que je suis défroqué depuis si longtemps !
J'avais l'an dernier relu ces anciens poèmes et imaginé qu'un éditeur soit intéressé à leur republication ; voici le projet de préface que j'avais composé, pour les replacer dans l'évolution de mon écriture.
Projet de préface à une réédition hypothétique de mes «poésies complètes»
Il peut paraître surprenant, au prime abord, qu’un individu qui n’est pas encore complètement mort à l’heure où il écrit ces lignes, et qui est susceptible de produire encore de la littérature (et a même le désir avoué et affiché de produire de plus belle), ose présenter ses poésies comme complètes. Comment peut-on avoir la prétention de se connaître suffisamment pour risquer un jugement aussi définitif ? Pour prendre ce pari ? Je le prends cependant. L’écriture de ces poèmes, parus chez divers éditeurs entre 1984 et 1989, m’apparaît aujourd’hui, dans la distance critique du temps, comme une époque refermée de ma vie passée, une étape qui a été nécessaire mais dont le retour est improbable.
Ces poèmes, d’une composition lente, difficile, ont occupé une période importante de ma vie. Ils contiennent les thèmes de mon œuvre globale. Ils les annoncent, les développent à leur manière sobre, parfois trop sobre à mon goût actuel. Mais ils sont irrémédiablement datés, témoins figés, arrêtés (je serais incapable de les reprendre et d’en changer une ligne), vestiges d’une écriture que je ne pourrais plus emprunter.
Lorsque je lis, relis, ces poèmes anciens, je ne me trouve certes pas en face d’un étranger, je reconnais une part de moi-même, une parmi d’autres qui se sont tues au moment de l’écriture. Et même si cette recherche est allée très loin, dans une sorte d’ascèse de l’expression, même s’il m’arrive d’être satisfait ou heureux de nombre de ses résultats, je souffre aussi de ne présenter de moi qu’une part limitée, à laquelle les lecteurs risquent de me réduire.
Ces propos sembleront surprenants, notamment à ceux qui placent la poésie au-dessus des autres genres littéraires, mais je l’ai vécu ainsi : la poésie ne m’a pas permis d’exprimer la totalité de mon être. Lorsque j’écris en prose, devenue depuis lors mon mode exclusif d’expression, j’essaie d’inclure la poésie (du moins, ce que je mettais dans ma poésie) dans le corps du texte. Lorsque j’écrivais de la poésie, je ne parvenais pas à y rassembler tout ce que je mets dans la prose, et notamment l’humour, la dérision, un désespoir très quotidien et prosaïque, toutes ces dimensions qui concourent à dresser une œuvre en laquelle je me reconnais enfin.
Et cependant, la poésie, si elle a été une étape, s’est révélée fondamentale. Elle a été d’abord la joie de lecture de mon adolescence, la porte d’entrée sur la littérature, et le vrai déclencheur de mon envie d’écrire. Lorsque je me suis mis à la création, elle a été, comme plus tard les aphorismes auxquels j’allais sacrifier aussi sur une période limitée, une école de rigueur et de densité. Sans ces premiers textes, sans ces premières publications, sans la confiance que m’ont accordée alors des éditeurs, je n’aurais pas continué ni progressé dans ma voie.
Même si je m’en suis longtemps défendu, j’ai une dette envers la poésie, et je redécouvre que ces textes que j’avais laissés derrière moi font partie de mon œuvre. Lors de lectures ou de rencontres, certains lecteurs me réclament ces poèmes, désormais introuvables. Voici donc venu le temps de republier, 20 ans après le premier recueil édité, l’ensemble de ces plaquettes en un seul volume intitulé : Poésies complètes. Pour solde de tout compte. Et par fidélité.
J.J.N.
20:30 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent
jeudi, 17 mars 2005
La nouvelle
Dès le lendemain il appela Laurent, en appuyant sur la touche préenregistrée de son portable. Mais ce fut sa compagne qui décrocha.
- Oui ?
- Bonjour, c’est Jean-Luc. Tu vas bien ? Je voudrais parler à Laurent.
- Il vient de sortir pour aller à la bibliothèque. Si tu veux, je lui demande de te rappeler à son retour.
Il hésita.
- Et bien, d’accord, finit-il par dire.
Une heure plus tard, Laurent rappela.
- Salut, tu cherchais à me joindre ?
- Comment vas-tu, répondit Jean-Luc volontairement par ces mots banals. Il ne voulait pas lui annoncer d’emblée la nouvelle.
- On fait aller (c’était leur expression favorite à tous deux pour indiquer que leur existence n’avait rien d’enthousiasmant et que rien ne s’était produit de notable récemment). Et toi, quoi de neuf ? poursuivit son ami, qui semblait surtout s’enquérir de l’objet de l’appel.
Mais Jean-Luc, comme sourd à la question, continuait ses travaux d’approche.
- Que deviens-tu, depuis la semaine dernière ?
Cette interrogation ne s’adressait pas à la vie familiale ni professionnelle de Laurent. Sans qu’ils se soient donné le mot, les deux amis ne parlaient jamais entre eux des aléas et des mille détails de leurs vies quotidiennes, jugées peu dignes d’intérêt ; leur curiosité ne s’exerçait que sur le domaine qui leur était essentiel et commun : la littérature - ou plus précisément : l’écriture. Leur différence d’âge (Jean-Luc était plus vieux de vingt ans) s’effaçait lorsqu’ils communiaient dans la même passion exclusive, échangeant les adresses et les informations littéraires, se racontant inlassablement leurs dernières tentatives d’édition.
- Rien à signaler, dit-il d’un ton plutôt neutre. J’ai fait de nouveaux envois aux éditeurs et aux revues. J’attends, je guette les réponses chaque jour dans ma boîte aux lettres.
La conversation venait d’être placée sur le sujet attendu. Jean-Luc profita de l’occasion. Il déplia enfin la joie contenue dans sa voix ; il la laissa parler pour lui.
- J’ai reçu une bonne nouvelle. La revue Soror va publier l’un de mes textes ; j’avais les épreuves au courrier d’hier.
Il y eut d’abord un silence en retour. Bref, mais perceptible. Comme un temps d’arrêt. Un blanc. Puis Laurent parut heureux ; du moins prononça-t-il les mots que Jean-Luc attendait.
- C’est génial ! Une des revues les plus prestigieuses, et chez un grand éditeur ! Te voilà reconnu maintenant. Et quel texte as-tu envoyé ?
- Je te l’avais montré la dernière fois que l’on s’est rencontrés : c’est une nouvelle déjà ancienne, qui s’intitule L’Avent. Elle a d’ailleurs été refusée par plusieurs petites publications. Ce qui montre que les grandes revues sont finalement aussi accessibles que les confidentielles, et qu’il ne faut pas se décourager.
Ils échangèrent encore quelques phrases, sur leurs projets respectifs. Des propos presque ordinaires, mais sur un ton plus allègre que d’habitude. Laurent semblait heureux, heureux pour Jean-Luc - c’est du moins ainsi que ce dernier interpréta sa réaction. Comment être sûr ? Il ne pouvait voir ni son visage ni l’attitude de son corps, et les inflexions de sa voix étaient assourdies par la distance.
Le silence succéda à leurs paroles. Ce fut d’abord le silence de Laurent, puis celui de Jean-Luc, puis un silence commun qui s’écoula, s’accumula jusqu’à devenir perceptible et pesant. Laurent ne semblait pas disposé à prolonger la conversation. Peut-être que la durée commençait à le gêner : tous deux habitaient des coins opposés du pays et la communication était à sa charge. C’est pour cela que Jean-Luc avait appelé la première fois et qu’il avait été déçu de ne pas trouver son ami au bout du fil. Pour une fois qu’il était porteur d’une bonne nouvelle, il aurait aimé éterniser cet échange (surtout après l’avoir gardée pour lui toute la soirée précédente, toute la nuit sans pouvoir dormir et une grande partie de la journée, tout ce temps en tête-à-tête avec une joie trop grande). Mais il ne pouvait faire payer à un autre le prix de son bonheur. Il prit congé.
- A bientôt.
- A bientôt, Jean-Luc. Et franchement, bravo. C’est une vraie réussite. Un sacré encouragement.
Il reposa le téléphone portable sur son bureau. Devant lui, l’enveloppe à en-tête de la revue Soror - si belle, si élégante - renfermait la précieuse réponse. A côté d’elle, sa montre indiquait une heure de fin d’après-midi d’hiver, une heure familière, à laquelle il avait coutume d’écrire depuis si longtemps. Depuis tant d’années. Des décennies. Il retrouva sa solitude. Une vieille fatigue qu’il avait oubliée depuis la veille revint et reprit possession de tout son corps, le tassa sur sa chaise. Il regarda derrière lui, par dessus son épaule, par delà son épaule, et vit la succession de portes ouvertes, en enfilade, jusqu’à l’autre bout de l’appartement, jusqu’à la porte-fenêtre du balcon par laquelle on ne voyait que le noir uni de la nuit. Il ferma les yeux. Si une femme avait répondu à sa déclaration d’amour après vingt ans de silence, quelle aurait été sa réaction ? Aurait-il encore été là, rivé à sa table, réduit à l’état de squelette ou de fantôme, à guetter la réponse ? Cette nouvelle, si heureuse, si providentielle, si follement espérée (et devenue inespérée avec le temps) ne pouvait combler une attente aussi longue, ni effacer la souffrance passée. Le désert avait traversé la plus large part de sa vie. Rien ne lui rendrait ces années perdues. Rien ne le ferait revivre. Il fixa l’enveloppe dérisoire, refermée sur un contenu dérisoire. Toute une vie pour ça, pour une réponse après mille refus, une lettre de quelques lignes, quelques mots si communs au fond, une signature qui compte dans le milieu littéraire. Connaître la solitude, l’échec, l’amertume, devenir vieux, pour une chance qui n’en est plus une depuis longtemps, tout ça pour réussir quand il est trop tard.
*
(La nouvelle a été publiée notamment dans le magazine Bien-dire n° 30)
20:15 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent
lundi, 24 janvier 2005
La faute
Ce texte (une nouvelle?) paru dans Portraits d'écrivains n'est pas sans rapport avec le thème de mon roman Le nom, à paraître prochainement aux éditions A contrario : notre nom nous constitue - et je garde en moi, tenace, une drôle de conviction : qui touche à la lettre touche à l'être.
La faute
On a fait une faute d'orthographe à son nom. Immédiatement il l'a vue car immédiatement son œil s'est précipité sur la place de son nom dans la liste. Une faute énorme. Elle lui crève les yeux. C'est monstrueux. Il n'ose pas le croire, il n'ose pas le voir. Il y a sous ses yeux une liste de lauréats d'un prix littéraire, les lauréats depuis l'origine du Prix du Livre du Conseil général du département. Et parmi la vingtaine de noms il s'en trouve un seul mal orthographié, et c'est le sien. Il tourne et retourne le dépliant, fort bien fait au demeurant. Composition élégante, mise en page impeccable, couleurs discrètes et chatoyantes - un beau document promotionnel, mais il y a cette faute, la faute de cette faute. Elle porte en plus sur la première lettre de son nom, la seule qui soit en capitale. La première d'un nom de quatre lettres. L'initiale, celle qui le place dans l'alphabet, qui le classe dans l'ordre des lauréats, dans l'ordre du monde. Une faute capitale.
On a fait une faute d'orthographe à son nom. Il est atteint, blessé, anéanti. Pourquoi faut-il que cela tombe sur lui ? Il lui revient en mémoire un cas similaire, mais moins grave. Son pire ennemi est un sale écrivain de renom, il a un putain de nom italien avec deux l et deux t, une paire d'l, une paire de t. Souvent, et surtout au début de sa carrière, quand ce bellâtre était moins connu, on relevait dans un article de journal son nom avec une lettre en moins. Un l ou un t omis. Un nom légèrement raccourci, diminué. Mais l'erreur pouvait se concevoir car ni les critiques littéraires ni les secrétaires de rédaction ni les typographes n'ont l'habitude des patronymes italiens. Et cet oubli d'une lettre (une, rien qu'une sur huit) ne déformait pas le nom, ne le dénaturait pas. Phonétiquement on ne percevait aucune différence. C'était donc une faute mineure, passant généralement inaperçue, une faute de détail. Alors que dans son cas, la faute concerne la première lettre du nom (et d'un nom court, qui plus est), la consonne d'attaque, l'initiale. Cela change tout. Ce n'est plus le même nom, ce n'est plus le même homme. Sa mère, son père eux-mêmes ne le reconnaîtraient pas. Une lettre erronée sur quatre : une proportion énorme, vingt-cinq pour cent, un quart. Et comme il s'agit de la lettre capitale, d'une majuscule faite pour attirer le regard, le pourcentage de vingt-cinq pour cent doit être revu et majoré, il convient d'appliquer un coefficient multiplicateur, au final on n'est pas loin de cinquante pour cent. Oui, près de la moitié. Une moitié d'erreur sur un nom, sur un être. Une atteinte à son intégrité. Une entreprise de démolition. Un début d'extermination.
On a fait une faute d'orthographe à son nom. A quoi sert-il d'avoir le prix pour récolter cette infamie ? La courte joie de cette récompense a viré au cauchemar, sa journée est gâchée, sa semaine est gâchée, son année est gâchée, il n'aura pas trop de toute une vie gâchée pour oublier ce gâchis. Il aurait mieux valu ne jamais être distingué. Autant être un homme sans nom, un quidam. Ceux qui s'occupent de la culture et de la communication au Conseil général sont vraiment nuls. Comment ont-ils pu laisser passer ça ? N'y a-t-il personne pour relire ? Ou serait-ce une malveillance ? Serait-ce à dessein, par volonté de nuire, volonté de toucher au vif, auquel cas on ne s'est pas trompé. Tout est possible. Il n'a pas que des amis dans le département, ni dans le pays ; il a même d'anciens et solides ennemis comme ce putain de sale écrivain de renom tellement connu aujourd'hui que l'on n'écorche plus son nom. Il peut compter sur ses ennemis ; la haine a ceci de supérieur à l'amour qu'elle est indéfectible.
On a fait une faute d'orthographe à son nom. Qui a commis l'erreur ? Qui doit être châtié ? Contre qui porter plainte ? Comme d'habitude les responsabilités se diluent, se délitent ; l'attaché culturel du département accusera les maquettistes d'avoir mal saisi le nom, ceux-là diront qu'il était mal écrit et sujet à interprétation. Il n'y a rien à faire contre une machine administrative, contre une chaîne d'opérateurs qui renvoient la faute les uns sur les autres, sur l'avant ou sur l'après, de l'amont à l'aval tout fuit et se débine, et puis, il est trop tard. Ce dépliant a été diffusé, multiplié à des milliers d'exemplaires. Les librairies, les bibliothèques, les centres culturels en sont inondés.
On a fait une faute d'orthographe à son nom. On, toujours revenir à ce on, opaque, impénétrable. Ça le remplit de rage, d'une énergie de pure violence, inépuisable, qu'il ne sait contre qui diriger. Le voici réduit à tracer des mots sur une feuille blanche, à écrire sans fin, à la suite, pour vider sa rancœur, vider la querelle tout seul, faute d'ennemi identifié, tout seul contre ce on qui se dérobe, ce on tout rond qui n'offre aucune prise, aucune aspérité. On, ce pronom indéfini porte bien son nom, il est obscur, indistinct, commode pour dissimuler les coupables. Qui se cache derrière ? Sont-ils un, deux, plusieurs ? Quel sont leur visage, leur âge, leur sexe ? Qui est responsable, derrière ce on, derrière ce magma, ce pronom qui est à peine un mot, juste un son, une onomatopée marmonnée par dieu sait qui. Cet arbre cache toute une forêt. A l'abri de ce petit mot de deux lettres, tout le Conseil général du département se terre, aligné derrière à la queue leu leu sans une seule oreille qui dépasse, tous, les élus comme les fonctionnaires des services, les chargés de mission et cette cellule à la con qui s'occupe du Prix du Livre, avec la compétence que l'on sait ! Il est hors de lui. Il marche de long en large dans toutes les pièces de son appartement. Son corps est parcouru de tremblements et de tics. Il repense au discours suave et consensuel qu'il a prononcé dans les grands salons de la préfecture pour remercier le Conseil général de lui avoir décerné le prix. Ce jour-là, dans le magnifique décor un peu irréel, sous les lambris dorés et les lustres lourds, devant le parterre de personnalités et de journalistes, il a loué l'action culturelle de la collectivité, sa politique en faveur du livre ! Il a flatté les élus ! Il les a remerciés à plusieurs reprises ! Il leur a léché le cul ! Et voilà ce qu'il trouve en réponse : une faute d'orthographe à son nom. Une gifle. Un témoignage de mépris. Ce désastre lui ouvre les yeux. Il veut tellement être lisse, poli, civilisé, dans la norme et dans la règle, qu'on ne le distingue plus, qu'on ne le connait plus. Il devient transparent. On ne se souvient plus de son nom, on ne sait même plus l'écrire. Il va falloir qu'il arrête cette hypocrisie, ces beaux discours, ces faux-semblants, qu'il dise ce qu'il pense au lieu de mots convenus, factices et flatteurs, qu'il dise la vérité ; au moins on le remarquera, serait-ce pour s'en offusquer, et on lui prêtera enfin attention. On ne fera plus de faute d'orthographe à son nom. On le craindra. On aura peur de se tromper en écrivant son nom, on sera malade à l'idée de commettre une faute et on vérifiera, plutôt trois fois qu'une, on se relira, on se fera relire. On l'écrira en faisant gaffe, lentement, méticuleusement, en s'appliquant comme à l'école, la langue entre les dents, avec respect, avec un indéfinissable frisson dans le dos. C'est décidé. Rien ne sera plus comme avant. Plus de concessions. Il sera lui-même, clair, brutal, abrupt. On va l'entendre. Ils vont voir. Ils feront dans leur froc en pensant à lui, à sa vue ils se rouleront dans leur fange, il y aura de la merde jusqu'au plafond, ils écriront son nom avec leurs étrons, ils l'articuleront avec leur anus, ils le chieront sous eux, traçant les quatre lettres, une à une, gorgées de matière, sans la moindre faute et d'une forme impeccable, avec les pleins et les déliés.
07:17 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent






