mardi, 03 juillet 2007
Le cagibi (dans le Codex Atlanticus)
 Le texte Le cagibi vient d'être republié dans le numéro 16 du Codex Atlanticus, anthologie annuelle de littérature fantastique. C'est l'occasion de remettre en ligne cette courte nouvelle parue sur ce blog le 22 avril 2006.
Le texte Le cagibi vient d'être republié dans le numéro 16 du Codex Atlanticus, anthologie annuelle de littérature fantastique. C'est l'occasion de remettre en ligne cette courte nouvelle parue sur ce blog le 22 avril 2006.
Les temps étaient durs. L'hiver n'en finissait pas. On mangeait des pommes de terre tous les jours. Le dimanche seulement, la mère ajoutait aux tubercules un morceau de viande bouillie que l'on dévorait des yeux, car il était réservé au père. Les économies avaient fondu à Noël. La misère gagnait comme une gangrène. Il fallait absolument que le père livre son manuscrit à temps à l'éditeur, pour toucher son à-valoir.
Afin qu'il puisse se concentrer sur son travail, et que rien ne vienne distraire son regard ni sa pensée, la mère avait imaginé un moyen radical pour l'isoler du monde et de ses tentations, comme pour l'empêcher de sacrifier à la boisson, qui constituait avec les femmes l'une de ses faiblesses. Elle ne manquait jamais de ressources quand la situation devenait grave et, une fois encore, son idée se révéla judicieuse. Elle aménagea un cagibi sous l'escalier.
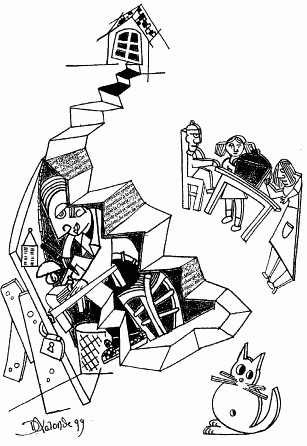 Quelques planches récupérées dans la cave, des panneaux de contreplaqué, des chevrons, des clous, une porte sur deux charnières, le réduit fut vite créé - on le découvrit en rentrant de l'école. Elle y installa une chaise raide en bois, une petite table de fer, et sur celle-ci, tous les accessoires qu'elle jugeait nécessaires à l'activité d'écrivain : une rame de papier blanc, un stylo plume, un encrier rempli d'encre noire, deux crayons, une gomme, un taille-crayon, un dictionnaire. Depuis la cuisine fut tiré un fil électrique, au bout duquel pendait une simple ampoule dépolie. Une petite corbeille à papier compléta l'ensemble. La surface minuscule n'aurait guère pu être meublée davantage. Rien ne filtrait du dehors. Ni bruit, ni air, ni lumière. Extérieur eût été ici un mot déplacé.
Quelques planches récupérées dans la cave, des panneaux de contreplaqué, des chevrons, des clous, une porte sur deux charnières, le réduit fut vite créé - on le découvrit en rentrant de l'école. Elle y installa une chaise raide en bois, une petite table de fer, et sur celle-ci, tous les accessoires qu'elle jugeait nécessaires à l'activité d'écrivain : une rame de papier blanc, un stylo plume, un encrier rempli d'encre noire, deux crayons, une gomme, un taille-crayon, un dictionnaire. Depuis la cuisine fut tiré un fil électrique, au bout duquel pendait une simple ampoule dépolie. Une petite corbeille à papier compléta l'ensemble. La surface minuscule n'aurait guère pu être meublée davantage. Rien ne filtrait du dehors. Ni bruit, ni air, ni lumière. Extérieur eût été ici un mot déplacé.
L'escalier menait aux chambres de l'étage, celles des enfants, des chambres étroites et mansardées, glaciales en hiver, des fournaises l'été. On devait éviter de l'emprunter de jour, lorsque le père écrivait. En cas d'absolue nécessité, si l'on avait oublié là-haut un livre d'école ou son cache-nez, il était permis de monter, avec d'infinies précautions, après avoir chaussé les pantoufles, ou en chaussettes. Le moindre craquement d'une marche, et une gifle tombait. La mère avait la main leste, et lourde.
Chaque matin, après le petit-déjeuner, à huit heures trente, trente-cinq au plus tard, elle se tournait vers le père et, sans prononcer une parole, pointait son index vers le cagibi. A ce signal, il se dirigeait vers ce qui lui tenait lieu de bureau et se contorsionnait pour pénétrer à l'intérieur et s'installer à sa table : la faible hauteur ne lui permettait pas de tenir debout ; assis, sa tête frôlait la marche de l'escalier. Elle fermait la porte du réduit avec un petit cadenas, et conservait la clé dans une poche de son tablier. Le père ne pouvait ensuite sortir que pour satisfaire ses besoins naturels. Il écrivait tout le matin, sans pouvoir changer de position, à la lumière artificielle qui lui chauffait le visage. Défense lui était faite de fumer, pour d'évidentes raisons de sécurité. A midi la mère le libérait pour le déjeuner qu'il prenait en famille, en silence, immobile, le regard fixé sur le fond de l'assiette ; on devait éviter de parler pour ne pas le distraire de sa réflexion. Il prenait un café, parfois deux. Puis il retournait dans le débarras, muni d'une bouteille d'eau du robinet, de quelques gâteaux et fruits secs, jusqu'au début de soirée - à dix-huit heures précises - où la mère venait enlever le cadenas. Il écrivait tout l'après-midi, sous l'ampoule brûlante, en se servant du recto et du verso des feuilles, par économie. On entendait le doux crissement de la plume. On entendait parfois le froissement d'un papier, qu'il jetait dans la corbeille.
Le père travaillait au moins huit heures par jour, dans une solitude absolue. On n'avait pas le droit de lui rendre visite ; même le chat était interdit de séjour. Il ne connaissait ni samedi, ni dimanche, ni jour férié. Chaque soir, après le dîner, il passait au rapport, devant faire à la mère le compte-rendu de l'évolution de son œuvre. Il lui montrait les pages manuscrites, ainsi que son journal intime, qu'il était autorisé à tenir, en parallèle, à condition que cette activité annexe ne lui prenne qu'un temps limité et ne le détourne pas de sa tâche principale. Le livre avançait avec une grande régularité, selon le calendrier prévu et punaisé sur la cloison de planches. On coulait des jours quasi paisibles, dans une maison redevenue calme et silencieuse, après ce difficile automne qui n'avait été qu'une longue saison de crise. Le père ne se plaignait pas, sauf un peu des yeux et de quelques courbatures. La mère semblait contente, et confiante. On se reprenait à espérer. L'hiver touchait à sa fin. On rêvait d'améliorer l'ordinaire des patates.
Extrait du recueil Portraits d'écrivains, Editinter, 2002. La nouvelle était précédemment parue dans la revue La Grappe, accompagnée de cette illustration de Dominique Laronde.
18:20 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : litterature, culture, nouvelles et textes brefs
vendredi, 22 juin 2007
Le passeur d'éternité, de Roland Fuentès
 (Cet article est paru dans La Presse Littéraire n° 9.)
(Cet article est paru dans La Presse Littéraire n° 9.)
Roland Fuentès est un jeune auteur qui s'est fait connaître par le prix Prométhée de la nouvelle, avec Douze mètres cubes de littérature, paru aux éditions du Rocher. Il a par ailleurs, toujours dans une veine poétique et fantastique, fait paraître trois romans, Le Musée, chez Fer de Chances, La double mémoire de David Hoog, chez A contrario (ces deux éditeurs étant malheureusement tôt disparus, et leurs livres désormais introuvables) et un savoureux petit polar humoristique, La Bresse dans les pédales, chez Nykta. Son nouvel ouvrage nous entraîne au dix-huitième siècle, dans le sud de la France.
Pendant la grande peste de 1720, Maladite, bourgeois d'Aix-en-Provence, parcourt inlassablement les chemins du pays à la recherche d'oeuvres de grands maîtres pour les sauver de la destruction et du pillage. Une nuit de tempête, alors qu'il a été recueilli et sauvé par un métayer du hameau de Mallemort, il trouve chez ce dernier une sculpture qui le fascine, réalisée par son hôte ; il la vole et s'en approprie la création. Suivent de multiples péripéties dans des villes infestées par la peste, jusqu'aux retrouvailles finales avec le métayer.
On retrouve le thème de la dépossession, que l'on a vu dans La double mémoire de David Hoog : on se souvient que dans ce précédent roman, un certain Wolf, homme récemment décédé, tentait de revivre dans Hoog en prenant possession de son esprit ; le héros perdait sa mémoire originelle et propre, remplacée par une mémoire intruse. Ici, c'est une oeuvre qui s'introduit dans l'esprit de Maladite, oeuvre de laquelle il tire sa force et son invincibilité (il traverse sans encombre et sans risque une région infestée par la peste), mais qui le mènera implacablement vers la folie.
L'une des questions taraudantes du livre est celle de la valeur de l'art, qui représente toute la vie et la raison de vivre de Maladite. La femme du métayer en a une conception qui désoriente le collectionneur : « Vous pouvez garder la tête en bois. Ce n'est qu'un morceau d'arbre mort auquel mon mari, par désoeuvrement, a voulu donner forme. Si vous l'aviez demandé nous vous aurions cédé l'objet volontiers ; vous vous seriez dispensé d'un vol et d'un départ si ingrat. » Et quel est le sort de son créateur, qui peut ne pas être à la hauteur de son oeuvre, voire inconscient de sa valeur ? « Comment ce métayer de rien du tout, ce rustre, pouvait-il mépriser le bijou enfanté de ses mains ? Etait-il possible que la valeur d'une oeuvre dépasse d'aussi loin celle de son auteur ? » Un tel don transcende les catégories sociales, se rit de la culture ou des écoles d'art : « Pour lui, le génie procédait d'une essence magique, octroyée à une petite communauté d'élus. Naïvement il avait cru seuls capables de génie les gens de sa caste, instruits dans la règle aux subtilités de l'art. » Le trafiquant d'art découvre qu'un homme du peuple peut être, comme à son corps défendant, un créateur génial.
En subtilisant et rassemblant les tableaux de sa collection, Maladite ne travaille pas pour lui, dans un but égoïste, mais pour l'art, qu'il passe aux siècles suivants ; en cela réside la clé du titre : le passeur d'éternité. « Je ne suis pas un voleur. En récupérant les tableaux chez mes clients décédés, je ne fais que reprendre en charge leur avenir. Il est périlleux d'abandonner une oeuvre au parcours hasardeux des héritages. Ce qui a du prix pour le père se révèle parfois quantité négligeable pour le fils. Or, pour traverser le temps et éclore lorsque viendra sa saison, une oeuvre doit bénéficier de fervents défenseurs à différentes époques. Si un seul maillon de la chaîne vient à sauter, l'oubli peut engloutir l'oeuvre. (...) Je rétablis une justice pour les oeuvres à l'avenir incertain. »
La solitude est le lot de cet amateur : sans famille, sans compagne, Maladite n'éprouve pas de véritable solidarité avec les autres (il refuse le concours de sa force aux paysans, ne sachant que donner un peu d'or) et ne communie qu'avec l'art. Par cette passion exclusive il perdra la raison, lorsqu'un évènement fatal viendra vider sa vie de sa substance, comme de son identité d'artiste usurpée.
Dans une prose solide et riche d'expressions savoureuses, jouant sur le décalage du temps et de la langue, avec une construction savante d'emboîtements (le récit est celui d'un marchand d'art, Jean Vayron, lequel recueille les confidences orales d'une vieille bossue aux airs de sorcière qui lui vend l'histoire, chaque version s'éloignant de l'histoire originelle introuvable comme toute vérité), Roland Fuentès conduit son lecteur jusqu'au dénouement d'une main de maître. Tout en signant un roman historique crédible, il reste fidèle à sa veine fantastique et réaffirme qu' « Une histoire est une somme de mensonges. ».
Roland Fuentès, Le passeur d'éternité, Les 400 coups éditeur. 104 pages, 11 €.
19:20 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Culture, Roman, Fuentes
jeudi, 14 juin 2007
Revue de détail n° 8
(Ces chroniques sont parues dans La Presse Littéraire n° 9.)
LA SŒUR DE L’ANGE n° 4
 Les éditions Le Grand Souffle ont eu l’heureuse initiative de faire renaître la revue semestrielle de philosophie et de littérature La Sœur de l’Ange, prématurément disparue suite au dépôt de bilan de son précédent éditeur « A Contrario ». On se souvient de ces belles et imposantes livraisons, la qualité le disputant à la quantité, et qui s'articulaient sur un thème : A quoi bon l'art ? A quoi bon la nation ? A quoi bon mourir ?
Les éditions Le Grand Souffle ont eu l’heureuse initiative de faire renaître la revue semestrielle de philosophie et de littérature La Sœur de l’Ange, prématurément disparue suite au dépôt de bilan de son précédent éditeur « A Contrario ». On se souvient de ces belles et imposantes livraisons, la qualité le disputant à la quantité, et qui s'articulaient sur un thème : A quoi bon l'art ? A quoi bon la nation ? A quoi bon mourir ?
Le 4ème numéro a pour thème : « A quoi bon Dieu ? », et l'ambition est toujours la même : poursuivre une aventure intellectuelle et humaine indispensable à la vie culturelle menacée de notre temps. « En philosophie comme en littérature, contre la culture du consensus et l’idéologie molle du spectre démocratique, La Sœur de l’Ange allume le feu de la vie ascendante en rappelant la vertu de la confrontation créatrice. « Que chacun sache en quoi il n’est pas d’accord avec l’autre » est l’une des conditions pour qu’un parlement textuel se rende capable d’ouvrir de nouveaux horizons. »
L'introduction de Debord donne le ton : « Les personnes qui n'agissent jamais veulent croire que l'on pourrait choisir en toute liberté l'excellence de ceux qui viendront figurer dans un combat, de même que le lieu et l'heure où l'on porterait un coup imparable et définitif. Mais non : avec ce que l'on a sous la main, et selon les quelques positions effectivement attaquables, on se jette sur l'une ou l'autre dès que l'on aperçoit un moment favorable ; sinon, on disparaît sans avoir rien fait. » Frédéric Houdaer présente un texte savoureux d'Alexandre Vialatte, « La religion veut entrer dans un cercle carré », dans lequel le sage auvergnat nous explique par un humour des plus convaincants pourquoi la religion est fondée sur un dogme immuable : « On voudrait un cercle carré. « Tout change, pourquoi pas la religion ? » Parce qu'une circonférence est forcée de rester ronde. Parce qu'elle y est tenue par sa définition. »
Au sommaire encore : Didier Bazy, Andrée Chédid, Alain Jugnon, Falk van Gaver, André Chouraqui, Philippe Corcuff, Yannis Constantinidès, Ludwig Feuerbach, Michel Crépu, Jean Luc Moreau parmi bien d’autres contributions et des lettres inédites d’André Rolland de Renéville, René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte.
La Soeur de l'Ange matérialise un espace où s'expriment philosophes, théologiens, écrivains, où l'on convoque Abellio, Bernanos, Nietzsche. Confrontées, juxtaposées, sans guerre ni concession, les paroles des athées et celles des croyants se rencontrent dans ce chantier ouvert, d'une réelle démocratie. Un espace unique où chaque pensée est libre d'exister, en relation avec l'altérité. Voilà qui nous change heureusement du militantisme excommunicateur.
La Sœur de l’Ange, Le Grand Souffle éditions, 24 rue Truffaut, 75017 Paris. 252 pages, 18,50 €. http://revuelasoeurdelange.hautetfort.com
MERCURE LIQUIDE n° 4
Cette revue littéraire et graphique semble revenir de loin. On peut lire en effet dans le dernier numéro paru : « Vous tenez entre vos mains Mercure liquide n° 4, dernier numéro de la revue à se produire sur papier. » Mais l’aventure, assurent les responsables, continuera sur le web, une revue en ligne enrichie de musique, de vidéo, de portraits des artistes publiés, d’un espace de résidences online… Fidèle au principe même du mercure, matière inaltérable symbole de transformation, la revue espère se prolonger sous d’autres formes. Mais ce n'était qu'une fausse alerte. Mercure liquide annonce désormais sur son site que le numéro 5 paraîtra en février 2007, grâce à une subvention accordée par la région Rhône Alpes, la première depuis le début de cette aventure éditoriale. Le numéro 4 est un superbe objet, dont la conception graphique est due à Safran. L'ensemble vaut par ses textes (trois des auteurs présents, Samuel Gallet, Silvère Valtot, Thibaut Fayner sont passés par les classes d'écriture dramatique de l'ENSATT) mais surtout par ses collaborations artistiques, dont les photos réalisées par Franck Boutonnet dans les bidonvilles de la banlieue lyonnaise, conciliant art et humanité. La revue, moins littéraire qu'artistique, a une réelle unité, probablement due à la complicité et à la communauté d'esprit des contributeurs.
Mercure liquide, 21 rue Duhamel, 69002 Lyon. 84 pages, 7€. www.mercureliquide.com
PASSAGE D’ENCRES n° 26
 Sous titrée art / littérature, cette revue de prestige, d'un grand format original quasi carré, faisant la part belle au dessin et à la photographie, est éditée par l’association Passage d’encres, dont le but est la promotion, le développement et la diffusion des arts graphiques. Animée par Christiane Tricoit, et forte d’un solide comité de rédaction, elle sort 3 numéros par an. « Nulles parts » est le thème de ce dernier numéro, coordonné par Yves Boudier et Jean-Claude Montel. Dans l'introduction, « Sur le carnet de l'arpenteur », Boudier présente l'axe de réflexion : « S'il est un domaine de notre présence au monde qui conjugue au plus étroit politique et ressenti naturel, c'est bien celui que l'on nomme paysage. Lié à notre histoire commune, indéfectiblement uni à nos vies, il est avant tout culture. Il se constitue et se révèle à travers l'ensemble des actes par lesquels notre volonté l'impose, le construit, le détourne, l'altère, le transforme, souvent même le détruit. » Suivent de superbes photos noir et blanc d'Andoche Praudel, des paysages naturels corréziens qui « semblent vibrer d'une attente de l'impossible » selon la juste formule de Didier Laroque. Robert Groborne est l'artiste invité et livre un ensemble intitulé « L'ordre minéral », une série de lithographies alternées avec des poèmes de Joseph Guglielmi. Précisons que des petits livres sont également édités par l’association, dans les collections Traces, Trait court, Tiré à part, toutes dans l'alliance ou le dialogue de l'art et de la littérature.
Sous titrée art / littérature, cette revue de prestige, d'un grand format original quasi carré, faisant la part belle au dessin et à la photographie, est éditée par l’association Passage d’encres, dont le but est la promotion, le développement et la diffusion des arts graphiques. Animée par Christiane Tricoit, et forte d’un solide comité de rédaction, elle sort 3 numéros par an. « Nulles parts » est le thème de ce dernier numéro, coordonné par Yves Boudier et Jean-Claude Montel. Dans l'introduction, « Sur le carnet de l'arpenteur », Boudier présente l'axe de réflexion : « S'il est un domaine de notre présence au monde qui conjugue au plus étroit politique et ressenti naturel, c'est bien celui que l'on nomme paysage. Lié à notre histoire commune, indéfectiblement uni à nos vies, il est avant tout culture. Il se constitue et se révèle à travers l'ensemble des actes par lesquels notre volonté l'impose, le construit, le détourne, l'altère, le transforme, souvent même le détruit. » Suivent de superbes photos noir et blanc d'Andoche Praudel, des paysages naturels corréziens qui « semblent vibrer d'une attente de l'impossible » selon la juste formule de Didier Laroque. Robert Groborne est l'artiste invité et livre un ensemble intitulé « L'ordre minéral », une série de lithographies alternées avec des poèmes de Joseph Guglielmi. Précisons que des petits livres sont également édités par l’association, dans les collections Traces, Trait court, Tiré à part, toutes dans l'alliance ou le dialogue de l'art et de la littérature.
Passage d’encres, 16 rue de Paris, 93230 Romainville. 104 pages, 19 € www.passagedencres.org
18:21 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture, Revue
vendredi, 08 juin 2007
Le sourire de Cézanne, de Raymond Alcovère
 Après un premier roman « Fugue baroque », publié en 1998 chez le même éditeur, Raymond Alcovère livre avec Le sourire de Cézanne un roman léger, intime, sur la rencontre d’un jeune étudiant et d’une femme, de vingt ans son aînée, qui écrit un livre sur les peintres. Léonore, rescapée d’une rupture amoureuse, connaît avec Gaétan un amour intense, une passion partagée sous le ciel lumineux des villes du sud (Montpellier, Aix) : « Elle déborde d’un amour absolu envers lui, un amour qui ne remet pas en cause sa liberté. »
Après un premier roman « Fugue baroque », publié en 1998 chez le même éditeur, Raymond Alcovère livre avec Le sourire de Cézanne un roman léger, intime, sur la rencontre d’un jeune étudiant et d’une femme, de vingt ans son aînée, qui écrit un livre sur les peintres. Léonore, rescapée d’une rupture amoureuse, connaît avec Gaétan un amour intense, une passion partagée sous le ciel lumineux des villes du sud (Montpellier, Aix) : « Elle déborde d’un amour absolu envers lui, un amour qui ne remet pas en cause sa liberté. »
Au-delà de la belle relation entre ces deux êtres, ce roman est une réflexion amoureuse sur la peinture et un hymne à Cézanne, une superbe approche de ce peintre qu’on ne peut rencontrer qu’en face de ses tableaux originaux, tant les reproductions sont trompeuses dans son cas, nous cachant la profondeur intense et la vie de la matière qui nous saisit physiquement à leur vue. Cézanne qui écrivit ces mots si forts : « La nature n’est pas en surface, elle est en profondeur. Les couleurs sont l’expression, à cette surface, de cette profondeur, elles montent des racines du monde. » Alcovère nous confie sa passion érudite pour d’autres créateurs : Poussin, Greco, Velázquez, Rembrandt, Caravage, Rubens, Fragonard, Picasso…
« Léonore, comme un peintre, ajoute de temps à autre une touche à son livre. » Et Raymond Alcovère procède de la même façon, son roman s’écrit par petites touches, phrases courtes, légères, fragments jetés comme des petites notes. La vie de ses personnages est ainsi, notations, sensations, éclats lumineux, éclairs de passion et ne vaut que par l’amour et l’art.
Le sourire de Cézanne, de Raymond Alcovère, éditions N&B, 110 pages, 13 €
13:10 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture, Roman, Alcovère
jeudi, 12 avril 2007
Le club des pantouflards, de Christian Cottet-Emard

(Cet article, plus complet que celui que j'avais consacré l'an dernier à ce livre sur mon blog, est paru dans La presse Littéraire n° 9.)
Christian Cottet-Emard, qui anime avec humour et lucidité l’un des meilleurs blogs littéraires du moment (http://cottetemard.hautetfort.com), et qui s’est fait connaître comme poète, nouvelliste et romancier (Le grand variable, chez Editinter) vient de publier, dans la collection Petite Nuit, chez Nykta, un savoureux mini-polar, Le club des pantouflards.
L’histoire – relevant davantage de la politique-fiction que du genre policier - se situe dans le quartier lyonnais de Vaise, entre la rue Gorge de Loup et le pont Masaryk, un quartier jadis ouvrier (l’entreprise de la Rhodia), aujourd’hui déshérité mais en pleine rénovation, où quelques bobos aménagent des lofts dans les friches industrielles. Le héros, qui n’a rien d’héroïque, répond au nom improbable d’Effron Nuvem, et mène une vie grise de chômeur solitaire, celle d’un contemplatif sans autre perspective que la lecture de livres de poches (dont Les âmes mortes, de Nikolaï Gogol) et la consommation de sardines à l’huile portugaises Roses de France et de cafés au lait avec tartines. Tous ses espoirs semblent derrière lui : « Ses grands rêves d’adolescence le visitèrent. Ils étaient quant à eux de beaux papillons de jour mais ils avaient fait le chemin à l’envers, retournant vite aux chrysalides puis aux larves qui le rongeaient de l’intérieur. »
Une vie morne, vide et fermée où l’insolite s’invite, sous la forme d’une paire de pantoufles que Nuvem décide de s’offrir, d’une manière irraisonnée. Il ne s’étonne pas de l’étrange sollicitude du marchand de chaussures, qui l’invite bientôt au repas trimestriel du « club des pantouflards », un cercle fermé où les notables tirés à quatre épingles dînent et s’empiffrent de mets fins, pantoufles aux pieds. Cailles, grives, pigeons, faisans aux quatre choux, la nourriture abondante et choisie est dispensée par l’énorme Graziella. Quantité et qualité se conjuguent à la table : « un goûter composé de petits sandwiches au foie gras, de brioches, de choux à la crème, de crêpes, de babas au rhum, de petits-fours et de fruits confits, le tout arrosé de vieux porto et de muscat de Sardaigne. » Notre héros, qui a des prédispositions certaines pour la bonne chère, allume un Lusitania et boit de grandes rasades de Cognac.
Mais que vient-il faire dans cette galère, même aux allures de paradis gastronomique ? « Que pouvait valoir l’adhésion d’un chômeur, une de ces « âmes mortes » à peine bonnes à émigrer d’un fichier à un autre au gré des fluctuations d’une comptabilité d’actifs et de passifs que se jetaient sans cesse à la figure lors de joutes télévisées les dignes héritiers de l’escroc Tchitchikov ? » C’est là que le roman devient une fable politique angoissante : ce club ressemble en effet à une phalange secrète et présente une liste aux élections municipales, sans succès. Bientôt Effron Nuvem voit la ville basculer dans une organisation totalitaire dont il devient, grâce à ses relations pantouflardes, l’un des employés, affecté au service du broyage des documents administratifs. Un engin monté sur chenilles entièrement revêtu d’un blindage noir trône au milieu de la place du quartier, assurant la surveillance de la ville, et la délivrance d’argent et de formalités administratives par une seule et même carte de crédit, sésame contrôlé et délivré par les autorités, comme si dans ce pays venait de se réaliser la crainte du croisement des fichiers informatiques. « Dans cette masse de métal compact dépourvue de toute ouverture luisait une petite lueur rouge de la taille d’un œilleton. » Ce blindé est une belle trouvaille romanesque, big brother matérialisé dans un engin militaire, inamovible et menaçant.
Le héros ne s’en formalise pas, et ne se pose jamais de questions, content de sa tâche répétitive au sous-sol de la mairie. Autour de lui, les opposants se font d’ailleurs rares et peu combatifs, les belles âmes éprises de liberté attendant les beaux jours pour défiler dans la rue. « Maintenant que les gens retrouvaient leur climat habituel et que la douceur des températures incitait à sortir se promener, l’élite citoyenne de la population se sentait incommodée par la présence silencieuse mais insistante du blindé. » Mais après cette molle résistance, le confort prend le dessus, les commodités du système gagnent chaque jour les faveurs des plus contestataires.
Dans ce livre, de la taille d’une longue nouvelle, on retrouve l’originalité de l’inspiration et la maîtrise de l’écriture, le sens du fantastique et les talents de conteur de Cottet-Emard. Cette fantaisie si pleine d’humour et de portraits truculents (l’éléphantesque Graziella, le petit gros à moustache, le vieux maigre aux allures d’insecte) baigne dans une atmosphère kafkaïenne. A l’ouverture du roman, le nom de Nuvem disparaît d’un fichier d’ordinateur ; à la fin il est à nouveau supprimé : « crédit épuisé carte non valide ». Victime impuissante et quasi consentante d’une machination obscure, il n’est qu’un pion : « Les pantoufles d’Effron Nuvem arpentaient de vastes carrés de bitume qui passaient du noir au blanc, réduisant sa silhouette à celle d’un pion sur cet échiquier dessiné par la lune. » Le héros descend les neuf cercles de l’enfer, mais il n’est pas la seule victime dans ce monde cruel et burlesque où les rivalités pour le pouvoir autorisent tous les coups, jusqu’à l’élimination du concurrent ou du prochain.
Le rire que l’on éprouve à la lecture est vite mêlé de malaise et d’inquiétude, comme si nous étions plus proches de ce monde qu’on ne voudrait le croire, pas même à la distance d’un rêve ou d’un cauchemar. Cottet-Emard excelle à nous décrire l’individu broyé et effacé par la politique de l’absurde.
Le club des pantouflards, de Christian Cottet-Emard, Ed. NYKTA, collection Petite Nuit. 80 pages, 5 €.
Descriptif et références complètes sur le blog de l'auteur :
http://cottetemard.hautetfort.com/archive/2006/06/19/le-c...
19:25 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture
samedi, 24 mars 2007
Bukowski lit ses poèmes
Les fanatiques de Bukowski peuvent trouver sur le site Youtube plusieurs vidéos montrant l'auteur lisant ses propres poèmes.
Un exemple parmi bien d'autres :
Bukowski reads "The Secret of My Endurance"
18:00 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture, Poésie, Bukowski
mardi, 20 mars 2007
Revue de détail n° 7
(Ces chroniques sont parues dans La Presse littéraire n° 8.)
LA FAUTE A ROUSSEAU n° 42
 Revue de l’APA (Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique, désormais reconnue d’intérêt général), La Faute à Rousseau paraît trois fois par an. Diffusée aux adhérents, elle commence maintenant à être distribuée en librairies. Elle rend compte des activités de l’association, offre des notes de lectures et présente un dossier. Celui du dernier numéro, dans la continuation du précédent consacré au « Nom », explore le thème des « Familles ». « Le 13 juillet 1980, Julien Green note dans son Journal : « Quand j’ai demandé à Mauriac pourquoi il n’écrivait pas son autobiographie, il m’a répondu : Impossible. J’ai une famille. » Sans doute les familles n’apprécient-elles guère les autobiographies de leurs membres, dès lors qu’ils cherchent à dire leur vérité plutôt qu’à fixer l’histoire collective du clan. Sans doute aussi chacun doit-il construire son identité, trouver sa voie, à partir des histoires, projets ou conflits des générations antérieures. »
Revue de l’APA (Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique, désormais reconnue d’intérêt général), La Faute à Rousseau paraît trois fois par an. Diffusée aux adhérents, elle commence maintenant à être distribuée en librairies. Elle rend compte des activités de l’association, offre des notes de lectures et présente un dossier. Celui du dernier numéro, dans la continuation du précédent consacré au « Nom », explore le thème des « Familles ». « Le 13 juillet 1980, Julien Green note dans son Journal : « Quand j’ai demandé à Mauriac pourquoi il n’écrivait pas son autobiographie, il m’a répondu : Impossible. J’ai une famille. » Sans doute les familles n’apprécient-elles guère les autobiographies de leurs membres, dès lors qu’ils cherchent à dire leur vérité plutôt qu’à fixer l’histoire collective du clan. Sans doute aussi chacun doit-il construire son identité, trouver sa voie, à partir des histoires, projets ou conflits des générations antérieures. »
Beaucoup de collaborations sur ce thème, couvrant la période contemporaine. Le plus intéressant est le dossier « Classiques », avec les contributions sur Hugo, Sartre, Gide, Virginia Woolf, Mauriac. Philippe Lejeune livre un bel article sur Jean-Jacques Rousseau : « La faute à Rousseau, c’est d’avoir abandonné ses cinq enfants. La faute à Voltaire, c’est d’avoir révélé ce fait au public dans un pamphlet anonyme. Merci à Voltaire, qui poussa Rousseau à écrire, en réponse, ses Confessions. Merci à Rousseau de s’y montrer – c’était très nouveau pour l’époque – attentif à l’histoire de la personnalité, et sensible à l’existence de l’inconscient. » Et d’ajouter : « Lecteur des Confessions, je vais donc jouer mon rôle en remarquant un « enchaînement d’affections secrètes » qui a échappé à Rousseau, un chaînon manquant, une « disjonction » étonnante. Jamais, dans les Confessions, Rousseau n’établit de lien entre les deux faits suivants : il a abandonné ses enfants, mais il avait été lui-même abandonné par son père, comme le Petit Poucet. »
Sans tomber dans le piège de la spécialisation universitaire ou de l’hermétisme, La Faute à Rousseau offre un contenu accessible, riche et varié - seul un effort de mise en page reste à faire, pour éviter l’impression d’empilement des articles. Rappelons que l’APA, fondée en 1991 par Chantal Chaveyriat-Dumoulin et Philippe Lejeune, réunit actuellement plus de 800 membres adhérents. Son premier objectif est d’assurer la conservation des textes autobiographiques inédits rédigés par des personnes de tous milieux sociaux. La plupart de ces textes, malgré leur intérêt, ne pourraient pas trouver d’éditeur en raison du manque de notoriété des auteurs ; dispersés dans les archives familiales, ils sont menacés de disparition à plus ou moins long terme. Le lieu de cette conservation est la médiathèque municipale de la Grenette, dont une partie est mise à la disposition de l’APA par la municipalité d’Ambérieu-en-Bugey, près de Lyon. L’APA publie des comptes rendus des textes autobiographiques reçus (les échos) dans son « Garde-mémoire ». Elle offre en lecture son fonds, riche de plus de 2000 dépôts inédits, dont l’intérêt, au-delà d’un genre littéraire, est également historique et sociologique.
La Faute à Rousseau, APA, La Grenette, 10 rue Amédée-Bonnet, 01500 Ambérieu-en-Bugey. 84 pages, 9 €. http://sitapa.free.fr
LES MOMENTS LITTERAIRES n° 15 et n° 16
Projet original que celui de cette belle revue semestrielle animée par Gilbert Moreau, d’une présentation sobre et classique, « à l’ancienne », qui privilégie l’écriture intime et publie journaux intimes, carnets, correspondances et récits autobiographiques… prolongeant chaque fois une riche réflexion sur la source et les rites de l’écriture. Des dossiers ont été consacrés à Annie Ernaux, Gabriel Matzneff, Hubert Nyssen, Charles Juliet, Henri Bauchau…
Le numéro 15 donne à lire un dossier Rezvani, avec une introduction de Bertrand Py, son nouvel éditeur, des extraits des Carnets de Lula, sa femme défunte, et une interview de l’auteur pleine de fulgurances : « Je ne prémédite pas mon travail. Je me sers de la peinture, de l’écriture ou même de la musique comme moyen d’extraction de ce qui se passe dans mon esprit. Ce qui m’intéresse, c’est ce que je ne sais pas. Du moment où l’on se met à écrire, il sort de vous des choses tout à fait inattendues. Dans une lettre à sa sœur, Kleist écrivait « les mots tirent la pensée. » C’est ça qui est passionnant. » Rezvani établit des rapprochements et des comparaisons entre les divers arts qu’il a pratiqués pour définir l’écriture : « Quand je me suis mis à écrire, je me suis cru délivré de la matérialité, je pensais pouvoir écrire dans un bistro, en voyage… En réalité, pas du tout, je me suis aperçu que l’écriture était beaucoup plus prenante, ritualisée, qu’elle vous enferme, vous rend maniaque. » et son approche de l’ordinateur et du traitement de texte est originale : « Depuis quelques années, je me suis mis à l’ordinateur. C’est un moyen extraordinaire. Etrangement je trouve que le travail d’écriture devient comme de la sculpture avec de la glaise. A l’ordinateur, les phrases deviennent une matière, il y a un côté plastique assez extraordinaire. » Signalons dans cette même livraison de savoureux portraits par Robin Wallace-Crabbe, peintre et écrivain australien.
Le numéro 16 est consacré à une longue expérience d’écriture à quatre mains (expression qui m’a longtemps hérissé du temps de l’écriture à la plume mais qui retrouve un peu de vérité avec l’écriture au clavier, le rapprochement avec le piano devenant légitime) menée par Daniel Zimmermann et Claude Pujade-Renaud. Une aventure bien exceptionnelle car l’écriture est par essence un exercice solitaire. Hugo Marsan présente l’histoire d’amour et de littérature de ce duo littéraire, « la danseuse et le funambule, la bourgeoise et le prolétaire ». Là aussi, une interview pleine d’enseignements sur les pratiques d’écriture en commun, conduite. par Gilbert Moreau, et illustrée par des extraits d’un « cahier des rêves ». Claude Pujade-Renaud revient sur la genèse de cette collaboration : « Nous avons continué à nous montrer les ébauches de ce que nous écrivions chacun de nôtre côté. L’essentiel était l’existence d’un destinataire immédiat, une écriture avec l’autre, pour l’autre et d’une certaine façon contre l’autre parce que, inévitablement, s’instaurait un rapport de rivalité, de défi. » Pour elle le travail d’écriture est « toujours très long, très laborieux » et est incomparable avec la musique : « dans l’écriture, le signifiant est là, bête, épais, incontournable. »
Les Moments littéraires, B.P. 175, 92186 Antony Cedex. 128 pages, 12 €
http://perso.wanadoo.fr/les.moments.litteraires/
06:50 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Culture, Revue






