jeudi, 21 septembre 2006
Le Pal, de Léon Bloy
(Cet article est paru dans La presse Littéraire n° 6)
Le journalisme, voilà l’ennemi !
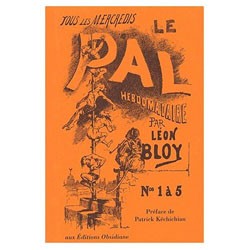 Les éditions Obsidiane ont republié en 2002, dans un singulier recueil tiré à 800 exemplaires, les 5 numéros parus du Pal, journal hebdomadaire pamphlétaire rédigé durant l’année 1885 par le seul Léon Bloy, financé sur ses propres deniers et échec commercial (le 5e numéro, écrit et composé, ne paraîtra pas.)
Les éditions Obsidiane ont republié en 2002, dans un singulier recueil tiré à 800 exemplaires, les 5 numéros parus du Pal, journal hebdomadaire pamphlétaire rédigé durant l’année 1885 par le seul Léon Bloy, financé sur ses propres deniers et échec commercial (le 5e numéro, écrit et composé, ne paraîtra pas.)
Armé de ses convictions et de sa foi, sans retenue ni prudence, dans le même style éblouissant que l’on aime dans ses œuvres (et Le Pal est une œuvre de création), Léon Bloy nous régale d’un jeu de massacre, règle ses comptes avec ses contemporains dont il fustige la tiédeur, la veulerie et les travers, sans épargner personne, homme de pouvoir ou homme du peuple.
La situation politique et morale de 1885 ressemble par bien des traits à celle d’aujourd’hui, comme si 120 ans après, la même décadence, la même déliquescence, et surtout la même médiocrité régnaient sur la France. A la médiocrité des hommes politiques qui ont suivi Napoléon (« Napoléon subsiste dans la mémoire humaine, tout en haut du siècle, et cela fait une sacrée sensation de contempler au-dessous de lui les affreux bonshommes qui gouvernent aujourd’hui la France. »), répond celle des hommes de tout bord qui ont succédé à de Gaulle. « Quant à l’autre qui contamine l’Elysée, n’en parlons pas. C’est déjà trop d’y penser. » L’irrespect dénoncé par Bloy semble être devenu la norme (« On ne pourrit pas assez tôt l’enfance, on n’assomme pas assez de pauvres, on ne se sert pas encore assez du visage paternel comme d’un crachoir ou d’un décrottoir. Mais le régime actuel va nous donner toutes ces choses qu’on entend déjà galoper vers nous. »), et les mêmes égoïsmes tiennent le haut du pavé. Bloy décrit une société solidaire dans la bassesse et l’abjection, dans la « salauderie morale », dans le rejet du sublime, qu’il soit de la foi ou de la culture, depuis les représentants politiques, lâches et corrompus, les bourgeois et les propriétaires terriens (« les possesseurs de la terre et les capitalistes, retranchés, barricadés dans la forteresse du plus immonde et du plus inexorable égoïsme »), le clergé (« le mur de soutènement du Clergé, masse étonnamment friable de médiocrité, de bassesse, de lâcheté ou d’infamie »), et jusqu’à ses frères catholiques qu’il vomit comme tièdes (« pseudo-catholiques dont l’unique fin terrestre est de jouir comme des pourceaux ») ; enfin, les arts prostitués ne valent guère mieux : « Enfin, dominant tout, flottant dans l’azur, claquant dans les vents, les torcheculatives oriflammes de la littérature contemporaine. »
L’une des causes (et des effets) de cette dégénérescence est à chercher dans le pouvoir de la presse, dont Le Pal constitue l’une des plus violentes dénonciations. Baudelaire l’avait déjà écrit : « Je ne comprends pas qu’une main pure puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût. » Bloy relève surtout, et c’est en cela sa formidable et cruelle actualité, sa vision prospective, le pouvoir sans limite et sans frein des journalistes, qui font l’opinion : « Le Directeur de journal est un monstrueux pouvoir tout moderne engendré de la basse Curiosité humaine et du Cynisme cupide de quelques ratés littéraires. » Les directeurs de journaux « sont réellement devenus aujourd’hui les arbitres de la planète. »
Si les lecteurs sont conscients de la médiocrité des journaux, ils ne peuvent pourtant s’affranchir de leur influence et de leur ascendant. Sans contrepouvoir, sans rien qui vienne enrayer son formidable développement, le journalisme se déploie comme un cancer et remplit tout l’espace : « Le Journalisme moderne que je prétends désigner assez de cette épithète lumineuse, a tellement pris toute la place, malgré l’étonnante petitesse de ses unités, que le plus grand homme du monde, s’il plaisait à la Providence de nous gratifier de cette denrée, ne trouverait plus même à s’accroupir dans le rentrant d’un angle obscur de ce lupanar universel des intelligences. » Ainsi dominateur, le journalisme accomplit son travail de sape, intoxiquant les esprits, notamment ceux des jeunes générations, détruit la culture et l’esprit au profit de la médiocrité et de la réclame. La pensée véritable n’a plus cours, n’a plus place, sauf à se prostituer, le combat est déjà perdu : « L’inutilité absolue de toute revendication pour la Pensée est désormais évidente jusqu’à l’éblouissement. » Pour collaborer aux journaux, il faut passer par « les argousins de la pensée », pitoyables agents de police, qui ramènent toute création à des dimensions médiocres, mais rentables. Ce que Bloy met bien en évidence, c’est l’alliance de la presse et du capitalisme, poussant à la consommation, et à la livraison de produits, jusque dans la littérature qui devient « industrielle », pratiquée par ceux qui ont su « pousser à la culture intensive du dividende ».
« J’ai longtemps cherché le moyen de me rendre insupportable à mes contemporains. » Ce qui surprend le lecteur moderne, avant toute incursion dans la pensée bloyenne, c’est le ton, à la fois une franchise sans concession (« Dire la vérité à tout le monde, sur toutes choses et quelles qu’en puissent être les conséquences. »), et une violence verbale, des portraits à charge qui vont jusqu’à l’invective, l’insulte (et malheureusement aussi, trait d’époque, au racisme anti-juif) qui seraient aujourd’hui inacceptables et inacceptés, les procès en diffamation pleuvraient et aucun media n’oserait prendre le risque de leur publication. Qu’on en juge par quelques amabilités que la verve et l’invention verbale, voire un génie comique, don propre au grand écrivain, transforment en gourmandise pour le lecteur :
« La face entièrement glabre, comme celle d’un Annamite ou d’un singe papion, est de la couleur d’un énorme fromage blanc, dans lequel on aurait longuement battu le solide excrément d’un travailleur. »
« Il lui pousserait des champignons bleus sur le visage que cela ne le rendrait pas plus épouvantable. Peut-être même qu’il y gagnerait… »
Autres temps, autres mœurs et autres relations. Ce jeu de massacre jouissif, cette « entreprise de démolition », cette volée de bois vert, ces atteintes qui ne craignent pas de s’attaquer aux personnes et à leur physique, sont désormais interdites. Les tièdes, qui gagnaient déjà en fait, ont depuis gagné en droit, instaurant leur tranquille dictature, interdisant sous peine de poursuites judiciaires à toute pensée incorrecte le moindre droit d’existence. Au pamphlet, au libelle, ont succédé l’assignation, le procès – voire la menace de procès qui joue le rôle de la dissuasion nucléaire - ; les avocats et les juges ont pris le pas sur les écrivains.
La préface de Patrick Kéchichian, confuse, n’apporte rien à l’ensemble, mais un journaliste, qui plus est employé au Monde, l’un de ces journaux qu’un nouveau Bloy ne manquerait pas d’éreinter, peut-il être à la fois juge du livre de Bloy et partie attaquée avec la dernière virulence ? Car, sous les noms de chroniqueurs aujourd’hui disparus, y compris des mémoires, sous les noms des journaux eux aussi disparus (à l’exception notable du Figaro), on retrouve une situation comparable à travers le temps, les mêmes pratiques, les mêmes combinaisons et lâchetés, les mêmes réseaux d’intérêt au service de médiocres.
Peut-on attaquer la presse par voie de presse ? s’étonne le préfacier, relevant « cette naïveté qui consiste à croire que l’on peut retourner l’arme de la presse contre elle-même ». Bloy, qui s’exprimerait peut-être de nos jours par la voie du blog, ce nouveau média qui reste pour l’instant (et pour combien de temps encore ?) un formidable espace de liberté, n’avait pas cette naïveté, mais il a profité d’un espace d’expression (qu’il s’est en fait payé, comme un luxe), d’une trouée, pour lancer ses flèches. Empoisonnées au curare de la vérité, elles continuent d’agacer ce corps encombrant et dominateur de la presse qui n’en finit plus de survivre sur l’insolente santé de sa gangrène. « Le Journalisme accomplit donc sa destinée sans que rien le déconcerte ni le trouble, semblable à toute vermine sourde et aveugle qu’aucune clameur terrestre ne peut détourner de son travail de destruction. »
Léon Bloy, Le Pal, éditions Obsidiane, 18 €
18:59 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Culture
mardi, 05 septembre 2006
Revue de détail n° 5
(Cette chronique est parue dans La presse Littéraire n° 6 )
BREVES n° 76 et 77
 Depuis la disparition du magazine Nouvelle Donne, Brèves reste en France la seule revue consacrée à la nouvelle qui bénéficie d’une véritable diffusion, puisqu’elle est distribuée en librairies par Dif’Pop. Elle se veut à la fois une anthologie permanente de la nouvelle et le reflet de son actualité. Son exceptionnelle longévité est le signe de sa qualité constante et du dynamisme de ses animateurs, Martine et Daniel Delort.
Depuis la disparition du magazine Nouvelle Donne, Brèves reste en France la seule revue consacrée à la nouvelle qui bénéficie d’une véritable diffusion, puisqu’elle est distribuée en librairies par Dif’Pop. Elle se veut à la fois une anthologie permanente de la nouvelle et le reflet de son actualité. Son exceptionnelle longévité est le signe de sa qualité constante et du dynamisme de ses animateurs, Martine et Daniel Delort.
Le n° 76, entièrement consacré à la Norvège, à ses nouvellistes, fait partie de ces numéros spéciaux sur un seul pays (Chicanos d’origine mexicaine, Bulgarie..). On y découvre entre autres Laila Stien, Roy Jacobsen, Liv Koltzow et on apprend qu’il existe trois langues en Norvège : le bokmal, langue citadine fortement influencé par le danois, le nynorsk ou néo-norvégien fondé sur les dialectes locaux et parlé dans la plus grande partie du pays, le sami parlé par les Lapons. Sans compter l’anglais, présent quotidiennement dans la vie des Norvégiens. Cette livraison donne vraiment envie d’aller à la rencontre de ce pays indépendant depuis 1905 et dont la littérature reste dominée par la stature du dramaturge Henrik Ibsen.
Le n° 77 comprend un dossier spécial Sepulveda. Homme « engagé » qui écrit pour témoigner des périodes troubles de notre histoire, pour ne pas oublier, mais aussi parce que la langue est sa patrie, Luis Sepulveda ouvre ici « le plus infini des horizons : celui de la créativité littéraire ». Dans un entretien avec Boris Beyssi, il s’explique à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Une sale histoire ». Sa déclaration sur l’engagement - même si on la comprend au regard des épreuves vécues par le Chili - peut être largement contestée : « On a d’abord des devoirs civils avant d’avoir des devoirs littéraires. C’est l’homme avant l’écrivain. Pour moi, ce qui est important, c’est que l’écrivain comprenne qu’il est d’abord un citoyen. » On pourrait lui opposer que l’écrivain, en guerre d’abord contre lui-même, mène un combat purement littéraire qui excède la politique.
Brèves comprend aussi une rubrique d’actualité critique « Pas de roman, bonne nouvelle ! », sur les derniers recueils de nouvelles parus, et des informations sur la vie littéraire. Un mini-dossier est consacré à l’aventure de Lekti-écriture et à une interview de son fondateur par Blandine Longre. Lekti-écriture, (www.lekti-ecriture.com) fondée en 2003 par Joël Faucilhon, propose des espaces aux éditeurs indépendants francophones : près d’une trentaine - dont l’Atelier du gué - sont aujourd’hui regroupés en collectif autour de Lekti, une démarche leur permettant de défendre leur travail de découvreurs et de passeurs, de mieux communiquer autour de leurs parutions et de leurs catalogues et de promouvoir ces derniers auprès du grand public (et pas seulement auprès de petits cercles de lecteurs déjà conquis). Lekti vient récemment de mettre en place sur son site un module commercial sécurisé qui devrait permettre aux lecteurs potentiels de commander les ouvrages proposés par les éditeurs membres (plus d’un millier de titres) auprès de la librairie indépendante Clair-Obscur à Albi ; Internet permet ainsi de contourner les difficultés actuelles de diffusion des petits éditeurs en librairies. L’expérience dira si ce n’est qu’un site marchand de plus, perdu dans la masse de l’Internet, ou si le bénéfice est réel en termes de visibilité pour les petits éditeurs.
Des auteurs français (Hélène Duffau, Philippe Saulle, Claire Julier, Jean Guiloineau, Jacques Bruyère) complètent cette livraison. Dommage que Brèves, ouverte sur l’international et le présent, n’explore pas aussi les auteurs méconnus de notre patrimoine (sauf une rubrique « Relire » assez rare et mince qui nous a fait redécouvrir Jean Richepin, par exemple) ; j’eus aimé découvrir ainsi par eux l’une des « histoires désobligeantes » de Léon Bloy.
Les éditions de l’Atelier publient depuis 1975 des recueils et des essais, dont un domaine important de littérature étrangère, notamment irakienne et mexicaine.
Brèves, Atelier du gué éditeur, 1 rue du Village, 11300 Villelongue d’Aude. 140 pages. 12 €. Diffusion en librairies Dif’Pop. www.atelierdugue.com
VOIX D’ENCRE n° 34
 Sous une couverture originale bleu sombre et argent, cette revue semestrielle propose aux poètes français et étrangers un espace typographique ouvert à la création d’aujourd’hui, en vers ou en prose. Elle dépend de la maison d’édition Voix d’encre, animée par Alain Blanc, qui publie des recueils de poésie (notamment d’Alain Borne, une grande voix trop méconnue) et de nouvelles. Avec cette belle profession de foi : « Publiant, nous donnons à lire ce que nous aurions tant voulu écrire, ce qui se glisse jusqu’aux nappes profondes de notre être ; publiant, ce sont mille et mille miroirs que nous tendons. »
Sous une couverture originale bleu sombre et argent, cette revue semestrielle propose aux poètes français et étrangers un espace typographique ouvert à la création d’aujourd’hui, en vers ou en prose. Elle dépend de la maison d’édition Voix d’encre, animée par Alain Blanc, qui publie des recueils de poésie (notamment d’Alain Borne, une grande voix trop méconnue) et de nouvelles. Avec cette belle profession de foi : « Publiant, nous donnons à lire ce que nous aurions tant voulu écrire, ce qui se glisse jusqu’aux nappes profondes de notre être ; publiant, ce sont mille et mille miroirs que nous tendons. »
Denis Langlois nous livre ses aphorismes et pensées : « Il est heureux que Jésus soit mort jeune. Il aurait été capable de fonder une Eglise. » ; « Se demander ce qui aurait changé si l’on n’était pas né. Réfléchir longuement. Conclure que le supermarché du coin aurait eu un chiffre d’affaire légèrement inférieur. » On le voit, l’humour n’est pas absent, contrairement à d’autres revues poétiques qui cultivent l’austérité. Il voisine avec une poésie rigoureuse (Catherine Baptiste, Emmanuelle Rodrigues, Jean-François Perrin, Laurent Contamin, Pavie Zygas, Elaèle Monvalezan) que la mise en pages élégante et aérée met particulièrement en valeur. De belles photos de Philippe Thomassin occupent un cahier central « Le calcul, l’imprévu, l’irréel ». Au service de « l’utopie concrète », cette maison fondée en 1990 permet aux créateurs de dialoguer dans des livres à trois voix, celles de l’artiste et du poète, celle de l’éditeur.
Voix d’encre, B.P. 83, 26202 Montélimar Cedex. 64 pages, 10 €.
07:05 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture
samedi, 02 septembre 2006
L'autoroute (extrait 1)
La station où il échoue en ce début d’après-midi est vaste et quasi déserte ; un mini-centre commercial la jouxte : autour d’un hall circulaire aux lumières de couleur, quelques boutiques spécialisées sur deux étages. L’une d’entre elles propose des livres et des journaux. Il entre, lit les titres, les quatrièmes de couvertures, feuillette à peine. Ce n’est pas l’une de ces immenses librairies du centre-ville qu’il fréquentait autrefois, ces vastes librairies réparties sur plusieurs étages, PRIVAT-FLAMMARION, FNAC, DECITRE, où il retrouvait les classiques, s’informait des nouveautés. Mais cette boutique étroite mérite cependant l’appellation de librairie, au moins par la variété et le choix des livres de poche exposés, parmi lesquels il reconnaît quelques titres qu’il a tant aimés, comme Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry.
Il ne lit plus de littérature, aucun livre ne traîne dans la voiture, aucun dans son sac de voyage, qui ne contient que des effets utiles. La littérature aussi est un leurre, les mots sont de trop, ils ne sont d’aucun réconfort ni d’aucun secours quand la vie se déchirant s’ouvre sur le vide, quand il ne reste plus qu’à fuir.
En piles sur les tables ou alignés sur leurs tranches dans les rayonnages, les livres ne sont plus que des objets matériels de papier, d’encre et de colle, clos sur eux-mêmes : des boîtes de stockage, des mémoires commodes, infréquentées, des stocks de signes noirs recroquevillés, desséchés, qui ont perdu toute signification ; en les tenant ouverts à une distance suffisante, ou même à bout de bras pour ceux qui sont écrits en plus petits caractères, on ne distingue plus qu’un grisé typographique, une alignée de bandes grises sur le champ de la page blanche.
Lire, écrire. Toute son existence, hors le temps compté du travail salarié, tenait entre ces deux pôles, dans ces deux passions. Il imaginait une vie dans les livres. Leur présence rassurante, dressant des murs, des briques de papier autour de lui, l’isolant de la violence et du désordre du monde. Il voulait en écrire, en éditer ; il a essayé, échoué, essayé encore entre les phases de découragement, des projets de livres qui sont restés à l’état de manuscrits, des fantômes de livres, des esprits errant sans sépulture, loin de tout corps édité. Tout est resté en lui, pour lui, comme un souvenir non partagé. Ce fut longtemps le regret de sa vie, cet échec dans la littérature, mais désormais ça n’a plus de sens, des œuvres même éditées ne lui seraient d’aucun secours, les livres ne sont que des objets sans importance, des petites briques, édifiées sur un gouffre, sur la margelle du gouffre qu’ils prétendent en leur déraison folle contenir, mais c’est le gouffre qui les happe et les digère. Il ne croit plus au pouvoir de la littérature. Les livres sont tombés. Le gouffre l’a rattrapé. Il est dans son œil, aspiré dans son tunnel. Entre ses bandes blanches latérales et ses rails d’acier nu, sur la lame de bitume noir horizontal dont le rayon droit plonge sous l’horizon froid, rejoignant le fond du monde visible. Il n’y a pas d’autre voie, celle-ci suffit à son attente. La voiture s’y engage, lestée de son corps déjà vieux, de sa vie passée, de son impénétrable destin. Il s’en remet à cette course, au seul mouvement, qui ne va jamais que dans un seul sens, vers l’avant, vers la fin qui vient à notre rencontre même si l’on est immobile. Il n’y a pas d’autre sens. Les choses sont irréversibles. Et si par la pensée ou par la magie de l’écriture on croit parfois retourner dans le passé, retrouver l’oasis du souvenir, remonter sa vie, le courant à rebours, ce n’est qu’une illusion, on croit remonter le cours du temps alors qu’on le descend inexorablement, c’est encore un mouvement vers l’avant qui permet à l’esprit d’aller vers l’arrière, c’est toujours par le détour du futur que l’on revient dans le passé, sur la page vierge à venir que l’on consigne les mots d’une vie déjà morte.
(extrait d'un roman en cours d'écriture)
07:10 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture, Nouvelles et textes brefs
mercredi, 30 août 2006
Lyon Part-Dieu
Un nouvel album-photos dans la colonne de droite : quelques vues du quartier de la Part-Dieu, à Lyon.

07:03 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Culture
dimanche, 27 août 2006
Hommage à Jacques Simonomis, par Georges Cathalo
Un grand singulier pas ordinaire du tout
En 1976, en ouverture à son deuxième recueil, Simonomis écrivait : "Avec l'amitié du papier, j'ai voulu rester propre et entier, dosant VISCERALEMENT la fraternité et la méfiance, la foi et le doute, la voix des foules et la solitude". On pouvait déjà noter l'insistance avec laquelle il avait tenu à isoler en lettres majuscules l'adverbe de cette phrase. Mieux qu'un symbole : une orientation pour toute une œuvre à venir. Un peu plus loin dans ce recueil de jeunesse, il écrivait encore : "Si tu n'apportes rien / pourquoi veux-tu que l'on te donne." Avec cette affirmation, Simonomis prolongeait ses choix, en parfait autodidacte généreux, indépendant, libertaire.
Authentique humaniste, il se voulait aussi "irrégulier du langage". Son œuvre qui comporte actuellement 33 titres compose une mosaïque originale dans le pâle concert des publications contemporaines. Pourtant, Simonomis n'a jamais cherché à construire une œuvre : les choses se sont faites peu à peu, dans une diversité d'intérêts et de passions, sans calcul, pour aboutir finalement à un ensemble inclassable, véritable casse-tête pour les étiqueteurs patentés.
*
"Les poètes marchent à l'amitié" écrivait Simonomis, et il était l'un des plus assidus à user de ce carburant écologique, générateur d'enthousiasme et de vitalité. Les gens de sa parentèle, on les connaît, on les devine : ce sont Rabelais, Corbière et Cros, mais aussi Rictus, Couté et Bizeau. Dès ses débuts, il avait été reconnu par quelques grands aînés tels que Jean Cassou, Marcel Béalu ou Jean Rousselot. Autour de lui, il avait su créer un réseau d'amitiés pour construire une réserve privée autour de dizaines de poètes actuels tels que Chatard, Huglo, Despert, Monnereau, Taurand et de tant d'autres encore que les distingués intellocrates sorbonnards s'ingénient à ignorer lors de leurs recensions et célébrations poétiques, occupés qu'ils sont à examiner leur nombril.
*
Quand il décida, en 1993, de se lancer dans l'aventure revuistique, Simonomis n'imaginait pas du tout dans quelle voie il s'engageait. "Le Cri d'Os", titre étonnant et un tantinet provocateur emprunté à Tristan Corbière, allait devenir sa "chose". La diriger seul pendant dix ans relevait de la folie et du sacerdoce. Seul, sans aide d'aucune sorte, envers et contre tous les importuns et les grincheux, il allait poursuivre sa route avec inconscience et courage, avec folie et témérité. Puis, alors que tout allait bien, il décida d'interrompre la publication, usé par l'égocentrisme et la mégalomanie de beaucoup de prétendus poètes.
"Je ne suis ni aigri, ni amer. Mais soulagé", écrivait-il. Qui connaît le fonctionnement d'une revue comprendra facilement cette décision. L'animation d'une publication périodique exige un travail de titan : des centaines et des centaines d'heures bloquées sur les écrits des autres, tenir à jour le courrier, relancer les abonnés oublieux…. Sa revue, Simonomis la voulait, dès l'éditorial du n° 1, "modeste mais fervente". Cependant, il ne perdait jamais sa belle lucidité puisqu'il écrivait : "Je ne veux pas mourir dans la peau d'un revuiste mais dans celle d'un poète indépendant". On voit bien en cela qu'il avait su rester fidèle à ses convictions de jeunesse, à ses passions, à ses amours et au grand amour de sa vie : Yvette.
"Ma balise de survie est un couple uni" : c'est à partir de cette solide fondation affective que Simonomis a réussi tout ce qu'il a entrepris. Sa seule inquiétude, disait-il, était la peur de laisser Yvette seule, démunie face à la dureté de la vie. Il savait à quel point il lui était redevable et que, sans sa présence fervente et rassurante, il n'aurait jamais pu aller jusqu'au bout de ses folles entreprises. Yvette, c'était pour lui bien plus que l'épouse patiente et attentionnée. Yvette, surnommée le Colibri, c'était toute sa vie, celle, disait-il, "sans laquelle je ne serais pas tout à fait".
*
Le dernier courrier qu'il m'avait adressé, en date du 22 janvier 2005, était rempli d'ombres et de non-dits. Toujours actif et généreux, il me remerciait pour un article sur "Claudication du monde", article paru dans le n° 99 de Rétro-Viseur. Un peu plus loin, il poursuivait :"J'ai frôlé la camarde après mon opération du 30/11. Je continue le combat. J'aimerais encore vivre quelques années." Ces paroles résonnent désormais dans un terrible silence.
Georges Cathalo - octobre 2005
(ultime courrier à Jacques Simonomis)
Cher Jacques,
nous sommes le lundi 21 février 2005. Il est 16 heures. Avec Marie-Claude, nous nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute après un périple de 600 kilomètres. Depuis notre Citadelle, nous sommes en transit vers la Normandie, le Pays d'Auge où nous attendent nos enfants et petits-enfants. Tu sais que nous avions prévu de nous retrouver du côté de Villers-sur-mer où tu as un pied-à-terre. Oui, nous avions prévu cela, mais ce ne sera plus possible…
En effet, à l'heure qu'il est , quelque part dans Paris, du côté du Pére-Lachaise, tu es conduit, comme l'on dit, vers ta dernière demeure, entouré, je le devine, par des proches et par des amis. En cet instant terrible, des dizaines d'images me passent par la tête : tes livres, tes revues et leurs coups de gueule, tes courriers et les qualités humaines qui transpiraient à chaque ligne. A ce moment précis, je voudrais tant être chez moi, pouvoir retrouver tout cela, des mots et des images, des souvenirs et des illusions. Retrouver tout cela et une lettre en particulier, un courrier lumineux dans lequel tu écrivais qu'il fallait faire les choses quand il le fallait, profiter de la vie au moment où elle nous sourit.
Alors, assis bêtement sur un sinistre banc, je pense à ce rendez-vous manqué sur la côte normande…
A bientôt, cher Jacques, ici, ailleurs, nulle part,…
Georges
*
Voir également sur ce blog :
Sur le blog de Casse :
07:47 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Culture, Poésie
vendredi, 25 août 2006
Le nouveau blog de Michel Houellebecq
Houellebecq est égal au meilleur de lui-même dans son nouveau blog, Mourir II. Il aborde, entre autres choses, le lynchage médiatique dont il a été victime lors de la sortie de La possibilité d’une île, l’adaptation de ses livres au cinéma, sa rencontre avec Maurice Pialat, et ses difficultés pour la réalisation du film qu’il voulait tourner : « Il semble aujourd’hui acquis que malgré les promesses formelles, tant écrites qu’orales, d’Arnaud Lagardère, le groupe Hachette ne participera pas au financement du film tiré de “La possibilité d’une île”. »
12:52 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Culture
jeudi, 24 août 2006
Une condition d'écrivain, mais pas de statut
“Les intermittents ont un statut, pas les écrivains.”
Loin des confortables à-valoir d’une poignée d’auteurs stars, 98 % des écrivains exercent une autre activité professionnelle pour gagner leur vie. Le sociologue Bernard Lahire s’est penché sur leur quotidien dans son étude, La Condition littéraire. Les témoignages qu’il a recueillis mêlent bonheur d’écrire, frustrations, quête de reconnaissance et volonté d’indépendance.
Un article très intéressant à découvrir dans Télérama :
11:25 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (11) | Tags : Littérature, Culture






