mercredi, 09 mars 2005
La double mémoire de David Hoog
Après un premier article sur le recueil de nouvelles "Douze mètres cubes de littérature", je reproduis un article sur un autre livre de Roland Fuentès - chronique précedemment parue dans la revue Europe n° 907-908
 Roland FUENTES, La double mémoire de David Hoog, A contrario, 14 €.
Roland FUENTES, La double mémoire de David Hoog, A contrario, 14 €.
Après quelques recueils de nouvelles confidentiels et une belle reconnaissance par le prix Prométhée de la Nouvelle (« Douze mètres cubes de littérature », paru aux éditions du Rocher), Roland Fuentès livre un nouvel ouvrage, un court roman, chez A contrario, éditeur littéraire qui vient de démarrer ses activités en Saône-et-Loire.
Un livre qui nous séduit d’emblée par son inspiration fantastique (il se place dès la citation en exergue sous le signe de Kafka) et son style littéraire sans concession aux maux de l’époque, la facilité et la vulgarité. L’écriture est dense, recherchée sans être précieuse, comme une politesse que l’on rend au lecteur.
Au cours d’une plongée dans les calanques de Marseille, David Hoog a repêché une boîte contenant un message qui lui est destiné. Par ce message, un autre être récemment décédé, un certain Wolf, activiste d’extrême-droite, tente de revivre dans et par Hoog en prenant possession de son esprit. Une jeune fille mystérieuse, Jeanne (dans laquelle s’est réincarnée la compagne morte de Wolf) participe à cette entreprise dévastatrice en le nourrissant de lectures xénophobes. Elle tisse une toile patiente, Hoog perdant progressivement sa mémoire originelle au profit d’une autre, étrangère. Mais son ami d’enfance Bobo, un africain, l’aide à lutter contre cette emprise et à rester fidèle à ses souvenirs.
L’histoire est une sorte de Horla moderne, le héros étant gagné par un autre qui veut prendre sa place. Hoog est pris entre deux passés, deux rêves dont l’un se révèle cauchemar. Mais ce Horla contemporain connaît une fin heureuse, le bien l’emportant au terme d’une lutte très manichéenne (la pitié contre la haine).
On l’avait constaté dans les nouvelles composant le précédent recueil « Douze mètres cubes de littérature » : la psychologie intéresse peu Roland Fuentes, et si l’on privilégiait cette lecture, les caractères (la haine comme seul sentiment du militant extrémiste, la générosité caractérisant l’immigré, etc.) apparaîtraient simplistes. Ce livre est plutôt la chronique des combats pouvant se livrer dans un esprit, et la métaphore de la mer et du plongeur, très présente, n’est pas fortuite. David Hoog découvre lors d’une plongée la boîte contenant le message fatidique par lequel Wolf prend possession de son âme ; à la fin du roman, pour parachever sa victoire sur lui-même, il retournera sous les eaux afin de replacer la boîte où il l’avait prise ; mieux, il la fera glisser dans une fosse sous-marine d’où nul ne pourra plus l’extraire, comme dans les profondeurs les plus secrètes de l’inconscient.
Les descriptions sont particulièrement originales chez Fuentès, car elles ne s’attachent pas au contour objectif des choses ni à leur relevé topographique. L’action se passant à Marseille et dans sa région, tout est dominé par la lumière, le soleil et la mer qui deviennent des composantes du livre. Ce ne sont pas les lignes et les courbes des objets qui se précisent, mais les taches de couleur, les éblouissements de lumière. « Le soleil coule sur la vitre. Du jour fondu se répand dans la pièce. » Ce ne sont pas des paroles distinctes qui se détachent, mais des bruits, des sons, des échos. « Les mots s’évaporent par le toit, le vent les livre en pâture aux oiseaux. » Les corps subissent les variations du vent, de la chaleur ou de l’eau glacée. L’écrivain est un appareil enregistreur des sens, un kaléidoscope de sensations, comme s’il était au centre d’un monde plus global que le simple monde articulé.
Par ce bref roman poétique et maîtrisé, Fuentès confirme ses dons et occupe désormais une place originale et bien affirmée dans le domaine du fantastique littéraire.
20:40 Publié dans Lectures | Lien permanent
jeudi, 27 janvier 2005
Le nouveau Journal de la Culture (n° 12)
 Nouveau, le Journal de la Culture ? Pas vraiment, car il compte déjà 12 numéros. Nouvelle formule, assurément, depuis le n° 11, puisque le journal mensuel s’est transformé en revue bimestrielle, gagnant en présentation, en densité.
Nouveau, le Journal de la Culture ? Pas vraiment, car il compte déjà 12 numéros. Nouvelle formule, assurément, depuis le n° 11, puisque le journal mensuel s’est transformé en revue bimestrielle, gagnant en présentation, en densité.
La véritable nouveauté de cette revue littéraire et culturelle (la littérature occupant la place essentielle) tient dans la diversité, l’ouverture et la liberté de ton, affranchie de ces dogmes qui plombent la vie culturelle et réduisent nos horizons livresques. A l’heure où le politiquement correct se décline en littérairement correct, alors que les luttes sectaires de chapelles et de réseaux rabaissent la critique littéraire à un vaste trafic d’influences, il est réjouissant de découvrir un espace libre réunissant des sujets aussi différents que Jean Ferrat et Jean-Marie Rouart, des études sur Proust, Marguerite Duras et Beckett, des articles de controverse sur Nabe, un cahier critique consacré à des auteurs aussi divers que Sylvie Germain, Henri Thomas, Renaud Camus ou Alberto Bevilacqua. Sans oublier la note d’humour « Contrefaçons », toujours réussie, due à D.J Zukry et Raphaël Juldé.
La revue tient les promesses de la belle profession de foi affichée en quatrième de couverture : « Ni guide ni vade-mecum du prêt-à-penser, éclectique, passionné, ouvert à toutes les tendances, nécessairement subjectif dans ses choix et ses approches éditoriales, le JC a pour seule ambition de donner à lire, à voir et à entendre en allant à la découverte – ou à la redécouverte – sans a priori ni parti pris, de la culture dans toutes ses composantes. »
On trouve dans le Journal de la Culture, animé par Joseph Vebret, un respect fondamental pour la création, une curiosité sans exclusive ni limite, qualités qui surprennent, enchantent dans l’univers étroit et convenu des magazines littéraires.
09:55 Publié dans Lectures | Lien permanent
vendredi, 07 janvier 2005
Like a Rolling Stone
En contrepoint de mon amour de la littérature, ma passion pour les Rolling Stones, depuis plus de trente ans. Je reproduis cet article paru dans Europe, sur une biographie qui m’a inspiré un roman humoristique inédit.
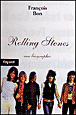 Rolling Stones, une biographie, par François Bon (éditions Fayard)
Rolling Stones, une biographie, par François Bon (éditions Fayard)
Aucun roman n’approchera jamais la vie des Rolling Stones, la vie de chacun des membres du groupe mythique, et surtout celle des deux âmes fondatrices, le noyau noir, Mick Jagger et Keith Richards. Faiblesse de la fiction, qui n’aura jamais l’imagination et la puissance de l’Histoire, ou du réel qui s’emballe. Ils auront tout connu, des premières piaules sordides aux paradis pour milliardaires, en passant par la case prison. Cent vies dans une seule, une légende au quotidien, où se heurtent les fuseaux horaires, les cultures, les rencontres essentielles : cette folie, cette frénésie, l’excès revendiqué (sexe drogue et rock ’n roll) comme image de marque, fondent l’histoire des Stones.
Ecrire la biographie de ce groupe était un pari difficile, risqué. On ne dira jamais assez à quel point François Bon a effectué un travail admirable, et fou, maniaque, d’avoir rassemblé une telle documentation, confronté les versions et les sources, recherché la vérité ou la vraisemblance, pour reconstituer un réel plus fort que toute fiction, composer à la fin une ébouriffante saga, avec toutes ses composantes, ses rebondissements et ses drames, gloire, amitié, trahison, déchéance, fourmillant d’anecdotes, de détails, une suite ordonnée de détails révélant à la fin, comme un puzzle reconstitué, une figure et son sens. 650 grandes pages bourrées de mots, pas d’iconographie, rien que des mots, mais il fallait une telle démesure, pour épouser celle de l’aventure musicale et sociale du plus grand groupe de rock ’n roll du monde.
Portrait du Londres des années 60, vivant, grouillant, novateur, avant qu’il ne devienne la vitrine touristique de ce qu’il a été, portrait des pays que les Stones traversent et conquièrent, défilé de figures et de destins croisés, cet ouvrage de lucidité patiente et méthodique est rendu possible par le recul historique, le phénomène aujourd’hui presque refroidi, bien que vivant encore ses prolongements répétés, les soubresauts de son cirque et de sa machine à dollars.
A quoi tient le succès des Stones ? La question est plus fondamentale qu’il n’y paraît. Un son original, fort et lourd, une présence scénique, un goût étudié pour le scandale. Et l’art de se renouveler dans la continuité pour durer. Mais cela ne suffit pas à forger une légende. Par la notation patiente de tous les faits, par le croisement de leurs fils, Bon démonte les arcanes d’une réussite, nous la décrypte : en plus de l’idée fixe et de la volonté sans faille des acteurs principaux, en plus du travail obstiné, il faut un singulier entrecroisement de hasards, de rencontres, de chances pour que les choses soudain « prennent », il faut se trouver aussi à un moment historique, dans le sens du mouvement des choses qui vont basculer, à l’endroit voulu, au moment voulu, et devenir le symbole de ce mouvement. L’extraordinaire succès des Stones n’est pas lié à la valeur individuelle de ses membres, chacun n’étant pas le meilleur de sa catégorie, c’est l’alchimie de leur groupe qui fait la différence et la supériorité radicale. Le rôle du collectif est affirmé dans la lente construction de la réussite : loin de l’image d’un écrivain qui œuvre dans la solitude, sans conseil ni témoin, les musiciens rock créent ensemble, progressent ensemble, se corrigent l’un l’autre, bénéficient des conseils et des critiques de tout un environnement : manager, producteur, arrangeur, techniciens du son, autres musiciens professionnels... Mais le phénomène exceptionnel de ce groupe, son occupation du temps (40 ans) et de l’espace mondial ne s’expliquent pas seulement par la valeur collective de ses cinq membres et de tout leur staff, même si l’on se rapproche ainsi de la vérité ; le succès des Stones, jouant sur la crête avancée de la vague qui les emporte et les dépasse, tient à un mouvement de foule, une hystérie collective, une mutation sociale qu’ils ont su pressentir, capter, incarner et précipiter.
Des scènes très dures, sans pitié, traversent et composent leurs vies. Théâtre de la cruauté, leur route, jonchée de laissés pour compte et de cadavres, se poursuit selon une sélection impitoyable, on ne s’encombre pas des amitiés, des amours, on emprunte toujours la voie la plus profitable sur le moment, quitte à renier, à abandonner, à trahir ceux qui vous avaient amené jusqu’ici, à jeter ceux qui vous ont servis et propulsés mais qui deviendraient des poids pour l’étape ultérieure. Les Stones eux-mêmes sont victimes de cette cruauté, sans considération pour leur statut d’idoles : l’héroïne et l’alcool qui les détruisent, la rapacité des producteurs qui les exploitent et détournent plus de la moitié de leurs bénéfices.
Musicien à ses heures, véritable amateur de musique (et la précision technique de son vocabulaire l’atteste, sa connaissance amoureuse des instruments et de la manière d’en jouer), François Bon a un immense respect pour le batteur Charlie Watts, une admiration pour Keith Richards, et il analyse très bien la spécificité du son des Stones, ce qui fait leur marque de fabrique : « Les guitares assurent la charpente du rythme, et la batterie chante sur la hachure des cordes, au lieu du contraire habituel, d’instruments qui se basent sur la cadence du batteur. » ; s’il rend compte ainsi de l’originalité musicale qui est l’une des composantes de leur succès, il n’insiste pas assez sur l’importance de Mick Jagger. Le chanteur n’est pas qu’une voix, c’est une manière de chanter, de danser, de paraître, et tout le visuel du groupe. Le spectacle, le sexuel et le scandale. Car sans Jagger, son intelligence intuitive qui tient aussi de la rouerie, son génie de l’air du temps, les Stones seraient devenus un grand groupe musical, mais un moindre phénomène.
On découvre dans cette somme considérable de puissantes perspectives historiques, l’analyse de mutations plus importantes par leur caractère de masse que les actions des chefs d’Etats : la libéralisation des mœurs, la révolution de la jeunesse (ce réveil qui se manifestera quelques années plus tard par Mai 68 en France), le déclin de la langue française, et donc de la culture française, par le formidable écho qu’ont rencontré les Beatles, les Stones et d’autres groupes anglais : ils ont durablement modifié l’équilibre mondial des langues, et assis la prééminence de l’anglais. La force d’une langue (et de la puissance linguistique dépend largement la puissance économique) tient surtout à ses artistes.
Une seule réserve : pourquoi cette écriture lourde (aggravée par les très nombreuses coquilles de cette première édition), d’une syntaxe contrariée, pourquoi se forcer à écrire relâché (un comble) ? Pour sacrifier à quelle mode ou se mettre à quel niveau Bon veut-il faire oublier qu’il est un écrivain ? Ou peut-être veut-il trop le prouver en cherchant un style rugueux qui épouse le sujet (l’équivalent du son des Stones ? un ton rock ?), ne créant finalement que des difficultés de lecture.
On passera sur cette réserve pour ne retenir que le roman fabuleux d’une époque, et quand cette époque a été celle de son adolescence, on s’approprie ce livre où, lisant l’histoire des années 60 et 70, et redécouvrant les galettes noires de vinyle qui sont nos petites madeleines de Proust, on se retrouve si loin de Londres ou du monde, dans un coin isolé de sa province, au temps de sa jeunesse, écoutant sur un pick-up Brown Sugar ou Jumpin’ Jack Flash pour rythmer ses rêves.
Paru dans Europe n° 883-884 (novembre-décembre 2002)

06:27 Publié dans Lectures | Lien permanent
lundi, 03 janvier 2005
Douze mètres cubes de littérature
Roland FUENTES, Douze mètres cubes de littérature, Le Rocher, 17 €.
 Voici plusieurs années que l’on voit revenir le nom de Roland Fuentès au sommaire d’anthologies ou de nombreuses revues (dont la NRF, Nouvelle Donne), et ses textes ont commencé à être rassemblés en quelques plaquettes à tirage confidentiel qu’il a, avoue-t-il avec humour, « refourguées à sa sœur, à sa mère, aux copines de sa mère, à son cousin, à sa grand-mère et à quelques copains magnanimes ». Ce dernier recueil de nouvelles intitulé « Douze mètres cubes de littérature » a reçu le prix Prométhée de la Nouvelle, décerné par l’atelier Imaginaire sur manuscrit, et vient de paraître aux éditions du Rocher. On sait que le prix Prométhée inverse le circuit traditionnel de l’édition : ce n’est pas un professionnel, plus ou moins soumis à des impératifs commerciaux, qui tente d’imposer ses choix au public, mais un jury de lecteurs qui se rassemblent pour choisir qui doit être publié. Cette édition vient consacrer heureusement un talent singulier.
Voici plusieurs années que l’on voit revenir le nom de Roland Fuentès au sommaire d’anthologies ou de nombreuses revues (dont la NRF, Nouvelle Donne), et ses textes ont commencé à être rassemblés en quelques plaquettes à tirage confidentiel qu’il a, avoue-t-il avec humour, « refourguées à sa sœur, à sa mère, aux copines de sa mère, à son cousin, à sa grand-mère et à quelques copains magnanimes ». Ce dernier recueil de nouvelles intitulé « Douze mètres cubes de littérature » a reçu le prix Prométhée de la Nouvelle, décerné par l’atelier Imaginaire sur manuscrit, et vient de paraître aux éditions du Rocher. On sait que le prix Prométhée inverse le circuit traditionnel de l’édition : ce n’est pas un professionnel, plus ou moins soumis à des impératifs commerciaux, qui tente d’imposer ses choix au public, mais un jury de lecteurs qui se rassemblent pour choisir qui doit être publié. Cette édition vient consacrer heureusement un talent singulier.
Si l’on peut qualifier Roland Fuentès d’auteur fantastique, il n’a pas pour autant recours à une imagerie ou à une panoplie convenue du genre ; il s’inscrit dans la tradition d’un fantastique littéraire, et procède par de subtils décalages avec la réalité. Son monde est peuplé de faits divers peu ordinaires, un tailleur de diamants de Saint-Claude se met à transpirer du lait, le clocher de la cathédrale de Strasbourg dépasse seul de la surface du lac ayant noyé la ville, il tombe de vraies cordes du ciel, le vent entraîne dans une ronde les habitants d’une ville gelée… La psychologie n’a pas cours ici, elle n’a pas sa place, remplacée par une vision du monde où l’homme n’est pas forcément premier et central : les animaux, les arbres, les choses parfois y ont une place équivalente. Les femmes vivent ainsi avec des chiens ou des singes, une taupe détruit un quartier résidentiel, les araignées deviennent l’attraction d’un musée.
Les repères de la raison, les lois de la perspective et de la gravité s’effacent : dans « Lignes de fuite », « les paysages fuyaient de toutes parts, les prairies volaient, le ciel engloutissait des villages, les cluses gisaient au fond d’un fleuve qui le matin même ne formait pas l’ombre d’un ruisseau ». Le lecteur en garde l’impression d’un monde en perpétuel mouvement, sans point d’ancrage ni vérité établie, dont il faut peut-être chercher l’origine dans cette confidence de l’auteur : « Une enfance entre Algérie et Provence, une famille « mélangée » et de nombreux séjours à l’étranger m’ont donné du monde l’idée d’un foisonnement extrême. La conscience que toute façon d’être et de penser est relative. » Le fantastique devient ici le prolongement adulte du merveilleux du monde de l’enfance, sa version littéraire.
Militant de la littérature essentielle, Fuentès anime par ailleurs inlassablement la revue Salmigondis, qu’il a hissée au rang des meilleures et qu’il diffuse au long de l’année dans les librairies et les salons du livre. Il appartient à cette espèce en voie de disparition des êtres qui ont une conception exclusive et sacrée de la littérature, et celle-ci devient le thème de certaines des meilleures nouvelles : un critique oubliant de s’alimenter se lance dans la lecture d’un carton de douze mètres cubes de littérature jusqu’à ce que mort s’en suive, Amadeo Lutti disparaît dans le livre de sa propre vie, dont la couverture lui sert de pierre tombale. Roland Fuentès croit de façon incorrigible, inaliénable au pouvoir de la littérature et de la fiction, concluant son livre par cette déclaration : « il faut être bien fou pour vouloir ignorer le pouvoir des histoires ».
article paru dans Europe n° 900 (avril 2004)
06:21 Publié dans Lectures | Lien permanent






