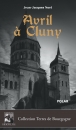vendredi, 08 juin 2007
Le sourire de Cézanne, de Raymond Alcovère
 Après un premier roman « Fugue baroque », publié en 1998 chez le même éditeur, Raymond Alcovère livre avec Le sourire de Cézanne un roman léger, intime, sur la rencontre d’un jeune étudiant et d’une femme, de vingt ans son aînée, qui écrit un livre sur les peintres. Léonore, rescapée d’une rupture amoureuse, connaît avec Gaétan un amour intense, une passion partagée sous le ciel lumineux des villes du sud (Montpellier, Aix) : « Elle déborde d’un amour absolu envers lui, un amour qui ne remet pas en cause sa liberté. »
Après un premier roman « Fugue baroque », publié en 1998 chez le même éditeur, Raymond Alcovère livre avec Le sourire de Cézanne un roman léger, intime, sur la rencontre d’un jeune étudiant et d’une femme, de vingt ans son aînée, qui écrit un livre sur les peintres. Léonore, rescapée d’une rupture amoureuse, connaît avec Gaétan un amour intense, une passion partagée sous le ciel lumineux des villes du sud (Montpellier, Aix) : « Elle déborde d’un amour absolu envers lui, un amour qui ne remet pas en cause sa liberté. »
Au-delà de la belle relation entre ces deux êtres, ce roman est une réflexion amoureuse sur la peinture et un hymne à Cézanne, une superbe approche de ce peintre qu’on ne peut rencontrer qu’en face de ses tableaux originaux, tant les reproductions sont trompeuses dans son cas, nous cachant la profondeur intense et la vie de la matière qui nous saisit physiquement à leur vue. Cézanne qui écrivit ces mots si forts : « La nature n’est pas en surface, elle est en profondeur. Les couleurs sont l’expression, à cette surface, de cette profondeur, elles montent des racines du monde. » Alcovère nous confie sa passion érudite pour d’autres créateurs : Poussin, Greco, Velázquez, Rembrandt, Caravage, Rubens, Fragonard, Picasso…
« Léonore, comme un peintre, ajoute de temps à autre une touche à son livre. » Et Raymond Alcovère procède de la même façon, son roman s’écrit par petites touches, phrases courtes, légères, fragments jetés comme des petites notes. La vie de ses personnages est ainsi, notations, sensations, éclats lumineux, éclairs de passion et ne vaut que par l’amour et l’art.
Le sourire de Cézanne, de Raymond Alcovère, éditions N&B, 110 pages, 13 €
13:10 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture, Roman, Alcovère
jeudi, 12 avril 2007
Le club des pantouflards, de Christian Cottet-Emard
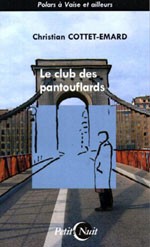
(Cet article, plus complet que celui que j'avais consacré l'an dernier à ce livre sur mon blog, est paru dans La presse Littéraire n° 9.)
Christian Cottet-Emard, qui anime avec humour et lucidité l’un des meilleurs blogs littéraires du moment (http://cottetemard.hautetfort.com), et qui s’est fait connaître comme poète, nouvelliste et romancier (Le grand variable, chez Editinter) vient de publier, dans la collection Petite Nuit, chez Nykta, un savoureux mini-polar, Le club des pantouflards.
L’histoire – relevant davantage de la politique-fiction que du genre policier - se situe dans le quartier lyonnais de Vaise, entre la rue Gorge de Loup et le pont Masaryk, un quartier jadis ouvrier (l’entreprise de la Rhodia), aujourd’hui déshérité mais en pleine rénovation, où quelques bobos aménagent des lofts dans les friches industrielles. Le héros, qui n’a rien d’héroïque, répond au nom improbable d’Effron Nuvem, et mène une vie grise de chômeur solitaire, celle d’un contemplatif sans autre perspective que la lecture de livres de poches (dont Les âmes mortes, de Nikolaï Gogol) et la consommation de sardines à l’huile portugaises Roses de France et de cafés au lait avec tartines. Tous ses espoirs semblent derrière lui : « Ses grands rêves d’adolescence le visitèrent. Ils étaient quant à eux de beaux papillons de jour mais ils avaient fait le chemin à l’envers, retournant vite aux chrysalides puis aux larves qui le rongeaient de l’intérieur. »
Une vie morne, vide et fermée où l’insolite s’invite, sous la forme d’une paire de pantoufles que Nuvem décide de s’offrir, d’une manière irraisonnée. Il ne s’étonne pas de l’étrange sollicitude du marchand de chaussures, qui l’invite bientôt au repas trimestriel du « club des pantouflards », un cercle fermé où les notables tirés à quatre épingles dînent et s’empiffrent de mets fins, pantoufles aux pieds. Cailles, grives, pigeons, faisans aux quatre choux, la nourriture abondante et choisie est dispensée par l’énorme Graziella. Quantité et qualité se conjuguent à la table : « un goûter composé de petits sandwiches au foie gras, de brioches, de choux à la crème, de crêpes, de babas au rhum, de petits-fours et de fruits confits, le tout arrosé de vieux porto et de muscat de Sardaigne. » Notre héros, qui a des prédispositions certaines pour la bonne chère, allume un Lusitania et boit de grandes rasades de Cognac.
Mais que vient-il faire dans cette galère, même aux allures de paradis gastronomique ? « Que pouvait valoir l’adhésion d’un chômeur, une de ces « âmes mortes » à peine bonnes à émigrer d’un fichier à un autre au gré des fluctuations d’une comptabilité d’actifs et de passifs que se jetaient sans cesse à la figure lors de joutes télévisées les dignes héritiers de l’escroc Tchitchikov ? » C’est là que le roman devient une fable politique angoissante : ce club ressemble en effet à une phalange secrète et présente une liste aux élections municipales, sans succès. Bientôt Effron Nuvem voit la ville basculer dans une organisation totalitaire dont il devient, grâce à ses relations pantouflardes, l’un des employés, affecté au service du broyage des documents administratifs. Un engin monté sur chenilles entièrement revêtu d’un blindage noir trône au milieu de la place du quartier, assurant la surveillance de la ville, et la délivrance d’argent et de formalités administratives par une seule et même carte de crédit, sésame contrôlé et délivré par les autorités, comme si dans ce pays venait de se réaliser la crainte du croisement des fichiers informatiques. « Dans cette masse de métal compact dépourvue de toute ouverture luisait une petite lueur rouge de la taille d’un œilleton. » Ce blindé est une belle trouvaille romanesque, big brother matérialisé dans un engin militaire, inamovible et menaçant.
Le héros ne s’en formalise pas, et ne se pose jamais de questions, content de sa tâche répétitive au sous-sol de la mairie. Autour de lui, les opposants se font d’ailleurs rares et peu combatifs, les belles âmes éprises de liberté attendant les beaux jours pour défiler dans la rue. « Maintenant que les gens retrouvaient leur climat habituel et que la douceur des températures incitait à sortir se promener, l’élite citoyenne de la population se sentait incommodée par la présence silencieuse mais insistante du blindé. » Mais après cette molle résistance, le confort prend le dessus, les commodités du système gagnent chaque jour les faveurs des plus contestataires.
Dans ce livre, de la taille d’une longue nouvelle, on retrouve l’originalité de l’inspiration et la maîtrise de l’écriture, le sens du fantastique et les talents de conteur de Cottet-Emard. Cette fantaisie si pleine d’humour et de portraits truculents (l’éléphantesque Graziella, le petit gros à moustache, le vieux maigre aux allures d’insecte) baigne dans une atmosphère kafkaïenne. A l’ouverture du roman, le nom de Nuvem disparaît d’un fichier d’ordinateur ; à la fin il est à nouveau supprimé : « crédit épuisé carte non valide ». Victime impuissante et quasi consentante d’une machination obscure, il n’est qu’un pion : « Les pantoufles d’Effron Nuvem arpentaient de vastes carrés de bitume qui passaient du noir au blanc, réduisant sa silhouette à celle d’un pion sur cet échiquier dessiné par la lune. » Le héros descend les neuf cercles de l’enfer, mais il n’est pas la seule victime dans ce monde cruel et burlesque où les rivalités pour le pouvoir autorisent tous les coups, jusqu’à l’élimination du concurrent ou du prochain.
Le rire que l’on éprouve à la lecture est vite mêlé de malaise et d’inquiétude, comme si nous étions plus proches de ce monde qu’on ne voudrait le croire, pas même à la distance d’un rêve ou d’un cauchemar. Cottet-Emard excelle à nous décrire l’individu broyé et effacé par la politique de l’absurde.
Le club des pantouflards, de Christian Cottet-Emard, Ed. NYKTA, collection Petite Nuit. 80 pages, 5 €.
Descriptif et références complètes sur le blog de l'auteur :
http://cottetemard.hautetfort.com/archive/2006/06/19/le-c...
19:25 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture
mardi, 06 février 2007
Ainsi va le poème, de Gabriel Le Gal
Les poèmes seraient
Parmi les brumes et les haies
Ce rouge tenu
Rouge d’hier en sursis
Ou bien baies d’églantier
Luisantes
Coriaces à garder
La floraison de demain
Ces points de rouge
Dans le gris des journées
« Qu’est-ce qu’un poème/ où le monde/ ne viendrait pas/ commencer ? » Un nouveau recueil de Gabriel Le Gal, à mi-voix, chaque mot posé dans sa plénitude, vient de paraître.
Ainsi va le poème, Jacques André éditeur, 5 rue Bugeaud, 69006 Lyon. 70 pages, 11 €
08:20 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : Littérature, Culture, Poésie
samedi, 27 janvier 2007
Agir ou ne pas agir
Guy Debord
09:10 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature, Culture
samedi, 02 décembre 2006
Le magazine des Livres
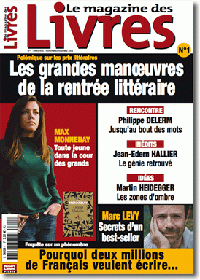 Découvrant dans les kiosques le premier numéro du Magazine des Livres, j'ai eu la surprise d'y retrouver une foule de connaissances : certains des collaborateurs de La Presse littéraire entraînés par le capitaine Joseph Vebret : Anthony Dufraisse, Marc Alpozzo, Claire Fercak, Eli Flory, Hubert de Champris..., équipe complétée par Frédéric Vignale, Frédéric Ploton...
Découvrant dans les kiosques le premier numéro du Magazine des Livres, j'ai eu la surprise d'y retrouver une foule de connaissances : certains des collaborateurs de La Presse littéraire entraînés par le capitaine Joseph Vebret : Anthony Dufraisse, Marc Alpozzo, Claire Fercak, Eli Flory, Hubert de Champris..., équipe complétée par Frédéric Vignale, Frédéric Ploton...
A la différence de La presse littéraire, Le magazine des livres (publié par le même groupe de presse Robert Lafont) se veut davantage « grand public », privilégie les enquêtes et les interviews. Toute initiative en faveur du livre et de la lecture est à saluer et encourager, ce que je fais bien volontiers, même s'il est encore trop tôt pour juger cette formule sur son numéro un, qui m'apparaît parfois un peu consensuel et superficiel. A noter une enquête assez lucide de Frédéric Ploton, « Deux millions d'écrivains... et vous ? », qui décrit bien la situation sans issue des deux millions de Français qui écrivent et aspireraient à la publication de leur chef-d'oeuvre. L'envoi du manuscrit par la poste se solde presque toujours par un échec : « Environ 0,1 % seulement des manuscrits envoyés par courrier finiront sous les rotatives de l'imprimeur. Plus de 99 % des ouvrages publiés proviennent de cette source souterraine, pour ne pas dire occulte : le réseau. »
Le magazine des livres, bimestriel, 5, 90 €. Site internet : http://www.magazinedeslivres.com/
21:45 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Culture
jeudi, 21 septembre 2006
Le Pal, de Léon Bloy
(Cet article est paru dans La presse Littéraire n° 6)
Le journalisme, voilà l’ennemi !
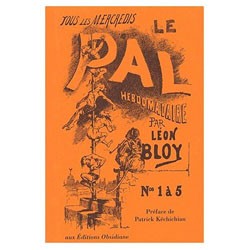 Les éditions Obsidiane ont republié en 2002, dans un singulier recueil tiré à 800 exemplaires, les 5 numéros parus du Pal, journal hebdomadaire pamphlétaire rédigé durant l’année 1885 par le seul Léon Bloy, financé sur ses propres deniers et échec commercial (le 5e numéro, écrit et composé, ne paraîtra pas.)
Les éditions Obsidiane ont republié en 2002, dans un singulier recueil tiré à 800 exemplaires, les 5 numéros parus du Pal, journal hebdomadaire pamphlétaire rédigé durant l’année 1885 par le seul Léon Bloy, financé sur ses propres deniers et échec commercial (le 5e numéro, écrit et composé, ne paraîtra pas.)
Armé de ses convictions et de sa foi, sans retenue ni prudence, dans le même style éblouissant que l’on aime dans ses œuvres (et Le Pal est une œuvre de création), Léon Bloy nous régale d’un jeu de massacre, règle ses comptes avec ses contemporains dont il fustige la tiédeur, la veulerie et les travers, sans épargner personne, homme de pouvoir ou homme du peuple.
La situation politique et morale de 1885 ressemble par bien des traits à celle d’aujourd’hui, comme si 120 ans après, la même décadence, la même déliquescence, et surtout la même médiocrité régnaient sur la France. A la médiocrité des hommes politiques qui ont suivi Napoléon (« Napoléon subsiste dans la mémoire humaine, tout en haut du siècle, et cela fait une sacrée sensation de contempler au-dessous de lui les affreux bonshommes qui gouvernent aujourd’hui la France. »), répond celle des hommes de tout bord qui ont succédé à de Gaulle. « Quant à l’autre qui contamine l’Elysée, n’en parlons pas. C’est déjà trop d’y penser. » L’irrespect dénoncé par Bloy semble être devenu la norme (« On ne pourrit pas assez tôt l’enfance, on n’assomme pas assez de pauvres, on ne se sert pas encore assez du visage paternel comme d’un crachoir ou d’un décrottoir. Mais le régime actuel va nous donner toutes ces choses qu’on entend déjà galoper vers nous. »), et les mêmes égoïsmes tiennent le haut du pavé. Bloy décrit une société solidaire dans la bassesse et l’abjection, dans la « salauderie morale », dans le rejet du sublime, qu’il soit de la foi ou de la culture, depuis les représentants politiques, lâches et corrompus, les bourgeois et les propriétaires terriens (« les possesseurs de la terre et les capitalistes, retranchés, barricadés dans la forteresse du plus immonde et du plus inexorable égoïsme »), le clergé (« le mur de soutènement du Clergé, masse étonnamment friable de médiocrité, de bassesse, de lâcheté ou d’infamie »), et jusqu’à ses frères catholiques qu’il vomit comme tièdes (« pseudo-catholiques dont l’unique fin terrestre est de jouir comme des pourceaux ») ; enfin, les arts prostitués ne valent guère mieux : « Enfin, dominant tout, flottant dans l’azur, claquant dans les vents, les torcheculatives oriflammes de la littérature contemporaine. »
L’une des causes (et des effets) de cette dégénérescence est à chercher dans le pouvoir de la presse, dont Le Pal constitue l’une des plus violentes dénonciations. Baudelaire l’avait déjà écrit : « Je ne comprends pas qu’une main pure puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût. » Bloy relève surtout, et c’est en cela sa formidable et cruelle actualité, sa vision prospective, le pouvoir sans limite et sans frein des journalistes, qui font l’opinion : « Le Directeur de journal est un monstrueux pouvoir tout moderne engendré de la basse Curiosité humaine et du Cynisme cupide de quelques ratés littéraires. » Les directeurs de journaux « sont réellement devenus aujourd’hui les arbitres de la planète. »
Si les lecteurs sont conscients de la médiocrité des journaux, ils ne peuvent pourtant s’affranchir de leur influence et de leur ascendant. Sans contrepouvoir, sans rien qui vienne enrayer son formidable développement, le journalisme se déploie comme un cancer et remplit tout l’espace : « Le Journalisme moderne que je prétends désigner assez de cette épithète lumineuse, a tellement pris toute la place, malgré l’étonnante petitesse de ses unités, que le plus grand homme du monde, s’il plaisait à la Providence de nous gratifier de cette denrée, ne trouverait plus même à s’accroupir dans le rentrant d’un angle obscur de ce lupanar universel des intelligences. » Ainsi dominateur, le journalisme accomplit son travail de sape, intoxiquant les esprits, notamment ceux des jeunes générations, détruit la culture et l’esprit au profit de la médiocrité et de la réclame. La pensée véritable n’a plus cours, n’a plus place, sauf à se prostituer, le combat est déjà perdu : « L’inutilité absolue de toute revendication pour la Pensée est désormais évidente jusqu’à l’éblouissement. » Pour collaborer aux journaux, il faut passer par « les argousins de la pensée », pitoyables agents de police, qui ramènent toute création à des dimensions médiocres, mais rentables. Ce que Bloy met bien en évidence, c’est l’alliance de la presse et du capitalisme, poussant à la consommation, et à la livraison de produits, jusque dans la littérature qui devient « industrielle », pratiquée par ceux qui ont su « pousser à la culture intensive du dividende ».
« J’ai longtemps cherché le moyen de me rendre insupportable à mes contemporains. » Ce qui surprend le lecteur moderne, avant toute incursion dans la pensée bloyenne, c’est le ton, à la fois une franchise sans concession (« Dire la vérité à tout le monde, sur toutes choses et quelles qu’en puissent être les conséquences. »), et une violence verbale, des portraits à charge qui vont jusqu’à l’invective, l’insulte (et malheureusement aussi, trait d’époque, au racisme anti-juif) qui seraient aujourd’hui inacceptables et inacceptés, les procès en diffamation pleuvraient et aucun media n’oserait prendre le risque de leur publication. Qu’on en juge par quelques amabilités que la verve et l’invention verbale, voire un génie comique, don propre au grand écrivain, transforment en gourmandise pour le lecteur :
« La face entièrement glabre, comme celle d’un Annamite ou d’un singe papion, est de la couleur d’un énorme fromage blanc, dans lequel on aurait longuement battu le solide excrément d’un travailleur. »
« Il lui pousserait des champignons bleus sur le visage que cela ne le rendrait pas plus épouvantable. Peut-être même qu’il y gagnerait… »
Autres temps, autres mœurs et autres relations. Ce jeu de massacre jouissif, cette « entreprise de démolition », cette volée de bois vert, ces atteintes qui ne craignent pas de s’attaquer aux personnes et à leur physique, sont désormais interdites. Les tièdes, qui gagnaient déjà en fait, ont depuis gagné en droit, instaurant leur tranquille dictature, interdisant sous peine de poursuites judiciaires à toute pensée incorrecte le moindre droit d’existence. Au pamphlet, au libelle, ont succédé l’assignation, le procès – voire la menace de procès qui joue le rôle de la dissuasion nucléaire - ; les avocats et les juges ont pris le pas sur les écrivains.
La préface de Patrick Kéchichian, confuse, n’apporte rien à l’ensemble, mais un journaliste, qui plus est employé au Monde, l’un de ces journaux qu’un nouveau Bloy ne manquerait pas d’éreinter, peut-il être à la fois juge du livre de Bloy et partie attaquée avec la dernière virulence ? Car, sous les noms de chroniqueurs aujourd’hui disparus, y compris des mémoires, sous les noms des journaux eux aussi disparus (à l’exception notable du Figaro), on retrouve une situation comparable à travers le temps, les mêmes pratiques, les mêmes combinaisons et lâchetés, les mêmes réseaux d’intérêt au service de médiocres.
Peut-on attaquer la presse par voie de presse ? s’étonne le préfacier, relevant « cette naïveté qui consiste à croire que l’on peut retourner l’arme de la presse contre elle-même ». Bloy, qui s’exprimerait peut-être de nos jours par la voie du blog, ce nouveau média qui reste pour l’instant (et pour combien de temps encore ?) un formidable espace de liberté, n’avait pas cette naïveté, mais il a profité d’un espace d’expression (qu’il s’est en fait payé, comme un luxe), d’une trouée, pour lancer ses flèches. Empoisonnées au curare de la vérité, elles continuent d’agacer ce corps encombrant et dominateur de la presse qui n’en finit plus de survivre sur l’insolente santé de sa gangrène. « Le Journalisme accomplit donc sa destinée sans que rien le déconcerte ni le trouble, semblable à toute vermine sourde et aveugle qu’aucune clameur terrestre ne peut détourner de son travail de destruction. »
Léon Bloy, Le Pal, éditions Obsidiane, 18 €
18:59 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Culture
vendredi, 25 août 2006
Le nouveau blog de Michel Houellebecq
Houellebecq est égal au meilleur de lui-même dans son nouveau blog, Mourir II. Il aborde, entre autres choses, le lynchage médiatique dont il a été victime lors de la sortie de La possibilité d’une île, l’adaptation de ses livres au cinéma, sa rencontre avec Maurice Pialat, et ses difficultés pour la réalisation du film qu’il voulait tourner : « Il semble aujourd’hui acquis que malgré les promesses formelles, tant écrites qu’orales, d’Arnaud Lagardère, le groupe Hachette ne participera pas au financement du film tiré de “La possibilité d’une île”. »
12:52 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Littérature, Culture