mardi, 08 juin 2021
Charmes, de Christian Cottet-Emard
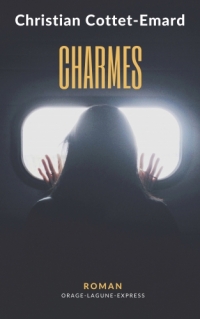 Dans une note liminaire à son nouveau roman, Christian Cottet-Emard, que l'on connaît aussi comme poète et chroniqueur, nous livre la genèse de Charmes : « Le don est un mystère qui m'a toujours tourmenté, sans doute parce que j'en suis dépourvu, en particulier de celui qui m'a le plus cruellement manqué, écrire et jouer de la musique. Ce manque étant une de mes hantises les plus lourdes, je m'en suis un peu allégé en inventant cette fable où rôdent les ombres et les esprits de ce qui ne peut trouver ni repos ni fin. »
Dans une note liminaire à son nouveau roman, Christian Cottet-Emard, que l'on connaît aussi comme poète et chroniqueur, nous livre la genèse de Charmes : « Le don est un mystère qui m'a toujours tourmenté, sans doute parce que j'en suis dépourvu, en particulier de celui qui m'a le plus cruellement manqué, écrire et jouer de la musique. Ce manque étant une de mes hantises les plus lourdes, je m'en suis un peu allégé en inventant cette fable où rôdent les ombres et les esprits de ce qui ne peut trouver ni repos ni fin. »
Passionné de musique mais incapable de la pratiquer, le personnage principal Charles Dautray vit seul, dans sa maison jurassienne où il rédige son journal intime. À la suite de sa rencontre avec la mystérieuse Marina, il se trouve subitement en possession de ce don musical dont il a toujours rêvé. Une carrière de pianiste concertiste s'offre soudain à lui, qu'il mène aidé par son producteur et agent artistique Aaron Jenkins, tandis que le pigiste Antoine Magnard rédige des articles sur ses concerts et les livrets de ses disques.
Le roman se constitue des récits croisés des différents protagonistes, qui forment comme les pièces d'un puzzle. On se déplace à Lyon, Paris, Barcelone, Venise et Lisbonne, on prend quelques détours par Oyonnax et Nantua. L'action progresse vers une fin surprenante.
C'est à la fois un roman très personnel, où l'auteur livre beaucoup de lui-même (sa vie, ses goûts, ses décors...) et un récit fantastique, traversé par le personnage étrange et inquiétant de Marina, avec qui Charles Dautray lie une sorte de pacte faustien. « Il est vrai que je me damnerais bien en échange d'une parcelle d'excellence musicale et du génie qui l'accompagne. »
Cottet-Emard montre une grande connaissance de la musique classique et contemporaine, et une maîtrise dans l'art du dialogue intégré : délaissant le retour à la ligne et le tiret, il introduit les répliques des personnages dans le corps même du texte, qui gagne en fluidité. Le titre Charmes (venant de la villa des Charmes, évoquée dans la deuxième partie du livre) convient bien à ce récit : c'est l'histoire d'une possession, l'histoire d'un vertige.
Charmes, de Christian Cottet-Emard, Orage-Lagune-Express éditeur.
210 pages.
Le lien pour découvrir l'ouvrage :
http://cottetemard.hautetfort.com/archive/2021/06/05/charmes-6320188.html
08:08 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charmes, christian cottet-emard, orage-lagune-express, roman, musique
mardi, 13 janvier 2009
Monsieur Ouine est de sortie
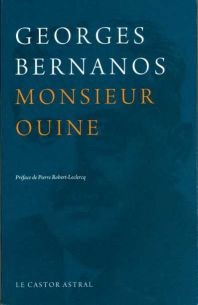 Le Castor Astral vient de rééditer Monsieur Ouine, de Georges Bernanos. Ignorant que ce chef-d'oeuvre était reparu (alors qu'il n'était plus disponible que dans l'édition des romans à La Pléiade), j'en ai téléchargé récemment le texte sur le site ebooksgratuits, et viens d'en achever la lecture sur mon Sony Reader. Ce qui démontre bien l'intérêt de ces outils de lecture numérique donnant accès à des textes parfois introuvables...
Le Castor Astral vient de rééditer Monsieur Ouine, de Georges Bernanos. Ignorant que ce chef-d'oeuvre était reparu (alors qu'il n'était plus disponible que dans l'édition des romans à La Pléiade), j'en ai téléchargé récemment le texte sur le site ebooksgratuits, et viens d'en achever la lecture sur mon Sony Reader. Ce qui démontre bien l'intérêt de ces outils de lecture numérique donnant accès à des textes parfois introuvables...
J'aurai l'occasion de reparler de Monsieur Ouine, un des sommets de la littérature. Pour patienter, ce lien vers la présentation de l'ouvrage par les éditions du Castor Astral.
21:33 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : litterature, roman, bernanos, monsieur ouine
jeudi, 24 juillet 2008
La possibilité d'une île, le film
Le film « La possibilité d'une île », que Michel Houellebecq a réalisé à partir de son propre roman, sortira en salles le 10 septembre 2008.
Je ne sais ce que donnera l'adaptation de cet immense roman ; pour patienter on peut rendre visite au site du film (vidéos-reportages, interviews pleines de silences et d'hésitations de MH, bande-annonce...) :
http://www.lapossibiliteduneile-lefilm.com/michelhouelleb...
19:26 Publié dans Cinéma, séries, DVD | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : houellebecq, la possibilité d'une île, littérature, roman, cinéma
mardi, 11 décembre 2007
Dans le café de la jeunesse perdue
Un registre des êtres de passage
(Cet article est paru dans Le magazine des livres n° 7.)
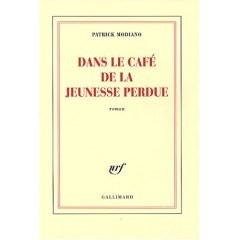 Multiple magie, toujours renouvelée, que celle de Modiano, et que l’on retrouve entière dans ce nouveau roman, « Dans le café de la jeunesse perdue ». Magie des lieux, d’abord, qui prennent possession de vous, et auxquels on ne peut échapper : « J’ai toujours cru que certains endroits sont des aimants et que vous êtes attiré vers eux si vous marchez dans leurs parages. Et cela de manière imperceptible, sans même vous en douter. Il suffit d’une rue en pente, d’un trottoir ensoleillé ou bien d’un trottoir à l’ombre. Ou bien d’une averse. Et cela vous amène là, au point précis où vous deviez échouer. Il me semble que Le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique et que si l’on faisait un calcul de probabilités le résultat l’aurait confirmé : dans un périmètre assez étendu, il était inévitable de dériver vers lui. » Le Condé est le lieu principal où passent tous les protagonistes, le lieu où s’agrègent les éléments de l’histoire. Des clients aux noms étranges, Tarzan, Babilée, Zacharias, Ali Cherif, Bob Storms, le docteur Vala hantent ce café. Certains sont étudiants, d’autres écrivains, comme Larronde et Arthur Adamov. Ils incarnent une jeunesse bohême, telle qu’elle n’existe plus vraiment aujourd’hui, ou, pour les plus âgés, ils vivent dans la nostalgie de cette jeunesse perdue et tentent de la prolonger. L’un des habitués, Bowing, note sur un cahier les noms des clients du café, les jours et heures d’arrivée, cherchant « à sauver de l’oubli les papillons qui tournent quelques instants autour d’une lampe. » Entreprise vaine, incomplète et dérisoire. C’est dans ce lieu qu’échoue Jacqueline, dite Louki, figure centrale autour de laquelle tournent les décors et les êtres. Une femme errante, qui se sauve et coupe les ponts. « Je n’étais vraiment moi-même qu’à l’instant où je m’enfuyais. Mes seuls bons souvenirs sont des souvenirs de fuite ou de fugue. » avoue-t-elle, de la même façon qu’elle avoue s’être mariée « comme on confesse un crime ».
Multiple magie, toujours renouvelée, que celle de Modiano, et que l’on retrouve entière dans ce nouveau roman, « Dans le café de la jeunesse perdue ». Magie des lieux, d’abord, qui prennent possession de vous, et auxquels on ne peut échapper : « J’ai toujours cru que certains endroits sont des aimants et que vous êtes attiré vers eux si vous marchez dans leurs parages. Et cela de manière imperceptible, sans même vous en douter. Il suffit d’une rue en pente, d’un trottoir ensoleillé ou bien d’un trottoir à l’ombre. Ou bien d’une averse. Et cela vous amène là, au point précis où vous deviez échouer. Il me semble que Le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique et que si l’on faisait un calcul de probabilités le résultat l’aurait confirmé : dans un périmètre assez étendu, il était inévitable de dériver vers lui. » Le Condé est le lieu principal où passent tous les protagonistes, le lieu où s’agrègent les éléments de l’histoire. Des clients aux noms étranges, Tarzan, Babilée, Zacharias, Ali Cherif, Bob Storms, le docteur Vala hantent ce café. Certains sont étudiants, d’autres écrivains, comme Larronde et Arthur Adamov. Ils incarnent une jeunesse bohême, telle qu’elle n’existe plus vraiment aujourd’hui, ou, pour les plus âgés, ils vivent dans la nostalgie de cette jeunesse perdue et tentent de la prolonger. L’un des habitués, Bowing, note sur un cahier les noms des clients du café, les jours et heures d’arrivée, cherchant « à sauver de l’oubli les papillons qui tournent quelques instants autour d’une lampe. » Entreprise vaine, incomplète et dérisoire. C’est dans ce lieu qu’échoue Jacqueline, dite Louki, figure centrale autour de laquelle tournent les décors et les êtres. Une femme errante, qui se sauve et coupe les ponts. « Je n’étais vraiment moi-même qu’à l’instant où je m’enfuyais. Mes seuls bons souvenirs sont des souvenirs de fuite ou de fugue. » avoue-t-elle, de la même façon qu’elle avoue s’être mariée « comme on confesse un crime ».
Un deuxième café, Le Canter, est le double sombre du Condé : les clients, Accad, Godinger, Mario Bay, Mocellini, sont des personnages louches, qui trafiquent ou travaillent dans des « sociétés », comme le faisait le propre père de l’auteur. Louki retrouve dans ce lieu Jeannette Gaul, « sa part d’ombre » et goûte à d’autres paradis que ceux de l’alcool, en prenant « un peu de neige ». Le livre est une dérive dans Paris, avec pour tout guide un vieux plan réparé avec du Scotch. Les rues, les établissements portent aussi des noms évocateurs ou poétiques : le Château des Brouillards, la rue des Grands-Degrés, l’Hôtel Hivernia, le commissariat des Grandes-Carrières – et la librairie Vega, point de rencontre des fidèles du conférencier Guy de Vere.
D’une construction moins linéaire que ses précédents livres, notamment Un pedigree et La petite bijou, ce roman regroupe quatre récits : celui d’un étudiant de l’Ecole supérieure des Mines attiré par la bohême et qui a envie d’abandonner ses études, celui d’un détective du nom de Caisley, celui de Louki, celui enfin du brun à veste de daim qui porte le prénom inventé de Roland et écrit un texte sur les « zones neutres » de Paris, ces quartiers aux frontières imprécises. Quatre récits pour recomposer une histoire fragmentaire, qui comme l’héroïne, garde sa part de mystère.
Modianesque à souhait, le titre « Dans le café de la jeunesse perdue » est en fait emprunté à un texte de Guy Debord, que Modiano définit au passage comme un « philosophe sentimental ». Le roman est traversé de livres, ou plutôt de titres d’ouvrages de science-fiction, de spiritualité ou d’ésotérisme aux noms étranges : Horizons perdus, Cristal qui songe, Voyage dans l’infini, Louise du Néant. Les personnages sont proches de ce néant, semblables à ces individus disparus depuis 30 ans et que l’on déclare absents par le biais des « déclarations d’absence » dans les publications judiciaires. Ils sont condamnés ou prédestinés à mal finir et échouent, parfois volontairement comme le détective Caisley payé pour rechercher Louki disparue : quand il la retrouve, il décide de ne rien dire à son commanditaire, d’enterrer son enquête, pour laisser à la jeune femme « le temps de se mettre définitivement hors d’atteinte ».
Quelques mots, quelques phrases, et la magie Modiano se déploie et prend le lecteur dans ses rets. On a beau se défendre, on est toujours gagné par cette mélancolie violente et feutrée, celle de la fuite des jours, la fuite de la jeunesse, la dispersion des êtres, l’effacement irréversible de nos traces dont seuls quelques mots froids et nus comme ceux d’un procès-verbal témoignent encore. Ou encore ces renseignements purement factuels qu’enregistre le détective, « ces détails qui sont souvent les seuls à témoigner du passage d’un vivant sur la terre. A condition qu’on retrouve un jour le carnet à spirale où quelqu’un les a notés d’une toute petite écriture difficilement lisible, comme la mienne. » Sur le terrain vague de la vie, les hommes cherchent à s’accrocher à des points de repère. La constante de Modiano, c’est cette attention aux êtres de passage, et la tentative de les fixer, comme sur une photographie. Il redonne vie fugacement aux absents, aux tricheurs, aux créatures en demi-teinte du doute et de l’échec, à ceux qui en traversant la vie n’étaient déjà que des ombres.
Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, éditions Gallimard, 14, 50 €.
19:56 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, modiano
jeudi, 01 novembre 2007
L'autoroute, première station
Je livre ici le premier chapitre d’un roman inédit, « L’autoroute », composé de douze chapitres ou stations. Ce texte est le développement d’une nouvelle parue dans les revues Salmigondis et i rouge, ainsi que dans mon recueil « Portraits d’écrivains » (Editinter, 2002).
Il regarde le siège du passager, à sa droite, sur lequel reposent une sacoche en cuir noir, un appareil photo numérique, des lunettes de soleil et un petit dictaphone, puis jette un coup d’œil rapide en se retournant vers la banquette arrière. Dans son rétroviseur central il voit le vide à l’arrière de la voiture. Il est le seul conducteur à cette heure, aussi loin que porte le regard sur les lignes droites devant et derrière lui, le seul à descendre le couloir d’autoroute et le cours du temps. Il passe. Le paysage est mobile comme un train d’images. Les grands portiques se rapprochent, les panneaux bleus, les panneaux blancs, les panneaux verts, les directions lointaines, Montpellier, Toulouse, Perpignan, ou étrangères, Barcelone, Andorre. Il dépasse des aires de repos, des stations-services. Il dépasse des véhicules de sécurité garés sur la bande d’arrêt d’urgence. Des messages lumineux en lettres jaunes brillent dans la brume, au dessus des voies. Il voit ces mots sans trop les lire, sans y prêter attention, il n’a plus de destination, il se décide aux embranchements, au hasard, au dernier moment, allant tout droit, ou sur la droite, ou sur la gauche.
Il y a eu un blanc presque imperceptible après la chanson de Chris Rea, un minuscule temps d’arrêt, comme un spasme, après The road to hell, puis une voix vulgaire d’animateur a retenti avant qu’il n’arrête l’autoradio. Il n’y a plus que le bourdonnement régulier du moteur, une sorte de silence lesté d’un léger bruit de fond, familier. Depuis combien de temps est-il parti ? La mémoire hésite, elle n’a plus de repère. L’autoroute n’a pas de début et pas de fin, pas de centre, à peine un plan, un fil rouge sur les cartes routières comme des artères de sang, juste des circuits reliés à d’autres circuits, des voies entrelacées qui composent un infini réseau, tout est pareil, équivalent, équidistant, les voies sont toujours offertes, les stations sont toujours ouvertes, la semaine, le dimanche, les jours fériés, les employés se relaient, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la nuit est animée comme le jour, illuminée. Depuis combien de temps a-t-il quitté la ville ? Quelques semaines, peut-être, un mois, deux mois, qu’importe. Les journées se confondent. Le passé n’est plus qu’un espace incertain, une plage instable. Il va devant lui, sans regarder en arrière, il s’en va vers l’hiver. Depuis le début de sa course il a vu nettement les jours raccourcir ; inexorablement la nuit a gagné ; à force de rouler il lui semble chaque soir être passé de l’autre côté du monde, dans l’hémisphère sombre. Et même dans la journée la lumière a quelque chose de plus lourd, et de voilé.
La voiture suit sa voie tracée à vitesse régulière, toute en courbes dans l’espace. Elle est belle. Il aime ses formes, son profil, ses rondeurs de vaisseau spatial. Elle est faite pour le mouvement, pour le continu du voyage, conçue pour déplacer un être à la surface de la terre ferme, sur la rotondité du globe, sur un ruban d’asphalte à l’infini.
La voiture est grande et confortable. Elle offre, si l’on se réfère à la notice descriptive gardée dans la boîte à gants, cinq places assises et un coffre d’une grande capacité, conformément à sa vocation de berline familiale. Sa carrosserie aux lignes douces est d’un gris plutôt clair, terni par la poussière accumulée des jours. Les vitres sont sales aussi, à l’exception d’une zone du pare-brise où les essuie-glaces ont décrit deux éventails transparents. A l’arrière gauche, on lit « Renault » ; à l’arrière droit, « Laguna ». Entre les deux, au centre exact de la largeur du coffre, un losange d’argent, logo de la marque, troué en son centre d’un autre losange d’un gris indéfinissable et voilé de poussière, un grain de gris aussi indistinct que l’infini. Elle a un moteur diesel, son bruit feutré accompagne la conduite. Elle fonctionne sans aucun incident. Comme un corps qui ne serait jamais malade, un cœur qui ne s’arrêterait pas. Il suffit de remettre du carburant quand le réservoir - d’une contenance de soixante-dix litres - est presque vide ; en gardant une allure douce et constante on parvient à couvrir mille kilomètres avec un plein de gas-oil. Après avoir quitté la station-service, il aime voir l’aiguille de la jauge bloquée au plus haut du témoin, il aime avoir cette réserve qui le rassure, savoir qu’il pourra rouler loin, longtemps.
Des panneaux successifs annoncent une aire de repos : deux mille, mille, trois cents mètres. Une lettre P dans un carré bleu ; à côté, un pictogramme représentant une table et un sapin. Il actionne son clignotant droit et s’engage sur la voie d’accès. L’endroit est désert, battu par le vent. Il gare sa voiture devant le bloc de béton des toilettes, coupe le moteur, reste un long moment, les avant-bras sur le volant, la tête sur les avant-bras, les yeux fermés, immobile. Puis il descend, verrouille les portes d’une pression sur le côté de la clé. Le froid le surprend et le fait tressaillir. Il ferme les boutons de sa chemise grise, remonte la fermeture éclair de son blouson de toile, ses vêtements ne sont plus assez chauds pour la saison. Sur le parking vide il marche de long en large, sur le goudron noir et les allées de ciment, sur les emplacements tracés pour le stationnement des automobiles, sur les lignes blanches un peu effacées, puis sur le talus d’herbe rare tout autour ; il rejoint le grillage final marquant la limite de l’aire, une haute clôture qui court tout le long de l’autoroute et retient captifs véhicules et passagers. Ses mains agrippent les larges carrés de fil de fer gris argent, se crispent comme sur les barreaux d’une cage. Il repart en sens inverse. Il marche pour sentir le sang circuler dans ses jambes, le vent fouetter sa tête, le vider de toutes ses idées, des images accumulées. Pendant près d’une heure il va, revient sur ses pas, traverse l’espace en fermant à demi les yeux, réduisant son regard à une fente, une meurtrière horizontale d’où il voit les courbes de la montagne basse, à l’ouest, au loin, de l’autre côté de l’autre voie. Puis, se retournant vers l’est, il découvre le même relief. L’aire se trouve au cœur d’un cirque de collines, où la percée de l’autoroute en son diamètre est le seul passage, la seule ligne d’échappée. Il remonte dans sa voiture. Le vent s’éteint. Le bruit familier du moteur est une présence rassurante. Il reprend son errance.
A la sortie de l’aire, au bout de la bretelle qui se jette dans le fleuve noir à triple voie, un panneau rouge et blanc en forme de triangle pointe en bas rappelle : CEDEZ LE PASSAGE. Il réintègre sans difficulté le circuit machinal des voitures, il vient grossir le flot, et le nombre ; il est happé et digéré par la file vrombissante. Ensuite il n’y a plus qu’à suivre le mouvement, sans excès de vitesse, en ne dépassant que les véhicules anormalement lents, ceux qui freinent le rythme de sa pensée, de sa rêverie. Il a tout le temps devant lui, et une souveraine absence de destination qui ouvre tout l’espace autoroutier et fait de la distance un océan sans limite.
L’autoroute se déploie, infini ruban recommencé, réserve inépuisable de kilomètres, circuit d’errance où il oublie la marche et le reste du monde. Elle est devenue son milieu naturel. L’immense ramification n’a pas de point de départ ni d’arrivée, ni d’origine ni de fin, seulement des milliers de points d’entrée et de sortie, des milliers de points intermédiaires. Les kilomètres passent, en continu, sur la droite et sur la gauche comme deux pans de manèges symétriques, il a l’impression d’être immobile dans un tunnel à ciel ouvert, dans un couloir d'autoroute qui file d’avant en arrière de son corps, comme dans ces très vieux films où les acteurs font semblant de conduire, statiques devant un décor d’écran qui bouge.
La conduite est facile, les voies se déroulent devant lui, droites, ou en courbes larges et relevées, entre les glissières de sécurité. Il a peu de choses à faire, en somme. Tenir le volant d’une main légère. Laisser le pied droit sur la pédale d’accélérateur, à mi-course. Garder l’axe de son regard sur les voies noires matérialisées par des lignes blanches continues ou discontinues. Donner un coup d’œil furtif dans les rétroviseurs. Actionner son clignotant et doubler les camions, les norias de camions qui remontent des pays frontaliers. Suivre les panneaux indicateurs, les directions fléchées, les noms de destinations en grandes lettres majuscules blanches sur fond bleu. Cela se fait d’une manière machinale, presque automatique. Cette conduite est différente de celle de la ville, où il devait rester constamment vigilant, sur ses gardes, les sens en éveil, inquiet sur sa gauche et sur sa droite. Il n’aimait pas conduire par les rues, les avenues, ou emprunter le boulevard de ceinture qui délimitait la banlieue de l’est. Il détestait les intersections, les carrefours, les ronds-points, les priorités. Sur l’autoroute, comme si la voiture allait toute seule, il suit le mouvement, tournant à peine le volant, sans rétrograder les vitesses. Son attention est légère, quasi flottante. En ce mois de l’année, en cette saison de jours déclinants, la circulation est moins intense. Les vacanciers n’encombrent plus les grands axes. Il n’y a presque pas d’embouteillages, presque pas de ralentissements. On peut maintenir une allure régulière, une sorte de vitesse de croisière comme les bateaux à moteur sur la mer qui ne rencontrent pas d’obstacle ou comme les navettes dans le pur espace. Le temps avance d’un pas égal, d’un mouvement circulaire sur sa droite, couvrant toute la roue des graduations de un à douze sur la petite horloge du tableau de bord ; l’espace défile au même rythme. L’aiguille du compteur reste fixée sur cent vingt kilomètres à l’heure.
Ici, l’espace et le temps se déroulent ensemble, l’un mesure l’autre avec fiabilité. Et c’est peut-être ce double mouvement, la perfection de leur rapport qui libère la pensée, qui lui ouvre un champ immense et l’accélère. Des phrases traversent sa tête. Des bribes d’histoires, des histoires brisées. Ou des souvenirs qui se télescopent. Des apparitions, des fantômes. Il voit des bouts de films, des rushes de sa vie, des promesses, des échecs, des renoncements, des rêves qui n’ont jamais été montés, ou dans un ordre différent. Tout se mélange, se superpose. Jamais il n’a eu autant d’images dans sa tête, autant d’idées, autant de fulgurances. Il devient lourd, saturé. Les mots se pressent derrière ses lèvres. Il saisit le dictaphone posé sur le siège du passager. L’appareil se déclenche au son de la voix. Il parle. Il dit une phrase qui lui traverse l’esprit, avant qu’elle ne disparaisse de son champ mental, il la répète sous plusieurs formes, cherchant la meilleure, la plus juste. Il peut suivre sa pensée à son rythme exact, sans rien en perdre, sans être freiné par le processus laborieux et lent de l’écriture. Et pendant de longues minutes, sur il ne saurait dire combien de kilomètres, jusqu’à l’irruption d’un poste de péage, il continue à voix haute, roulant à faible allure, tenant le volant de la main gauche, le dictaphone de la droite.
18:35 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : littérature, écriture, roman
jeudi, 16 août 2007
Un filigrane de souffrance
Dans l'attente du prochain Modiano, qui devrait paraître à la rentrée, je remets en ligne mon article publié dans Le Journal de la Culture sur le dernier livre de Modiano, Un pedigree.
Depuis la publication de cet article, j'ai pu vérifier l'une de mes hypothèses, la similitude des enfances malheureuses de Modiano et de Houellebecq, en découvrant dans le numéro spécial des Inrocks cette rencontre avec Michel Houellebecq : "Il avait embrayé sur sa lecture toute récente d'Un pedigree de Modiano. Il était sous le choc, frappé par la qualité de ce texte à l'os, et des ressemblances avec sa vie, de la similarité de ces faits burlesques qui ne s'inventent pas. Il m'avait dit que les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'on éprouvait d'avoir grandi avec des parents qui ne vous aiment pas, que ce n'était pas de la haine, autre chose."
______________________________________________________________________
Un filigrane de souffrance
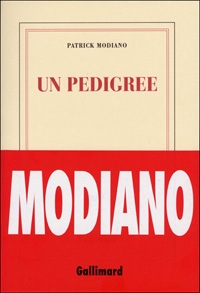 Encore un Modiano ? Oui, mais pas le énième et même roman (qui me séduit d’ailleurs chaque fois, me happant dans son mystère). Un pedigree est un morceau d'autobiographie sans fioritures, un relevé de souvenirs que le seul fil chronologique permet d’ordonner. Modiano met à jour, par un constat net et sobre, le filigrane de souffrance présent dans chacun de ses romans. Cette souffrance, c’est l’enfance, l’adolescence, cette immense période qui va jusqu’à sa majorité, les vingt-et-un ans d’alors - et qui se clôt, se résout dans l’écriture et la publication de son premier ouvrage. Devant ce gâchis, on pense à un autre auteur, Michel Houellebecq, dont Les particules élémentaires sont, à travers les vies des deux demi-frères Bruno et Michel, le récit à peine transposé d’une enfance malheureuse, loin de parents sans amour, détruite par une mère d’un égoïsme féroce.
Encore un Modiano ? Oui, mais pas le énième et même roman (qui me séduit d’ailleurs chaque fois, me happant dans son mystère). Un pedigree est un morceau d'autobiographie sans fioritures, un relevé de souvenirs que le seul fil chronologique permet d’ordonner. Modiano met à jour, par un constat net et sobre, le filigrane de souffrance présent dans chacun de ses romans. Cette souffrance, c’est l’enfance, l’adolescence, cette immense période qui va jusqu’à sa majorité, les vingt-et-un ans d’alors - et qui se clôt, se résout dans l’écriture et la publication de son premier ouvrage. Devant ce gâchis, on pense à un autre auteur, Michel Houellebecq, dont Les particules élémentaires sont, à travers les vies des deux demi-frères Bruno et Michel, le récit à peine transposé d’une enfance malheureuse, loin de parents sans amour, détruite par une mère d’un égoïsme féroce.
De la figure centrale de la mère, actrice sans gloire (quelques petits rôles au théâtre et au cinéma, la misère quotidienne entre échecs et désillusions), Modiano dresse un terrible portrait : « C’était une jolie fille au cœur sec. Son fiancé lui avait offert un chow-chow mais elle ne s’occupait pas de lui et le confiait à différentes personnes, comme elle le fera plus tard avec moi. Le chow-chow s’était suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure sur deux ou trois photos et je dois avouer qu’il me touche infiniment et que je me sens très proche de lui. »
Entre la mère et le fils, aucune relation d’amour ou de confiance ne pouvait s’établir (« Je me sentais toujours un peu sur le qui-vive en sa présence »), l’auteur ne se rappelle aucun geste de tendresse ni de protection, et n’a jamais réussi à désarmer l’agressivité et le manque de bienveillance qu’elle lui aura toujours témoignés. « Jamais je n’ai pu me confier à elle ni lui demander une aide quelconque. Parfois, comme un chien sans pedigree et qui a été un peu trop livré à lui-même, j’éprouve la tentation puérile d’écrire noir sur blanc et en détail ce qu’elle m’a fait subir, à cause de sa dureté et de son inconséquence. Je me tais. Et je lui pardonne. Tout cela est désormais si lointain… »
Le pardon à ses parents, le seul moyen d’avancer dans sa propre histoire, de se libérer du poids amer du passé. Les relations avec le père, toujours en fuite, entre deux affaires, comme en cavale, sont aussi difficiles. « Je ne lui en voulais pas et, d’ailleurs, je ne lui en ai jamais voulu. » Dans une autre vie, ou s’ils s’étaient connus plus tard, les choses auraient pu être différentes : « Il aurait été ravi que je lui parle de littérature, et moi je lui aurais posé des questions sur ses projets de haute finance et sur son passé mystérieux. Ainsi, dans une autre vie, nous marchons bras dessus, bras dessous, sans plus jamais cacher à personne nos rendez-vous. ». Dans le souvenir du romancier âgé, l’image du père est moins altérée, moins négative que celle de la mère - Patrick Modiano ayant même le regret de lui avoir envoyé une lettre ironique qui a précipité leur rupture définitive - comme si l’absence du géniteur, due en partie à une vie clandestine et aventureuse, à une vie somme toute assez romanesque, était moins violemment ressentie que la cruelle indifférence de la mère, pour laquelle il n’est qu’une chose gênante, dont elle se débarrasse chez des amis ou dans les pensionnats. Et cette famille si imparfaite n’existe pas longtemps, puisque après la naissance de leurs deux enfants, les parents se séparent, chacun vivant de son côté, entre amants et maîtresses.
« Mon père et ma mère ne se rattachent à aucun milieu bien défini. » Modiano cherche ses origines (le titre est une référence à Pedigree, l’autobiographie de Simenon), une généalogie qui a des racines dans toute l’Europe et même dans d’autres continents (la mère, Flamande, venant de Belgique ; le père, originaire de Salonique, d’une famille juive de Toscane établie dans l’empire ottoman, dispersée à Londres, Alexandrie, Milan, Budapest, Paris, le Vénézuela) ; il cherche aussi l’origine de son trouble, cette douloureuse incertitude qui est sa source d’inspiration.
Le lecteur fidèle de Modiano retrouvera le fameux épisode du 8 avril 1965, déjà évoqué dans Dora Bruder : sa mère le force à aller réclamer de l’argent à son père, qui habite dans le même immeuble, un étage au-dessus. La nouvelle femme de son père, « la fausse Mylène Demongeot », téléphone à la police. Patrick est embarqué dans le panier à salade jusqu’au commissariat, où son père l’accuse de faire du scandale et le traite de « voyou ». D’autres évènements figuraient dans les derniers romans, La petite bijou et Accident nocturne. Le séjour à Jouy-en-Josas, ou à Biarritz l’accident du garçon renversé à la sortie de l’école par une camionnette et qui se voit transporté chez les sœurs, où il découvre le vertige de l’éther qu’on applique pour l’endormir, l’éther qui aura cette propriété de lui rappeler une souffrance et de l’effacer aussitôt, sensation mêlée à jamais de la mémoire et de l’oubli. La mort du frère cadet, à peine notée car la douleur est plus forte que les mots, les longues années de pensionnat (un voisin de dortoir « sans nouvelles de ses parents depuis deux ans, comme s’ils l’avaient mis à la consigne d’une gare oubliée »), ces pensionnats religieux, d’une rigidité militaire, où il est interdit de lire Le blé en herbe de Colette ou Mme Bovary, lectures subversives, les premiers livres découverts, le désir d’écrire…
On se croirait souvent dans un roman de Modiano… l’incertitude sur les identités (le père ayant plusieurs noms et pièces d’identité, en partie pour échapper aux contrôles policiers sous l’Occupation et dissimuler sa qualité de juif, en partie pour se livrer à des trafics douteux, marché noir puis combinaisons hasardeuses avec des comparses louches, « demi-monde ou haute pègre »), litanie de noms de personnes disparues, litanie de noms de rues, individus ballottés par les courants de l’histoire et de l’émigration, incertains, troubles, rencontres de hasard comme celle de ses parents « deux papillons égarés et inconscients au milieu d’une ville sans regard », époque entre chien et loup, les rendez-vous dans les cafés au petit matin, dans la lumière crue des néons. « Les périodes de haute turbulence provoquent souvent des rencontres hasardeuses, si bien que je ne me suis jamais senti un fils légitime et encore moins un héritier. »
On a beaucoup parlé du style de Modiano, dont la grande sobriété, le retrait (une autre parenté avec Simenon) permet à l’histoire (trouée) et au décor (brumeux) de s’installer sans entrave, de prendre possession lentement mais sûrement du lecteur. Dans Un pedigree, le style est encore plus dépouillé qu’à l’ordinaire, comme pour épouser les faits, les réduire à un procès-verbal – et retenir l’émotion, la tenir à distance pour parvenir à extirper le passé douloureux, des bribes de réel. Parfois, l’auteur veut aller vite, ne pas s’arrêter, la voix se fait précipitée, car il craint de ne pas avoir le courage d’aller jusqu’au bout. Cette vie, lui semble-t-il, n’était pas la sienne. Modiano réussit à traduire cette impression, que nous avons tous connue, de vivre une vie en restant immobile, sans y avoir la moindre part de volonté, de la subir, comme si le décor et le temps défilaient derrière nous, acteurs figés devant un écran d’images en mouvement.
« A part mon frère Rudy, sa mort, je crois que rien de tout ce que je rapporterai ici ne me concerne en profondeur. Je n’ai rien à confesser ni à élucider et je n’éprouve aucun goût pour l’introspection et les examens de conscience. Au contraire, plus les choses demeuraient obscures et mystérieuses, plus je leur portais de l’intérêt. Et même, j’essayais de trouver du mystère à ce qui n’en avait aucun. » La démarche du créateur n’a rien à voir avec celle de l’analyste. Ce livre n’est pas une cure psychanalytique, une vérité dévoilée à l’auteur qui pourrait désormais – le passé véritablement décrypté et dépassé - écrire autre chose ou ne plus écrire, repartir sur d’autres bases. Modiano ne cherche pas à guérir, après 40 ans d’écriture. Il jette les mots d’une chose inépuisable, le souvenir revient, se renouvelle comme un niveau d’eau dans le sable. Ce dernier livre projette une lumière plus crue, sans l’artifice de la fiction, sur une douleur que l’écrivain n’a pas fini de vivre et d’épuiser, de transfigurer dans de nouvelles sommes romanesques.
Le génie de Modiano, c’est, tout en ressassant cette histoire personnelle, ce drame du manque d’amour, cette quête angoissée et impossible des origines, d’en faire une image de l’humanité entière, d’une condition humaine où rien n’est sûr, où rien n’est assuré.
Un pedigree, Patrick Modiano, Editions Gallimard, 12, 90 €
18:15 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, roman, modiano
vendredi, 22 juin 2007
Le passeur d'éternité, de Roland Fuentès
 (Cet article est paru dans La Presse Littéraire n° 9.)
(Cet article est paru dans La Presse Littéraire n° 9.)
Roland Fuentès est un jeune auteur qui s'est fait connaître par le prix Prométhée de la nouvelle, avec Douze mètres cubes de littérature, paru aux éditions du Rocher. Il a par ailleurs, toujours dans une veine poétique et fantastique, fait paraître trois romans, Le Musée, chez Fer de Chances, La double mémoire de David Hoog, chez A contrario (ces deux éditeurs étant malheureusement tôt disparus, et leurs livres désormais introuvables) et un savoureux petit polar humoristique, La Bresse dans les pédales, chez Nykta. Son nouvel ouvrage nous entraîne au dix-huitième siècle, dans le sud de la France.
Pendant la grande peste de 1720, Maladite, bourgeois d'Aix-en-Provence, parcourt inlassablement les chemins du pays à la recherche d'oeuvres de grands maîtres pour les sauver de la destruction et du pillage. Une nuit de tempête, alors qu'il a été recueilli et sauvé par un métayer du hameau de Mallemort, il trouve chez ce dernier une sculpture qui le fascine, réalisée par son hôte ; il la vole et s'en approprie la création. Suivent de multiples péripéties dans des villes infestées par la peste, jusqu'aux retrouvailles finales avec le métayer.
On retrouve le thème de la dépossession, que l'on a vu dans La double mémoire de David Hoog : on se souvient que dans ce précédent roman, un certain Wolf, homme récemment décédé, tentait de revivre dans Hoog en prenant possession de son esprit ; le héros perdait sa mémoire originelle et propre, remplacée par une mémoire intruse. Ici, c'est une oeuvre qui s'introduit dans l'esprit de Maladite, oeuvre de laquelle il tire sa force et son invincibilité (il traverse sans encombre et sans risque une région infestée par la peste), mais qui le mènera implacablement vers la folie.
L'une des questions taraudantes du livre est celle de la valeur de l'art, qui représente toute la vie et la raison de vivre de Maladite. La femme du métayer en a une conception qui désoriente le collectionneur : « Vous pouvez garder la tête en bois. Ce n'est qu'un morceau d'arbre mort auquel mon mari, par désoeuvrement, a voulu donner forme. Si vous l'aviez demandé nous vous aurions cédé l'objet volontiers ; vous vous seriez dispensé d'un vol et d'un départ si ingrat. » Et quel est le sort de son créateur, qui peut ne pas être à la hauteur de son oeuvre, voire inconscient de sa valeur ? « Comment ce métayer de rien du tout, ce rustre, pouvait-il mépriser le bijou enfanté de ses mains ? Etait-il possible que la valeur d'une oeuvre dépasse d'aussi loin celle de son auteur ? » Un tel don transcende les catégories sociales, se rit de la culture ou des écoles d'art : « Pour lui, le génie procédait d'une essence magique, octroyée à une petite communauté d'élus. Naïvement il avait cru seuls capables de génie les gens de sa caste, instruits dans la règle aux subtilités de l'art. » Le trafiquant d'art découvre qu'un homme du peuple peut être, comme à son corps défendant, un créateur génial.
En subtilisant et rassemblant les tableaux de sa collection, Maladite ne travaille pas pour lui, dans un but égoïste, mais pour l'art, qu'il passe aux siècles suivants ; en cela réside la clé du titre : le passeur d'éternité. « Je ne suis pas un voleur. En récupérant les tableaux chez mes clients décédés, je ne fais que reprendre en charge leur avenir. Il est périlleux d'abandonner une oeuvre au parcours hasardeux des héritages. Ce qui a du prix pour le père se révèle parfois quantité négligeable pour le fils. Or, pour traverser le temps et éclore lorsque viendra sa saison, une oeuvre doit bénéficier de fervents défenseurs à différentes époques. Si un seul maillon de la chaîne vient à sauter, l'oubli peut engloutir l'oeuvre. (...) Je rétablis une justice pour les oeuvres à l'avenir incertain. »
La solitude est le lot de cet amateur : sans famille, sans compagne, Maladite n'éprouve pas de véritable solidarité avec les autres (il refuse le concours de sa force aux paysans, ne sachant que donner un peu d'or) et ne communie qu'avec l'art. Par cette passion exclusive il perdra la raison, lorsqu'un évènement fatal viendra vider sa vie de sa substance, comme de son identité d'artiste usurpée.
Dans une prose solide et riche d'expressions savoureuses, jouant sur le décalage du temps et de la langue, avec une construction savante d'emboîtements (le récit est celui d'un marchand d'art, Jean Vayron, lequel recueille les confidences orales d'une vieille bossue aux airs de sorcière qui lui vend l'histoire, chaque version s'éloignant de l'histoire originelle introuvable comme toute vérité), Roland Fuentès conduit son lecteur jusqu'au dénouement d'une main de maître. Tout en signant un roman historique crédible, il reste fidèle à sa veine fantastique et réaffirme qu' « Une histoire est une somme de mensonges. ».
Roland Fuentès, Le passeur d'éternité, Les 400 coups éditeur. 104 pages, 11 €.
19:20 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Littérature, Culture, Roman, Fuentes






