lundi, 28 janvier 2008
Les "Mémoires" de Bernard Lavilliers
Bernard Lavilliers surpris en flagrant délit de plagiat, ce n'est pas la première fois.
Voir l'article révélateur du journal suisse Le Temps :
http://www.letemps.ch/template/culture.asp?page=10&ar...
18:05 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, chanson, lavilliers, plagiat
jeudi, 24 janvier 2008
Mercure, une nouvelle revue
Naissance d'une nouvelle revue, dirigée par Anthony Dufraisse : Mercure, les médias autrement.
(Je lui consacrerai prochainement une chronique dans La Presse Littéraire.)

Sommaire :
POSITIONS
Christian Ruby, Vladimir Bertrand : Qu’est-ce qui nous regarde ? (I)
Jacques Attali : Penser labyrinthe.
Manuel de Dieguez : Internet et la nouvelle élite mondiale.
Claude Régy : Des médias au médiat.
Didier Nordon : L’information est une désinformation.
Vangelis Athanassopoulos : Notes sur l’artiste médiatique.
SITUATIONS
Fatima Ait Bounoua : Beurettes sur le net.
Rodolphe Adam : Malaise dans l’e-culture.
Daniel Sibony : Les enfants devant la télé.
Cyril Thomas, entretien avec Agnès de Cayeux : Expériences d’intrusion.
RADIOGRAPHIE
Gil Jouanard : Radio, art de l’intime.
Olivier Pascault : Émission(s) philosophique(s), suivi de : Jaspers, Adorno, Anders... Des philosophes allemands sur les ondes.
FIGURES LIBRES
Franck Derex : Dernière édition de l’homme.
Jacques Rigaud : Monsieur l’Intran.
Christian Cottet-Emard : Souvenirs d’un localier.
Abonnement à MERCURE :
Mercure paraît quatre fois par an. Pour toute correspondance : revuemercure@free.fr
Abonnement pour 1 an (4 numéros) : 35 euros.
Abonnement de soutien : montant libre.
Prix d’un numéro : 10 euros.
Règlements à établir par chèque à l’ordre de l’Association Mercure et à adresser à Anthony Dufraisse, 14 avenue Foch, 95100 Argenteuil.
18:20 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, revue
mardi, 08 janvier 2008
Louisa Siefert (1845 – 1877)
Née à Lyon le 1er août 1845, d’un père allemand et d’une mère suisse, Louisa Siefert connut une vie brève et triste, assombrie par plusieurs déceptions amoureuses. Elle fut l’amie de Charles Asselineau, qui lui prodigua des conseils littéraires.
Œuvres publiées :
Rayons perdus, Lemerre, 1868
L’année républicaine, Lemerre, 1869
Les Stoïques, Lemerre, 1870
Les Saintes Colères, Lemerre, 1871
Ses poésies posthumes, recueillies et précédées d’une longue notice par sa mère, ont paru chez l’éditeur Fischbacher.
« Louisa Siefert a porté à sa perfection cette poésie du cœur déçu et douloureux dont Mmes Desbordes-Valmore et Blanchecotte avaient déjà su exprimer de si profonds accents. Il était réservé à cette frêle jeune fille de dire de la manière la plus juste et la plus complète ce que la femme peut souffrir par l'amour. C'est donc encore une poésie purement sentimentale que nous offre Louisa Siefert, mais l'expression de cette poésie a acquis dans ses mains une précision, une netteté, un réalisme auquel le mouvement naturaliste a beaucoup contribué. Louisa Siefert est née à Lyon en 1845. Elle fut toute sa vie maladive. La phtisie s'était attaquée de bonne heure à sa faible constitution. Comme toutes les natures frêles, comme tous les êtres voués à la terrible maladie de poitrine, elle était d'un tempérament ardent, d'un caractère fait pour aimer, d'une âme désireuse de tendresse. [...] La pauvre Louisa Siefert traîna toute sa vie la douleur toujours saignante de son amour trompé, et si ce fut un tourment pour cette nature inquiète, ce fut un bonheur pour la poésie française, qui doit à la crise passionnelle de Louisa Siefert, quelques-uns de ses plus beaux vers d'amour. »
Irène Chichmanoff, Etude critique sur les femmes poètes en France au XIXe siècle, 1910
*
Quand je pense à ma vie, un grand ennui me prend
Et j’ai pitié de voir ma jeune destinée
S’effeuiller, solitaire, année après année,
Comme une fleur des eaux qu’emporte le courant.
Je ne m’en émeus plus, ni trop ne m’en étonne,
Car je sais quels débris roulent les plus purs flots,
Et dans un même accord quels déchirants sanglots
Ils mêlent si souvent à leur chant monotone.
C’est la loi de tout être et j’y cède à mon tour,
Honteuse seulement qu’à tant de fier courage
S’offrent, toujours pareils, l’écueil et le naufrage,
Et sans comprendre mieux qu’on survive à l’amour.
Quand le vent de sa tige a détaché la fleur,
Elle suit quelque temps le torrent qui la berce ;
Sa coupe de parfums au soleil se renverse
Et la fraîcheur de l’onde avive sa couleur.
Le voyageur lassé, l’oiseau dont l’aile plie,
Demandent : Où va-t-elle ? Et l’appellent du bord,
Tandis qu’elle descend tranquille et sans effort
Vers la rive où tout meurt, dans l’ombre où tout s’oublie.
In Poésies inédites, 1881
19:49 Publié dans Anthologie de poètes lyonnais | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, lyon, siefert
samedi, 22 décembre 2007
Un homme qui dort
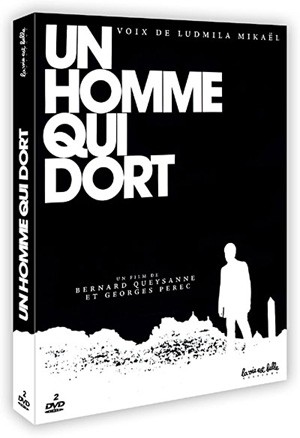 Un évènement dans le monde cinématographique et littéraire : la sortie en DVD (décembre 2007) du film de Georges Perec et Bernard Queysanne.
Un évènement dans le monde cinématographique et littéraire : la sortie en DVD (décembre 2007) du film de Georges Perec et Bernard Queysanne.
Sorti en 1974, le film Un homme qui dort obtient le prix Jean Vigo et reste six mois à l’affiche de la seule salle parisienne qui le programme. Il ressort en salles en 1990 puis est diffusé à la télévision (Arte) en 1999.
L’argument : un étudiant parisien refuse de continuer ses études et choisit de vivre au point mort, dans sa chambre minuscule. Le film est le journal précis de cette contestation radicale de la société, un voyage de l’indifférence à l’angoisse, jusqu’au retour douloureux sur la terre des vivants.
Après deux ans passés à écumer les productions, l’obtention d’une avance sur recettes minimale de 150 000 francs, et la complicité d’un ami tunisien, Noureddine Mechri, qui fournit laboratoire, montage et sonorisation, Perec et Queysane tournent en 1973 le film en noir et blanc, sans vedette (le seul acteur en est Jacques Spiesser), un défilé d’images oniriques parcouru d’une voix-off. Le texte est adapté du propre roman originel de Perec, qui présente ainsi la version filmée : « un seul personnage, aucune histoire, aucune péripétie, aucun dialogue, mais seulement un texte lu par une voix-off… »
Le coffret contient un livret du texte intégral de Perec et deux disques : sur le premier on découvre le film en version originale française avec la voix de Ludmila Mikaël, ainsi que les versions américaine, allemande et espagnole, et la bande-annonce originale. Le disque 2 offre deux documentaires de Bernard Queysanne autour de l’œuvre et de la personnalité de Perec, comprenant notamment des témoignages d’amis et de traducteurs.
Un homme qui dort, de Georges Perec et Bernard Queysanne, DVD double, éditions La vie est belle.
14:45 Publié dans Cinéma, séries, DVD, Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, cinéma, perec
mardi, 18 décembre 2007
Affaire Peter Handke : condamnation du Nouvel Obs
Puisque les grands médias n’y font guère allusion, il est bon d’en parler et d’en reparler : Le Nouvel Observateur a été jugé coupable de diffamation envers le dramaturge autrichien Peter Handke, par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 décembre 2007.
On se souvient de cette regrettable affaire, dont il a été rendu compte ici-même, par note du 4 juin 2006. A la suite d’un article tendancieux du Nouvel Obs, l’administrateur de la Comédie-Française, Marcel Bozonnet, avait déprogrammé une pièce de Handke.
Le dramaturge a poursuivi l’hebdomadaire pour « deux imputations diffamatoires, celle d’avoir une position révisionniste et celle d’approuver le massacre de Srebrenica et d’autres crimes de purification ethnique ». Sur le premier point, le tribunal a estimé que le terme de « révisionnisme » avait été utilisé dans le sens de remise en cause d’une doctrine, et donc sans lien avec les crimes condamnés par le tribunal de Nuremberg.
En revanche, la deuxième imputation est bien jugée « contraire à l’honneur ». Le tribunal a rejeté l’excuse de la bonne foi, car « la journaliste ne pouvait affirmer, sur la seule base de la présence, incontestée, de Peter Handke aux obsèques de Slobodan Milosevic, que celui-là approuvait les massacres reprochés à celui-ci ».
Satisfaction morale donc, pour Peter Handke, à défaut de réparation du tort causé par un acharnement médiatique : le Nouvel Obs est condamné au paiement d’un euro de dommages et intérêts, et des 2500 euros de frais de justice.
06:23 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, culture, théâtre, Handke
lundi, 17 décembre 2007
Trois ans déjà !

Le blog littéraire L’annexe est né le 17 décembre 2004. Pour retrouver quel était son aspect à ses débuts (du moins les fichiers textes, car la mise en page n'est pas toujours conservée), il est possible de le consulter sur Archive.org, à l'adresse suivante :
http://web.archive.org/web/20050109091051/http://nuel.hau...
Archive.org a archivé près de 86 milliards de pages, correspondant à 65 millions de sites web, en 37 langues. Sa base de données pèse près de 2 pétaoctets (non, ce n’est pas une incongruité), soit 2 millions de gigaoctets, l’équivalent de deux cents fois le contenu de la Bibliothèque du Congrès américain.
06:57 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, culture, blog
mardi, 11 décembre 2007
Dans le café de la jeunesse perdue
Un registre des êtres de passage
(Cet article est paru dans Le magazine des livres n° 7.)
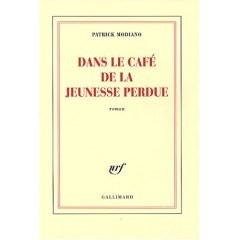 Multiple magie, toujours renouvelée, que celle de Modiano, et que l’on retrouve entière dans ce nouveau roman, « Dans le café de la jeunesse perdue ». Magie des lieux, d’abord, qui prennent possession de vous, et auxquels on ne peut échapper : « J’ai toujours cru que certains endroits sont des aimants et que vous êtes attiré vers eux si vous marchez dans leurs parages. Et cela de manière imperceptible, sans même vous en douter. Il suffit d’une rue en pente, d’un trottoir ensoleillé ou bien d’un trottoir à l’ombre. Ou bien d’une averse. Et cela vous amène là, au point précis où vous deviez échouer. Il me semble que Le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique et que si l’on faisait un calcul de probabilités le résultat l’aurait confirmé : dans un périmètre assez étendu, il était inévitable de dériver vers lui. » Le Condé est le lieu principal où passent tous les protagonistes, le lieu où s’agrègent les éléments de l’histoire. Des clients aux noms étranges, Tarzan, Babilée, Zacharias, Ali Cherif, Bob Storms, le docteur Vala hantent ce café. Certains sont étudiants, d’autres écrivains, comme Larronde et Arthur Adamov. Ils incarnent une jeunesse bohême, telle qu’elle n’existe plus vraiment aujourd’hui, ou, pour les plus âgés, ils vivent dans la nostalgie de cette jeunesse perdue et tentent de la prolonger. L’un des habitués, Bowing, note sur un cahier les noms des clients du café, les jours et heures d’arrivée, cherchant « à sauver de l’oubli les papillons qui tournent quelques instants autour d’une lampe. » Entreprise vaine, incomplète et dérisoire. C’est dans ce lieu qu’échoue Jacqueline, dite Louki, figure centrale autour de laquelle tournent les décors et les êtres. Une femme errante, qui se sauve et coupe les ponts. « Je n’étais vraiment moi-même qu’à l’instant où je m’enfuyais. Mes seuls bons souvenirs sont des souvenirs de fuite ou de fugue. » avoue-t-elle, de la même façon qu’elle avoue s’être mariée « comme on confesse un crime ».
Multiple magie, toujours renouvelée, que celle de Modiano, et que l’on retrouve entière dans ce nouveau roman, « Dans le café de la jeunesse perdue ». Magie des lieux, d’abord, qui prennent possession de vous, et auxquels on ne peut échapper : « J’ai toujours cru que certains endroits sont des aimants et que vous êtes attiré vers eux si vous marchez dans leurs parages. Et cela de manière imperceptible, sans même vous en douter. Il suffit d’une rue en pente, d’un trottoir ensoleillé ou bien d’un trottoir à l’ombre. Ou bien d’une averse. Et cela vous amène là, au point précis où vous deviez échouer. Il me semble que Le Condé, par son emplacement, avait ce pouvoir magnétique et que si l’on faisait un calcul de probabilités le résultat l’aurait confirmé : dans un périmètre assez étendu, il était inévitable de dériver vers lui. » Le Condé est le lieu principal où passent tous les protagonistes, le lieu où s’agrègent les éléments de l’histoire. Des clients aux noms étranges, Tarzan, Babilée, Zacharias, Ali Cherif, Bob Storms, le docteur Vala hantent ce café. Certains sont étudiants, d’autres écrivains, comme Larronde et Arthur Adamov. Ils incarnent une jeunesse bohême, telle qu’elle n’existe plus vraiment aujourd’hui, ou, pour les plus âgés, ils vivent dans la nostalgie de cette jeunesse perdue et tentent de la prolonger. L’un des habitués, Bowing, note sur un cahier les noms des clients du café, les jours et heures d’arrivée, cherchant « à sauver de l’oubli les papillons qui tournent quelques instants autour d’une lampe. » Entreprise vaine, incomplète et dérisoire. C’est dans ce lieu qu’échoue Jacqueline, dite Louki, figure centrale autour de laquelle tournent les décors et les êtres. Une femme errante, qui se sauve et coupe les ponts. « Je n’étais vraiment moi-même qu’à l’instant où je m’enfuyais. Mes seuls bons souvenirs sont des souvenirs de fuite ou de fugue. » avoue-t-elle, de la même façon qu’elle avoue s’être mariée « comme on confesse un crime ».
Un deuxième café, Le Canter, est le double sombre du Condé : les clients, Accad, Godinger, Mario Bay, Mocellini, sont des personnages louches, qui trafiquent ou travaillent dans des « sociétés », comme le faisait le propre père de l’auteur. Louki retrouve dans ce lieu Jeannette Gaul, « sa part d’ombre » et goûte à d’autres paradis que ceux de l’alcool, en prenant « un peu de neige ». Le livre est une dérive dans Paris, avec pour tout guide un vieux plan réparé avec du Scotch. Les rues, les établissements portent aussi des noms évocateurs ou poétiques : le Château des Brouillards, la rue des Grands-Degrés, l’Hôtel Hivernia, le commissariat des Grandes-Carrières – et la librairie Vega, point de rencontre des fidèles du conférencier Guy de Vere.
D’une construction moins linéaire que ses précédents livres, notamment Un pedigree et La petite bijou, ce roman regroupe quatre récits : celui d’un étudiant de l’Ecole supérieure des Mines attiré par la bohême et qui a envie d’abandonner ses études, celui d’un détective du nom de Caisley, celui de Louki, celui enfin du brun à veste de daim qui porte le prénom inventé de Roland et écrit un texte sur les « zones neutres » de Paris, ces quartiers aux frontières imprécises. Quatre récits pour recomposer une histoire fragmentaire, qui comme l’héroïne, garde sa part de mystère.
Modianesque à souhait, le titre « Dans le café de la jeunesse perdue » est en fait emprunté à un texte de Guy Debord, que Modiano définit au passage comme un « philosophe sentimental ». Le roman est traversé de livres, ou plutôt de titres d’ouvrages de science-fiction, de spiritualité ou d’ésotérisme aux noms étranges : Horizons perdus, Cristal qui songe, Voyage dans l’infini, Louise du Néant. Les personnages sont proches de ce néant, semblables à ces individus disparus depuis 30 ans et que l’on déclare absents par le biais des « déclarations d’absence » dans les publications judiciaires. Ils sont condamnés ou prédestinés à mal finir et échouent, parfois volontairement comme le détective Caisley payé pour rechercher Louki disparue : quand il la retrouve, il décide de ne rien dire à son commanditaire, d’enterrer son enquête, pour laisser à la jeune femme « le temps de se mettre définitivement hors d’atteinte ».
Quelques mots, quelques phrases, et la magie Modiano se déploie et prend le lecteur dans ses rets. On a beau se défendre, on est toujours gagné par cette mélancolie violente et feutrée, celle de la fuite des jours, la fuite de la jeunesse, la dispersion des êtres, l’effacement irréversible de nos traces dont seuls quelques mots froids et nus comme ceux d’un procès-verbal témoignent encore. Ou encore ces renseignements purement factuels qu’enregistre le détective, « ces détails qui sont souvent les seuls à témoigner du passage d’un vivant sur la terre. A condition qu’on retrouve un jour le carnet à spirale où quelqu’un les a notés d’une toute petite écriture difficilement lisible, comme la mienne. » Sur le terrain vague de la vie, les hommes cherchent à s’accrocher à des points de repère. La constante de Modiano, c’est cette attention aux êtres de passage, et la tentative de les fixer, comme sur une photographie. Il redonne vie fugacement aux absents, aux tricheurs, aux créatures en demi-teinte du doute et de l’échec, à ceux qui en traversant la vie n’étaient déjà que des ombres.
Patrick Modiano, Dans le café de la jeunesse perdue, éditions Gallimard, 14, 50 €.
19:56 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, écriture, roman, modiano






