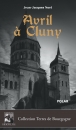vendredi, 16 juin 2006
Casse, dix ans déjà...
Bientôt dix ans que la revue Casse a cessé sa parution, puisque son dernier numéro (21) date de décembre 1996. Elle n’aura duré que quatre ans. Pour ce presque anniversaire, j’ouvre un nouveau blog, le premier billet étant un article de Marc Autret, paru dans Ecrire & Editer n° 7 (janvier 1997), qui analysait de manière lucide et précise les raisons de l’arrêt de la publication :
http://casse.hautetfort.com/
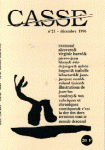 Casse a publié principalement des nouvelles et des textes courts et s'est montrée particulièrement ouverte aux jeunes auteurs, organisant de plus chaque année un concours de poésie, bientôt remplacé par un concours de nouvelles. Elle a contribué à révéler certains auteurs qui ont fait leur chemin depuis. Riche de chroniques, de critiques et d'informations, elle s'est illustrée par son franc-parler et sa liberté de ton (notamment par les éditoriaux parfois saignants d'Edith O !).
Casse a publié principalement des nouvelles et des textes courts et s'est montrée particulièrement ouverte aux jeunes auteurs, organisant de plus chaque année un concours de poésie, bientôt remplacé par un concours de nouvelles. Elle a contribué à révéler certains auteurs qui ont fait leur chemin depuis. Riche de chroniques, de critiques et d'informations, elle s'est illustrée par son franc-parler et sa liberté de ton (notamment par les éditoriaux parfois saignants d'Edith O !).
Au cours de ses quatre ans d'existence, la revue Casse a publié les auteurs suivants : Raymond Alcovère, Jacques Allemand, Bernard Amblard, Catherine André, Dominique Angel, Jean Atlan, Gilles Bailly, Pierre Barachant, Frédéric Baron, Virginie Barré, Jean-Christophe Belleveaux, Jean Bensimon, Emmanuel Berland, Marc Bernelas, Maryline Bizeul, Pierre-Jean Blazy, Joëlle Brethes, Jean-Pierre Brisset, Eric Brogniet, Carino Bucciarelli, Georges Cathalo, Jean-Jacques Celly, Fabrice Chaplin, Guy Chaty, Jean Chaudier, Georges Chich, Patrick Chouissa, Marie-Josée Christien, Hélène Codjo, Dominique Combaud, Jean-Gabriel Cosculluela, Mireille Coulomb, Roland Counard, Jean-René Dallevard, Olivier Decker, Christian Degoutte, Eric Dejaeger, Cédric Demangeot, Rafael Jose Diaz, Paule Domenech, Monique Duclos Lacheux, David Dumortier, Michel Dunand, Anaïs Escot, Christiane Escot, Jean-Louis Faivre, Patricia Ferlin, Bluma Finkelstein, Patrice Follenfant, Michel Fraisse, Marc Fresneda, Dominique Froloff, Pascale Genevey, Danielle Grondein, Gaspard Hons, Sylvie Huguet, Antoinette Jaume, Josyane de Jésus-Bergey, Zohra Karim, Bernard Kieken, Max Laire, Philippe Landry, Isabelle Lebastard, Michel Leydier, Béatrice Libert, Gabriel Le Gal, Hervé Lesage, Anne Letoré, Driss Louiz, Jean-Luc Lourmière, Jean-Louis Massot, Maximine, Jean-Albert Mazaud, Hervé Merlot, Hervé Mestron, Marie-Jo Molinier, Marie Motay, Odile Namy-Méline, Jean-Jacques Nuel, Armand Olivennes, Stéphane Padovani, Evelyne Parisse, Madeleine Rambaud, Goretti Ramirez, Geneviève Raphanel, Philippe-André Raynaud, Gilbert Renouf, André Rochedy, André Romus, Tristan Sautier, Jacques Simonomis, Joséphin Soulary, Peggy Inès Sultan, Alain Tchungui, Roland Tixier, Françoise Valencien, Marie-Claire Verdure, Nicole Vidal-Chich, Denis Winter.
Illustrations de Michèle Cirès-Brigand, Jean-Luc Coudray, Hubert Francillard, Jacques Lelièvre, Nicolas Nuel.
Des nouvelles, des poèmes, des chroniques et articles parus dans la revue papier seront progressivement mis en ligne dans la partie Archives de ce weblog ; des inédits seront également publiés, permettant à la revue Casse de renaître sous une nouvelle forme.
*
Le blog littéraire L’Annexe offre désormais une newsletter. Je vous invite à vous inscrire (en haut, à gauche), pour être tenus régulièrement informés de son actualité.
06:00 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Littérature
mardi, 06 juin 2006
Revue de détail n° 4
Cette chronique a été publiée dans La presse Littéraire n° 5.
SARRAZINE n° 8 bis
 Pour ce numéro SENS, la belle revue littéraire Sarrazine a décidé de revenir au plomb, retour aux sources du livre pour le toucher, la vue, l’odorat… La réalisation en a été confiée à M. Huin, ancien imprimeur de Max Jacob. Pourquoi le numéro 8 bis ? Comme l’indiquent les membres du comité de rédaction, C.F. Tourné, Paul de Brancion et Gilles Aufray : « la graphie du chiffre 9 ne nous plaisait pas et nous avons tant ergoté sur le sujet qu’à notre grande stupeur et par erreur nous avons laissé imprimer un 8 sur la couverture. Nous l’avons flanqué d’un bis rouge. »
Pour ce numéro SENS, la belle revue littéraire Sarrazine a décidé de revenir au plomb, retour aux sources du livre pour le toucher, la vue, l’odorat… La réalisation en a été confiée à M. Huin, ancien imprimeur de Max Jacob. Pourquoi le numéro 8 bis ? Comme l’indiquent les membres du comité de rédaction, C.F. Tourné, Paul de Brancion et Gilles Aufray : « la graphie du chiffre 9 ne nous plaisait pas et nous avons tant ergoté sur le sujet qu’à notre grande stupeur et par erreur nous avons laissé imprimer un 8 sur la couverture. Nous l’avons flanqué d’un bis rouge. »
Comme à l’habitude, Sarrazine a demandé à des écrivains, des artistes, des philosophes, de s’exprimer autour du mot choisi. Et SENS pose d’emblée des interrogations essentielles. Considérant que ce millénaire commence dans une très importante « perte d’individuation » qui conduit irrémédiablement au vide, les responsables de la revue gardent néanmoins un bel optimisme : « Nous faisons l’hypothèse que l’art et, singulièrement ici, la littérature, la poésie et l’écriture sont de nature à conduire à une aurore boréale. »
Les auteurs de cette livraison nous emmènent dans le passé aussi bien que dans le présent, et – le sens étant signification et direction - en des lieux différents de la planète. Un chef indien écrit au président des Etats-Unis d’Amérique. Des textes de l’Antiquité dialoguent : le Cantique des cantiques, le cycle du papyrus Harris 500, chant d’amour de l’Egypte antique (« Ma raison n’a guère de complaisance à l’égard de l’amour que j’ai pour toi/ Mon petit chacal qui suscite le plaisir/ Ton ivresse je ne peux y renoncer/ Dussé-je être traînée et frappée pour vivre en proscrite »). L’anthropologue Léa Hiram nous décrit la genèse des sens chez les Inuits de l’Arctique canadien. Lucien Suel, décidément très en forme, nous régale de sa suite de proses « Le combat insensé de Oui-Oui contre Docteur No », tandis qu’Alain Laraby montre un sens de l’humour très britannique. Blaise Pascal fait en 1648 l’expérience sur « l’équilibre des liqueurs », et conclut que la nature n’a pas horreur du vide. De beaux poèmes d’Emmanuelle Favier et d’Armelle Leclercq voisinent avec les photos de Patrice Bouvier.
La grande découverte de ce numéro se trouve dans les extraits publiés de l’admirable Journal de Mireille Havet, « Aller droit à l’enfer par le chemin même qui le fait oublier », édité par Claire Paulhan. Mireille Havet, morte en 1932 à 33 ans, fut l’amie de Paul Fort, Guillaume Apollinaire, Colette, Natalie Barney et Jean Cocteau qui favorisèrent la publication de ses poèmes, mais nul d’entre eux ne connaissait l’existence de son journal âpre et lucide, où elle décrivait sa vie de damnation et son goût singulier pour les femmes et les stupéfiants. « Je suis seule et j’appelle au secours. Personne ne peut rien pour personne. Cette main qui prend la mienne est mensonge. Les morts seuls tiennent leur parole en ne revenant jamais. »
Sarrazine illustre à merveille ce que doit être la revue littéraire, un bel objet, rare (dans le temps comme dans le nombre), original et chargé de sens. L’écrin d’une parole réelle et pleine qui aurait une chance de perdurer comme ce chant d’amour écrit et psalmodié il y a plus de trois millénaires sur les bords du Nil.
Sarrazine, AICLA, 3 rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye. 134 pages, 12 €. sarrazine@club-internet.fr
Diffusion en librairies : Les Belles Lettres
LA BARBACANE n° 85/86
Il serait temps de saluer cette « revue des pierres et des hommes » qui entame au rythme imperturbable des saisons sa 42e année, sous la conduite de son fondateur Max Pons. Deux fois par an, paraît dans l’indifférence de la critique cette revue à l’ancienne, sur beau papier, alliant qualité typographique et exigence littéraire, dans un amour de la tradition et de la belle œuvre. Elle constitue une anthologie permanente de la poésie contemporaine, sans s’interdire de publier des nouvelles à l’occasion. Ce numéro double et exceptionnel « Pour saluer Charles Minetti » est un devoir de mémoire et de fidélité, rendu par Max Pons à celui qui lui était, outre un compagnon de route et de poésie, un « frère siamois en amitié ». Des témoignages de Victor Varjac, Jacques Simonelli complètent ce portrait de Charles Minetti, écrivain et peintre, présent dans ce numéro par des photos et des poèmes, dont ses derniers vers : « Car nous sommes encore à naître/ Un peu plus loin que le langage/ Qui nous enferme dans ses mots. » La revue, publiée avec le concours de la région Aquitaine, n’affiche pas de prix unitaire sur sa couverture, mais l’abonnement à 4 numéros est de 30 € sur Rivoli, et de 45 € sur Arches.
La Barbacane, Bonaguil, B.P. 47, 47500 Fumel. 64 pages.
EUROPE n° 923, mars 2006.
La revue littéraire mensuelle Europe a fait l’objet d’une longue chronique dans notre dernière recension à propos de son numéro spécial sur Marguerite Duras. Il convient de signaler ce nouveau numéro exceptionnel consacré à Franz Kafka, coordonné par Françoise Rétif. De nombreuses études, et en introduction, des fragments, aphorismes et notules de l’auteur du Château : « Il y a un but, mais pas de chemin : ce que nous appelons chemin est atermoiement. » Une exigence absolue, c’est ce qui ressort de cette œuvre qui ne laisse jamais en repos le lecteur : « Un livre doit être la hache qui fend la mer gelée en nous. »
Europe, 4 rue Marie-Rose, 75014 Paris. 380 pages, 18, 50 €. www.europe-revue.info
07:55 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 04 juin 2006
L'affaire Handke, suite et pas fin
Sur le site du Stalker, un article signé Jean-Gérard Lapacherie, revient sur l’affaire Peter Handke, l’affaire de trop, celle qui nous révèle que sous ses dehors « cools, libérés et libertaires », notre époque est dominée, encadrée par une police de la pensée, exercée par quelques bonnes âmes bien-pensantes postées dans les médias ou les institutions culturelles, jouant un rôle de véritables commissaires politiques. Situant cette affaire dans le droit fil de la Bêtise éternelle et triomphante, il précise : « Au milieu du XIXe siècle, elle se nommait Homais, Pécuchet, Prud’homme, Bouvard, Perrichon ou Bécassine. Aujourd’hui, elle a pour noms Bozonnet Marcel, Daniel Jean, les journaleux du Nouvel Obs. Baudelaire et Flaubert aujourd’hui se nomment Peter Handke. »
Et Lapacherie de donner des éléments pour poursuivre le travail d’épuration :
« Puisque le Marcel et son bréviaire ont décidé de purifier l’art et la culture, indiquons-leur des pistes. Molière était un intime de Louis XIV. Louis XIV a fait mettre à feu et à sang le Palatinat. Que Molière ne soit plus joué à la Comédie-Française. Musset était un affreux réactionnaire. Que ses pièces soient interdites ! Mme Duras a écrit un ouvrage à la gloire de l’empire colonial, avant de travailler pour les services d’Abetz, puis de faire le procureur dans les procès de la Libération (elle a obtenu la tête d’un pauvre type), puis d’entrer au service de la propagande de Staline. Que jamais ses pièces ne soient jouées à la Comédie-Française. »
Le Stalker donne également l’adresse d’une pétition pour « la dépénalisation de la pensée » et pour exiger que la pièce de Handke soit jouée.
Signalons sur le même sujet un article de Matthieu Baumier, paru le mois dernier dans Le Figaro :
http://www.lefigaro.fr/debats/20060518.FIG000000173_affai...
06:00 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 02 juin 2006
La Revue mode d'emploi, premières critiques
Sur le blog de Christian Cottet-Emard :
http://cottetemard.hautetfort.com/archive/2006/05/30/la-revue-mode-d’emploi.html
Sur le blog de Roland Fuentès :
http://rolandfuentes.hautetfort.com/archive/2006/04/14/la-revue-mode-d-emploi.html
Des articles sont également parus dans Livre & lire n° 215 (revue de l’ARALD) et dans Inédit Nouveau n° 203.
13:05 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 20 mai 2006
L'autoroute (dans Microbe 35)
L’allure est douce, régulière, comme on aimerait que soit la vie, une eau calme, au courant continu, maîtrisé, un cours d’eau sans ruptures, sans accidents, sans rapides. L’autoroute se déploie, infini ruban recommencé, réserve inépuisable de kilomètres, circuit d’errance où il oublie la marche et le reste du monde. Elle est devenue son milieu naturel. L’immense ramification n’a pas de point de départ ni d’arrivée, ni d’origine ni de fin, seulement des milliers de points d’entrée et de sortie, des milliers de points intermédiaires. La conduite est facile, les voies se déroulent devant lui, droites ou en courbes larges et relevées, entre les glissières de sécurité.
Il roule. Il tourne dans l’enclos, il tourne dans l’enceinte, dans cet écheveau de centaines de milliers de kilomètres. Parfois il passe une frontière, il le sait à des signes, aux couleurs de la signalisation, au changement de langue sur les panneaux. Le plus souvent il se retrouve en Espagne. Comme si la voiture était attirée vers le bas, par son propre poids, ou la pente du globe, un mouvement vers le sud, vers la lumière, vers la chaleur, vers la fusion. Il ne domine rien. Il n’est plus rien que le jouet du vent, du temps, un véhicule obéissant à une volonté supérieure. Une voiture héliotrope tournant sa fleur de métal vers l’aigu de la lumière.
*
Ce petit texte, extrait d’un roman en cours d’écriture, vient de paraître dans le numéro 35 de la revue Microbe. Cette livraison sur le thème « Ministoires de voyages », pilotée par Pascale Arguedas, regroupe des textes courts de Pascale Arguedas, Jean-Christophe Belleveaux, Bernard Collet, Francis Dannemark, Xavier Deutsch, Eduardo Gallarza, Yves Gerbal, Denis Grozdanovitch, Claude Guimin, Jean-Paul Husson, Chantal Pelletier, Claude Pujade-Renaud, Marc Rousselet, Marc Trillard, Christine Van-Acker, Martine Vercruysse et Jean-Michel Verdugo.
Microbe qui, comme son nom l’indique, joue dans la catégorie poids plume des revues littéraires, est animée par Eric Dejaeger et Paul Guiot.
08:30 Publié dans Textes et nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 16 mai 2006
Revue de détail n° 3
EUROPE n° 921-922, janvier-février 2006.
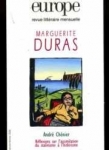 Les grands esprits se rencontreraient-ils ? La presse Littéraire et Europe publient au même moment un numéro spécial consacré à Marguerite Duras. Pour Europe, Duras figure désormais au panthéon des écrivains majeurs, et ce numéro prend des allures d’hommage. Si l’introduction d’Evelyne Grossman et Emmanuelle Touati commence par répertorier toutes les critiques faites du vivant de l’écrivain : « Que lui reprochait-on ? Pêle-mêle : une œuvre absconse réservée à quelques initiés, une œuvre cédant à la facilité, séduisant le grand public, produite trop vite, répétitive, le succès inattendu et planétaire de L’Amant, des jugements aussi péremptoires qu’intempestifs, des prises de position politiques plus viscérales que construites, un contentement de soi complaisamment exhibé, un sentimentalisme exacerbé qu’on ne pardonne plus qu’aux adolescentes, le personnage de pythie médiatique qu’elle jouait à la fin de sa vie : insupportable, indécente. », c’est en définitive pour dédouaner Duras de tous ses défauts : « ce masque protecteur d’un ego hypertrophié, cette statue d’elle-même qu’elle édifia de son vivant n’étaient que l’envers de la dépersonnalisation que nécessitait pour elle l’acte d’écrire ».
Les grands esprits se rencontreraient-ils ? La presse Littéraire et Europe publient au même moment un numéro spécial consacré à Marguerite Duras. Pour Europe, Duras figure désormais au panthéon des écrivains majeurs, et ce numéro prend des allures d’hommage. Si l’introduction d’Evelyne Grossman et Emmanuelle Touati commence par répertorier toutes les critiques faites du vivant de l’écrivain : « Que lui reprochait-on ? Pêle-mêle : une œuvre absconse réservée à quelques initiés, une œuvre cédant à la facilité, séduisant le grand public, produite trop vite, répétitive, le succès inattendu et planétaire de L’Amant, des jugements aussi péremptoires qu’intempestifs, des prises de position politiques plus viscérales que construites, un contentement de soi complaisamment exhibé, un sentimentalisme exacerbé qu’on ne pardonne plus qu’aux adolescentes, le personnage de pythie médiatique qu’elle jouait à la fin de sa vie : insupportable, indécente. », c’est en définitive pour dédouaner Duras de tous ses défauts : « ce masque protecteur d’un ego hypertrophié, cette statue d’elle-même qu’elle édifia de son vivant n’étaient que l’envers de la dépersonnalisation que nécessitait pour elle l’acte d’écrire ».
Comme d’ordinaire, la revue Europe livre un dossier fourni, introduit par un beau témoignage du metteur en scène Jacques Lassalle, suivi par des études universitaires, de nombreux articles dont plusieurs s’intéressent au cinéma durassien, et un entretien avec Paul Otchakovsky-Laurens, qui fut l’un des derniers éditeurs. Une somme imposante, montrant la complexité de l’œuvre et de la personne, le trouble de la source de l’écriture que Duras elle-même qualifie d’une belle formule : « l’ombre interne que chacun porte en soi et qui ne peut sortir, s’écouler au dehors, que par le langage ». On apprend beaucoup sur cette œuvre brillante, subtile mais parfois complaisante.
L’autre temps fort de ce numéro est un article « Réflexions sur l’assimilation du stalinisme à l’hitlérisme » par François-Xavier Coquin, professeur honoraire au Collège de France. Récusant l’assimilation des deux régimes totalitaires, s’opposant à Hannah Arendt et à sa condamnation conjointe des deux régimes qui auraient, selon elle, « banalisé le mal », Coquin veut démontrer que malgré leurs ressemblances apparentes, ces deux systèmes politiques diffèrent par leur nature et leurs intentions. Mais l’enfer, on le sait, est pavé de bonnes intentions, et, si cet article est une critique intéressante de notre démocratie occidentale dont il relativise les mérites, et une juste réhabilitation du peuple russe, il se révèle aussi, comme en creux, d’une indulgence gênante envers le stalinisme, passant sous silence les millions de morts et les crimes communistes.
Europe, fondée sous l’égide de Romain Rolland, et qui compta parmi ses animateurs Louis Aragon, Jean Cassou, Paul Eluard, Elsa Triolet, Jean Guéhenno, a récemment passé le cap de son 80e anniversaire. Depuis sa fondation en 1923, elle a publié plus de 900 numéros. Une version numérisée, interrogeable en texte intégral, des numéros parus de 1923 à 2000 est désormais disponible sur DVD - une grande première dans l'édition numérique - au prix de 130 € (abonné à la revue) ou 180 € (particulier non abonné). Un évènement dans l’histoire des revues littéraires.
Europe, 4 rue Marie-Rose, 75014 Paris. 380 pages, 18, 50 €. www.europe-revue.info
HAUTEURS n° 17 et 18
 La dernière livraison de cette revue trimestrielle, sous-titrée « revue littéraire du Nord et d’ailleurs », animée par Gilbert Millet et Rozsa Tatar, s’intitule « Le goût du péché ». Elle regroupe des études, des pages de grands auteurs du passé et les textes des lauréats d’un concours de nouvelles organisé par la revue sur ce même thème. « Ce n’est pas sous un angle chrétien que nous avons choisi d’aborder le péché mais sous celui, plus pervers peut-être, plus réjouissant sans doute, du plaisir », confesse Gilbert Millet, qui avoue ne pas être porté au mysticisme. On pourra n’être pas entièrement d’accord avec son analyse, assez conventionnelle, et qui condamnant le manichéisme traditionnel en pose un autre : celui qui opposerait « libertinage intelligence lumière et Renaissance » à « religion mystique ténèbres et Moyen Age », alors que la réalité est bien plus nuancée et que la spiritualité peut faire alliance avec l’intelligence ou l’érotisme (Bataille), mais on a plaisir à relire quelques classiques de la littérature dans ce numéro.
La dernière livraison de cette revue trimestrielle, sous-titrée « revue littéraire du Nord et d’ailleurs », animée par Gilbert Millet et Rozsa Tatar, s’intitule « Le goût du péché ». Elle regroupe des études, des pages de grands auteurs du passé et les textes des lauréats d’un concours de nouvelles organisé par la revue sur ce même thème. « Ce n’est pas sous un angle chrétien que nous avons choisi d’aborder le péché mais sous celui, plus pervers peut-être, plus réjouissant sans doute, du plaisir », confesse Gilbert Millet, qui avoue ne pas être porté au mysticisme. On pourra n’être pas entièrement d’accord avec son analyse, assez conventionnelle, et qui condamnant le manichéisme traditionnel en pose un autre : celui qui opposerait « libertinage intelligence lumière et Renaissance » à « religion mystique ténèbres et Moyen Age », alors que la réalité est bien plus nuancée et que la spiritualité peut faire alliance avec l’intelligence ou l’érotisme (Bataille), mais on a plaisir à relire quelques classiques de la littérature dans ce numéro.
 Hauteurs nous donne donc à lire, à côté de jeunes nouvellistes (dans un souci qu’il faut saluer de mêler écrivains consacrés et auteurs à découvrir), des extraits connus ou moins connus de notre histoire littéraire, signés Rabelais, Saint-Evremond, Restif de la Bretonne, Antoine Houdar de la Motte, et un formidable fragment des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Dommage que parmi un choix de proses de libertins ne figure pas le meilleur d’entre eux, Crébillon fils, dont Les égarements du cœur et de l’esprit ou La nuit et le moment sont des chefs d’œuvre trop méconnus.
Hauteurs nous donne donc à lire, à côté de jeunes nouvellistes (dans un souci qu’il faut saluer de mêler écrivains consacrés et auteurs à découvrir), des extraits connus ou moins connus de notre histoire littéraire, signés Rabelais, Saint-Evremond, Restif de la Bretonne, Antoine Houdar de la Motte, et un formidable fragment des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Dommage que parmi un choix de proses de libertins ne figure pas le meilleur d’entre eux, Crébillon fils, dont Les égarements du cœur et de l’esprit ou La nuit et le moment sont des chefs d’œuvre trop méconnus.
Le numéro précédent, « De la fantasy au fantastique », contient une riche anthologie d’auteurs de tous horizons, William Morris, Robert Howard, Johan Heliot, Nancy Kress, Michael Marshall Smith. Denis Labbé nous propose cette définition claire des genres : « Si les mots fantaisie et fantastique ont la même étymologie, comme fantôme ou fantasme, ils apparaissent comme des genres littéraires différents. En effet, la fantasy est le genre du surnaturel accepté, tandis que le fantastique est le genre du surnaturel en rupture. Dans le premier, les personnages voient des manifestations merveilleuses sans en être pour le moins intrigués, puisqu’elles sont dans l’ordre des choses à l’intérieur d’un univers merveilleux, alors que dans le second, les personnages sont heurtés par ces apparitions qui les dérangent, les inquiètent voire les épouvantent. »
Depuis l’origine, la revue est abondamment illustrée, et notamment par Patrick Meric, Alain Valet, et l’excellente Rozsa Tatar. Elle se révèle un lieu d’accueil pour les nouvelles plumes, d’auteurs ou de dessinateurs. Hauteurs, sans perdre le Nord, a su s’ouvrir à d’autres horizons et à des thèmes universels et prépare un numéro sur la francophonie.
Hauteurs, 61 avenue de Liège, 59300 Valenciennes. 142 pages, 10 €. www.hauteurs.fr
19:05 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 04 mai 2006
Handke, la censure
Dans Le Monde, un article signalé d'Anne Weber, dénonçant la censure exercée en France par les bien-pensants, et dont la dernière victime est Peter Handke :
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-767768@...
Oui, il faut déprogrammer Marcel Bozonnet de la Comédie-Française.
*
Voir aussi Libération :
http://www.liberation.fr/page.php?Article=379495
et Le Figaro :
http://www.lefigaro.fr/culture/20060504.FIG000000162_pete...
13:10 Publié dans Annexes et dépendances | Lien permanent | Commentaires (7)