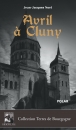lundi, 29 janvier 2018
La malédiction de l'Hôtel-Dieu (2e extrait)
Après avoir reproduit le premier chapitre de ce polar lyonnais dans une note précédente, je livre ici un 2e extrait (chapitre 18).
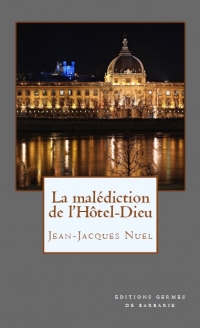 (Le détective privé Brice Noval accompagne le maire Gaspard Loison, avec son directeur de cabinet Marchini, pour l'inauguration du Conseil régional. Le dispositif de sécurité a été renforcé autour du maire, qui fait l'objet de menaces de mort.)
(Le détective privé Brice Noval accompagne le maire Gaspard Loison, avec son directeur de cabinet Marchini, pour l'inauguration du Conseil régional. Le dispositif de sécurité a été renforcé autour du maire, qui fait l'objet de menaces de mort.)
Loison avait tenu à ce que je l’accompagne pendant son trajet en voiture de la mairie jusqu’au Conseil régional. Son directeur de cabinet m’avait prévenu par téléphone que le maire aurait une proposition à me faire. Sans autre précision. Je les rejoignis donc dans la cour de l’Hôtel de ville au matin du lundi 25 avril. Le soleil brillait dans un ciel sans nuage. Marchini voulut y voir un bon présage.
Loison m’invita à monter à l’arrière de la Peugeot 508 et s’installa entre moi et son directeur de cabinet. Le chauffeur et un agent de sécurité prenaient place à l’avant.
- Voyez-vous, Brice Noval, commença le maire, je ne me laisserai pas impressionner. La vie doit continuer. Et la ville a besoin de moi.
Si à l’entendre la ville avait besoin de lui, je me dis que lui avait encore plus besoin de la ville. Il l’avait servie, mais s’était servi d’elle.
- Je ne changerai pas mes habitudes d’un iota. C’est la meilleure réponse à la terreur que ce malade cherche à provoquer.
Derrière le discours de façade, je ne le sentais pas aussi rassuré qu’il voulait le paraître. Il avait besoin de protection, et j’étais l’une des pièces de son arsenal défensif. En quelque sorte, il m’avait recruté comme garde du corps. Certes, cela me faisait une drôle d’impression de devenir l’allié objectif d’un homme que j’avais combattu, en tentant d’arrêter les exécuteurs de la malédiction. Mais si depuis mes débuts dans la profession j’avais dû trier mes clients sur leurs qualités humaines et ne retenir que des personnes honnêtes, probes et sympathiques, je n’aurais pas traité beaucoup d’affaires.
La voiture avait rejoint le quai du Rhône et suivait le sens du fleuve vers le confluent. Le maire parlait sans me regarder, mais son discours ne s’adressait qu’à moi, les autres n’étant que des comparses.
- On me reproche d’avoir des projets ambitieux pour Lyon, de construire, de bâtir. Mais pour construire, il faut d’abord détruire. Démolir une partie de l’ancien pour édifier du nouveau. Je vais de l’avant, je regarde l’avenir, en tout cas. Mes ennemis critiquent tout, et ne sont animés que par l’envie, l’amertume et le dénigrement. Prenez garde, Brice Noval, de ne pas finir comme ces vieux conservateurs. Vous valez mieux.
Si je comprenais bien, Loison me jugeait réactionnaire. Mais ce terme péjoratif était pour moi un titre de gloire. Comment ne pas être en réaction contre un monde qui ne tourne pas rond ?
- Vous êtes un homme de valeur, reprit Loison, et je voulais vous faire une proposition. Que diriez-vous de vous présenter sur ma liste aux prochaines élections municipales (en position éligible, bien sûr), et de devenir mon futur adjoint à la culture ? Je sais que le patrimoine, l’art, le théâtre, la littérature comptent beaucoup pour vous.
Adjoint à la culture ? J’eus une pensée émue pour André Mure, un journaliste lyonnais et fin connaisseur de notre gastronomie, mort en 2007, que j’avais souvent rencontré et apprécié. Il avait occupé ce poste avec brio sous un autre maire. Mais il était hors de question pour moi de travailler avec ce lascar de Loison. Proposer une place – y compris à ses adversaires, en vertu du principe qu’il vaut mieux les avoir avec soi que contre soi – était sa manière d’acheter les gens. Il ne le faisait pas avec de l’argent, ne détournant pas apparemment de fonds publics, mais en distribuant des miettes de pouvoir. Il savait vous rendre dépendant et redevable.
Je ne lui fis pas cependant part de mon refus sur le champ, lui répondant seulement qu’il me faudrait réfléchir à son offre. Le lieu et le moment étaient mal choisis pour en parler.
- Oui, nous en reparlerons, mon cher Noval. Et puisque nous en sommes sur ce chapitre de la culture, avez-vous eu le temps d’aller au spectacle ces derniers jours ?
Je lui racontai ma soirée au Théâtre de poche de la rue du Bœuf. J’imaginai que le maire pouvait être intéressé par Maurice Scève à double titre. C’était d’abord un Lyonnais célèbre, un génie de la littérature. Sur la fresque des Lyonnais, peinte sur un mur du quai Saint Vincent, il est représenté, papier et plume en mains, en compagnie de Louise Labé. Et les Scève avaient exercé au seizième siècle des fonctions municipales : le père du poète avait été échevin et juge mage ; le poète lui-même avait réglé les festivités somptueuses lors de l’entrée royale de Henri II et de Catherine de Médicis à Lyon en 1548, ainsi que les fêtes données précédemment lorsque François Ier était passé dans notre ville. Mais le maire m’écoutait d’une oreille distraite, il s’intéressait probablement moins au passé qu’à l’avenir. Et je le sentais surtout inquiet du présent.
Nous étions arrivés cours Charlemagne. Une cohorte d’officiels et de journalistes encadrés par des policiers se tenait devant l’entrée du Conseil régional. Les curieux étaient aussi nombreux, massés derrière des barrières métalliques ; maintenant que la menace pesait directement sur le maire, chacune de ses rares sorties devenait une sorte d’attraction à haut risque.
Alors que nous descendions tous de voiture, je remarquai un fourgon blanc décoré d’un logo bleu, garé de l’autre côté de la voie ; sa porte arrière s’ouvrit, et un homme revêtu d’une combinaison blanche de peintre en sortit, nous tournant le dos. Soudain il se retourna et je vis briller dans le soleil une mitraillette. Je n’eus que le temps de saisir Loison par les épaules et de le plaquer au sol tandis que retentissaient les détonations en rafale.
J’entendis un claquement de portière, un véhicule qui démarrait dans un rugissement de moteur et un crissement de pneus, une clameur nous recouvrir. Alors seulement je ressentis une douleur cuisante à la main droite : j’avais dû me fouler le pouce en me jetant à terre.
On se précipita sur nous pour nous relever. Loison était choqué mais sain et sauf. Son directeur de cabinet n’avait pas eu autant de chance. L’ancien sous-préfet gisait immobile sur le trottoir, dans une flaque de sang, le corps criblé de balles. Christian Marchini ne connaîtrait plus le moindre avancement.
Il s’était mis en disponibilité pour l’éternité.
L’agent de sécurité, touché lui aussi par la rafale et tombé à terre, respirait encore. On le transporta aussitôt à l’hôpital avec d’autres personnes plus légèrement blessés. Les policiers fébriles déployèrent un périmètre de sécurité sur toute la zone. J’entendis un officiel annoncer à la meute des journalistes que la cérémonie d’inauguration était annulée.
20:51 Publié dans Livre, Mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la malediction de l'hôtel-dieu, nuel, noval, germes de barbarie, polar, lyon
mercredi, 17 janvier 2018
Quelque part, n'importe où... de Lydie Jaillon

12 nouvelles sur le thème de la rencontre qui « laisse toujours en l'esprit une empreinte colorée, aussi minime soit-elle».
Une écriture simple, précise, très maîtrisée, pour dire les rêves puissants de vies minuscules. Un agent de bureau qui s'offre une étoile, une femme dans l'abribus qui regarde passer tous les jours à la même heure l'homme qu'elle aime, un vendeur d'aspirateurs qui se prend pour un conquérant, un homme qui fuit son passé dans une autre ville, un pianiste qui dépasse enfin la technique pour rejoindre l'émotion... L'humour est aussi très présent, comme dans cette nouvelle où un soutien-gorge est emporté par le vent, suscitant désirs et disputes.
Rencontre souvent rêvée, car bien des personnages de ce livre vivent dans une grande solitude et n'ont pu réaliser leurs rêves, comme cette Raymonde Joliet qui ferme ce beau recueil, une pensionnaire de la maison de retraite que l'on croit démente et qui a gagné « le droit de jouir désormais de cette seule liberté de rêver »
06:52 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lydie jaillon, quelque part n'importe où, nouvelles
samedi, 13 janvier 2018
La malédiction de l'Hôtel-Dieu
Après deux années sans publication, je verrai paraître deux de mes ouvrages en 2018.
En juin sortira "Journal d'un mégalo" (aux éditions belges Cactus Inébranlable), un recueil d'aphorismes humoristiques dont certains avaient été publiés dans le magazine Fluide Glacial.
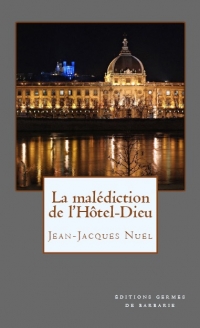 En attendant, vient de paraître "La malédiction de l'Hôtel-Dieu", un polar qui se passe à Lyon, entre la mairie et la préfecture, dans le cadre du projet de reconversion de l'Hôtel-Dieu. Un projet qui vise à transformer ce qui fut à l'origine un hôpital des pauvres en hôtel pour les riches.
En attendant, vient de paraître "La malédiction de l'Hôtel-Dieu", un polar qui se passe à Lyon, entre la mairie et la préfecture, dans le cadre du projet de reconversion de l'Hôtel-Dieu. Un projet qui vise à transformer ce qui fut à l'origine un hôpital des pauvres en hôtel pour les riches.
Vous trouverez ci-dessous un lien vers la page de présentation et de vente de l'ouvrage :
La malédiction de l'Hôtel-Dieu
L'éditeur de ce roman utilisant les outils de publication d'Amazon, l'ouvrage n'est vendu que sur Amazon.
(Les personnes qui voudraient que je leur envoie directement un exemplaire peuvent me contacter par messagerie.)
Début du roman :
1.
- Je crois que vous ne m’aimez pas beaucoup, Brice Noval…
- Je pense que la réciproque est vraie, monsieur le Maire !
Sans se laisser désarçonner par ma réplique, ou sans en rien laisser paraître, Gaspard Loison se fendit alors de son fameux sourire de faux cul, celui-là même qu’il arborait sur ses affiches électorales et pour son plus grand profit, car à chaque scrutin municipal il était confortablement réélu. Il terminait sa troisième mandature à la tête de la ville de Lyon. Le bougre avait trouvé la martingale gagnante : une étiquette de centre gauche, une politique de centre droit, et un discours truffé de ce charabia à la mode : développement durable, éco-responsable, citoyenneté, bio-diversité, vivre ensemble, mode doux de déplacement, métissage culturel et autres sornettes qui constituent le nouveau catéchisme de ce début de vingt et unième siècle.
À ce point de notre dialogue, assis en face de lui dans son superbe bureau dont les larges fenêtres donnaient sur une cour intérieure, je ne savais toujours pas pourquoi le maire m’avait invité à venir le voir à l’Hôtel de ville. En quoi avait-il besoin de mes services de détective privé ? Une filature de son épouse ? Un constat d'adultère ? Une enquête discrète sur un opposant politique ?
Le maire prit un visage grave, cala ses avant-bras sur son sous-main en cuir et me regarda droit dans les yeux. Son crâne, encore plus dégarni que le mien, luisait sous la lumière d’un lustre de cristal.
- Brice Noval, j’ai besoin de votre aide dans l’affaire de l’Hôtel-Dieu.
J’adore entendre prononcer mon nom, cela décuple ma sensation d’exister. Gaspard Loison devait connaître ce point faible de ma personnalité. Ce n’était cependant pas une raison de s’emballer.
- Je ne comprends pas, lui dis-je. Toute la police est déjà sur l’affaire.
Ses mains grassouillettes quittèrent son bureau et se levèrent, doigts écartés, comme pour signifier un geste d’impuissance.
- La police nationale fait de son mieux. La police municipale prête main forte. Mais l’enquête piétine. Les coupables courent toujours et s’apprêtent à frapper à nouveau. Vous seul êtes capable de résoudre cette série de crimes.
Il n’avait pas son pareil pour flatter son prochain. Loison n’était pas devenu le premier magistrat de cette ville pour rien.
- L’affaire est peut-être un peu lourde pour un pauvre privé solitaire, objectai-je. Quatre meurtres en quatre semaines ! Et à supposer que j’aie les capacités de m’en occuper - bien que je ne sois pas Sherlock Holmes - pourquoi devrais-je m’y intéresser ? J’ai déjà plein d’enquêtes en cours.
Sur ce dernier point, j’exagérais beaucoup. J’étais plutôt au chômage partiel et l’argent commençait à manquer. Les quittances et les factures s’accumulaient. Le loyer de mon bureau rue des Cuirassiers venait d’être fâcheusement revalorisé. Mais je voulais mesurer jusqu’à quel point le maire désirait s’assurer mes services.
- L’Hôtel-Dieu est le lieu de votre naissance, n’est-ce pas ? lâcha Loison en reprenant son sourire de faux cul.
Gaspard était bien renseigné. Un atout important dans le poste qu’il occupait. Un de mes profs au lycée m’avait déjà dit : « Le savoir c’est le pouvoir. » J’étais effectivement né dans cette maternité de la presqu’île, au cœur de la cité, un certain 14 juillet qui remontait à plus d’un demi-siècle. Le maire savait ce qu’il voulait et utilisait tous les arguments imaginables pour parvenir à ses fins. Derrière ce personnage tout en rondeur, aux airs patelins, se cachait une volonté de fer.
C’est ainsi que cet homme retors avait fini par m’avoir au sentiment et que j’avais accepté cette enquête – laquelle avait tout de la mission impossible. Je dois avouer aussi que la prime importante qu’il me promettait avait vaincu mes dernières réticences.
J’avais pourtant des raisons d’en vouloir à Loison et à sa politique immobilière inconsidérée. Je n’appréciais pas ses entreprises pharaoniques, dont la construction du Grand Stade et le réaménagement de l’Hôtel-Dieu, opérations contre lesquelles j’avais pris position publiquement en signant des pétitions et en publiant des articles dans des journaux locaux. Le dernier de ses projets semblait se retourner contre lui. En voulant transformer l’hôpital de l’Hôtel-Dieu en hôtel de luxe, il avait attiré la malédiction de Childebert.
Lien pour se procurer l'ouvrage
07:59 Publié dans Livre, Mes publications | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nuel, la malediction de l'hôtel-dieu, hôtel-dieu de lyon, germes de barbarie, brice noval
jeudi, 19 janvier 2017
Passage d'encres, dernières parutions
Les éditions Passage d'encres, animées par Christiane Tricoit, ont eu une intense production en 2016. Pas moins de 7 ouvrages sont parus, 6 d'entre eux dans la collection Trait Court.
Deux plaquettes ont particulièrement retenu mon attention.
9 h 50 à l'Hôtel-Dieu, de Guillaume Decourt
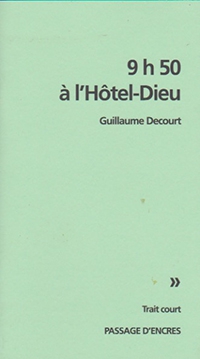 Pianiste classique, l'auteur partage son temps entre Paris et Athènes, après avoir passé son enfance en Israël, en Allemagne et en Belgique, son adolescence dans les monts du Forez, puis séjourné longuement à Mayotte et en Nouvelle Calédonie. Cette errance, ces éléments biographiques se retrouvent dans sa poésie, qui en reprend le récit désordonné. Mais Decourt n'est pas l'un de ces poètes actuels qui racontent leur vie prosaïquement en allant à la ligne, sans rythme et sans musicalité, en mauvais disciples de Bukowski. Il emprunte la forme classique du dizain (la forme privilégiée d'antiques poètes comme Maurice Scève), rimé avec souplesse. Les nombreux enjambements donnent du rythme au poème.
Pianiste classique, l'auteur partage son temps entre Paris et Athènes, après avoir passé son enfance en Israël, en Allemagne et en Belgique, son adolescence dans les monts du Forez, puis séjourné longuement à Mayotte et en Nouvelle Calédonie. Cette errance, ces éléments biographiques se retrouvent dans sa poésie, qui en reprend le récit désordonné. Mais Decourt n'est pas l'un de ces poètes actuels qui racontent leur vie prosaïquement en allant à la ligne, sans rythme et sans musicalité, en mauvais disciples de Bukowski. Il emprunte la forme classique du dizain (la forme privilégiée d'antiques poètes comme Maurice Scève), rimé avec souplesse. Les nombreux enjambements donnent du rythme au poème.
L'ensemble de 35 dizains forme une suite subtile évoquant surtout la vie sentimentale de l'auteur, le cœur partagé entre la Grecque aimée et la Brésilienne amante, hésitant à « troquer l'Attique pour l'Amazonie ».
Mais qui se soucie du pauvre Decourt
Qui a rompu malgré lui ses amours
En deux donne ses baisers par à-coups
Rhizome, de Christophe Stolowicki
 Rhizome : « tige souterraine des plantes vivaces qui porte des racines adventives et des tiges feuillées aériennes », précise le dictionnaire. Ce terme définit les brèves de Stolowicki, ni aphorismes, ni maximes. Ces phrases, ces paragraphes d'une écriture dense, « brèves sans humour à l'encontre du genre » partent dans tous les sens, s'enrichissant de plusieurs sens. Des saillies, un bouquet d'éclairs d'intelligence et de lucidité. Stolowicki possède une vaste culture qui n'est pas celle d'un cuistre, mais d'un vrai amoureux du jazz, de la peinture et de la littérature. Il admire les grands aînés (Baudelaire, Celan, Flaubert, Gombrowicz...), critique certains égarements : « René Char n’a aucune idée de la saleté de Heidegger », dénonce les fausses gloires et les faiseurs. « N'est pas Pascal qui veut. » « Il se survit comme Rimbaud qui aurait réussi dans la vie. »
Rhizome : « tige souterraine des plantes vivaces qui porte des racines adventives et des tiges feuillées aériennes », précise le dictionnaire. Ce terme définit les brèves de Stolowicki, ni aphorismes, ni maximes. Ces phrases, ces paragraphes d'une écriture dense, « brèves sans humour à l'encontre du genre » partent dans tous les sens, s'enrichissant de plusieurs sens. Des saillies, un bouquet d'éclairs d'intelligence et de lucidité. Stolowicki possède une vaste culture qui n'est pas celle d'un cuistre, mais d'un vrai amoureux du jazz, de la peinture et de la littérature. Il admire les grands aînés (Baudelaire, Celan, Flaubert, Gombrowicz...), critique certains égarements : « René Char n’a aucune idée de la saleté de Heidegger », dénonce les fausses gloires et les faiseurs. « N'est pas Pascal qui veut. » « Il se survit comme Rimbaud qui aurait réussi dans la vie. »
Brillants, parfois énigmatiques, ces fragments sont décapants et nous incitent à remettre en question bien des vérités établies.
Citons les autres ouvrages reçus :
Fiction : la portée non mesurée de la parole, 7 essais par Pierre Drogi ;
Grand Stade, de Hélios Sabaté Beriain ;
Ka ninda, l'écho, de Marc Tamet ;
Somniloquie, de Piero Salzarulo ;
Écrire malgré nous, de Geneviève Huttin.
Passage d'encres, Moulin de Quilio, 56310 Guern
http://www.inks-passagedencres.fr/
08:18 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : passage d'encres, stolowicki, decourt
mercredi, 18 janvier 2017
Les moments littéraires n° 37
 Le dernier numéro de la revue de l'écrit intime Les moments littéraires est consacré à Marie-Hélène Lafon.
Le dernier numéro de la revue de l'écrit intime Les moments littéraires est consacré à Marie-Hélène Lafon.
Depuis son premier roman Le soir du chien jusqu'à Histoires, Marie-Hélène Lafon, née en 1962 dans le Cantal (un de « ces départements de la diagonale du vide que constitue le Massif Central ») inscrit son œuvre dans le thème de la ruralité et des figures silencieuses qui la peuplent. Dans un entretien avec Gilbert Moreau, elle se présente comme une transfuge sociale, d'abord par le professorat (l'agrégation de grammaire, un doctorat de lettres) puis par l'écriture et la carrière littéraire qui lui permettent de s'extraire du milieu paysan. C'est ce déplacement, à la fois géographique, social, culturel (et même généalogique, en se choisissant comme pères d'écriture Pierre Michon, Pierre Bergougnoux et Richard Millet) qu'analyse Mathieu Riboulet dans son article introducteur.
Marie-Hélène Lafon fait sortir du silence ces gens du Cantal qu'elle a connus, ces « vies minuscules » : « Il s'agirait d'inscrire une trace de ces vies qui semblent sans relief particulier, qui ne paraissent en rien notoires ou notables et qui en même temps sont inépuisables. Le texte leur fait écrin, leur fait royaume, leur fait honneur sans les livrer en pâture à la condescendance du lectorat, sans les humilier encore davantage. Je tente de donner à ces Minuscules une place au royaume du verbe. » Suivent quelques inédits de l'auteur, « Moments d'été ».
Signalons aussi au sommaire de la revue un texte nostalgique de Georges-Olivier Chateaureynaud, qui évoque sa jeunesse au Quartier Latin. Une jeunesse passionnée, obsédée de littérature, éclairée de rencontres. Vivre dans le quartier si littéraire de Saint-Germain des Prés est le rêve de bien des auteurs.
Les moments littéraires, BP 90986, 75829 Paris cedex 17. 12 €. Abonnement 22 €.
http://www.lesmomentslitteraires.fr/
07:46 Publié dans Revues littéraires | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : les moments littéraires, marie-hélène lafon
vendredi, 15 juillet 2016
Prairie Journal, de Christian Cottet-Emard
Les éditions Orage-Lagune-Express, en sommeil depuis quelques années, viennent de renaître avec la publication de deux ouvrages, dont le journal de Christian Cottet-Emard.
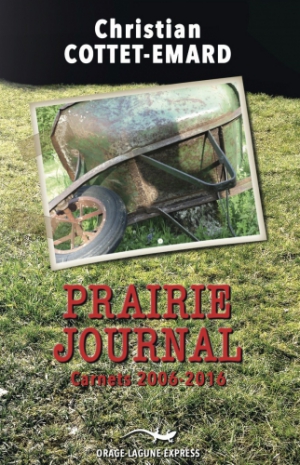 Plus de 400 pages de carnets rassemblées, un choix de textes qui ont pour la plupart précédemment paru sur le blog de l’auteur. « En 2005, à quarante-six ans, un homme se détournait de tout engagement social et professionnel. À l’horizon de sa prairie, il tient désormais un journal depuis une décennie. »
Plus de 400 pages de carnets rassemblées, un choix de textes qui ont pour la plupart précédemment paru sur le blog de l’auteur. « En 2005, à quarante-six ans, un homme se détournait de tout engagement social et professionnel. À l’horizon de sa prairie, il tient désormais un journal depuis une décennie. »
La prairie est bien présente dans cet ouvrage, car l’auteur vit à la campagne, dans le Jura. Observateur amoureux de la nature, du cycle éternel des saisons et de leurs infimes variations, il décrit avec autant de précision que de poésie son proche environnement, la forêt, les animaux, dont le renard et les sangliers qui viennent rôder devant sa maison, les arbres, les oiseaux, la neige, les fleurs et jusqu’à « l’éclosion des anémones pulsatiles dans la cendre noire des premiers écobuages ».
Prairie Journal est le titre d’une œuvre musicale d’Aaron Copland. Un hommage que l’auteur rend à l’un de ses compositeurs favoris. La musique tient une grande place dans sa vie. De longues heures se passent à écouter Edward Elgar, William Walton, Bach, Rachmaninov, Rimsky-Korsakov, Prokofiev, Tchaïkovski… et à lire de grands auteurs, dont Pessoa.
Les souvenirs sont très présents, dont ceux relatifs à l’enfance, à l’école primaire, pas toujours heureux, à la maison familiale aujourd’hui vendue. Mais l’auteur a trop de pudeur pour que ce soit un journal intime exhibitionniste et suffisamment de recul sur soi pour ne pas se prendre pour le centre du monde. Au fil de ces chroniques du temps qui passe, d'une belle écriture, on apprend bien des choses sur l’édition, le journalisme, la littérature, Lisbonne, le Portugal et le cigare (dont l’art de l’allumer sans en noircir la cape délicate !)
« Écrire un journal, c’est suivre sa route en gardant un œil dans le rétroviseur. » Si la nostalgie et la mélancolie sont largement présentes, l’humour traverse parfois ces carnets, dans la veine d’un précédent recueil de l’auteur, Tu écris toujours ? Ainsi quand Cottet-Emard, grand amateur de musique classique, apprend que l’on distribue des boules Quiès à l’entrée de certains concerts de rock ou de rap aujourd’hui :
« Dans ma grande naïveté, je croyais qu’il s’agissait d’une blague. Pas du tout. « Chérie, passe-moi les boules Quiès, je vais au concert. » Version arts plastiques : « Chérie, où sont mes lunettes noires ? Je vais à l’expo Soulages. » Ce monde est fou : « Chérie, je sors. Tu n’as pas vu mon entonnoir ? » (…) En tout cas, on ne pourra pas dire qu’on n’aura pas vibré, comme les vitres des riverains ! »
Christian Cottet-Emard a choisi de se tenir « au bord du monde », sur la marge, qu’il juge comme la place qui lui convient le mieux. Celle d’un témoin privilégié. « Je mesure le luxe extraordinaire qui m’est donné de pouvoir dire cela et j’en remercie je ne sais qui car je n’ai malheureusement pas la foi mais je remercie quand même car je n’aime pas l’ingratitude. »
Prairie Journal (Carnets 2006-2016), de Christian Cottet-Emard, éditions Orage-Lagune-Express
07:10 | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : prairie journal, christian cottet-emard, orage-lagune-express
mercredi, 13 juillet 2016
Écrit parlé, de Philippe Jaffeux
 J’ai évoqué plusieurs fois sur ce blog l’œuvre originale et extrême de Philippe Jaffeux. Cette dernière petite plaquette, publiée par l’éditrice du massif Alphabet, est un entretien avec Béatrice Machet. Est-ce une suite, un prolongement de l’œuvre, ou un simple dialogue où un auteur explicite sa recherche ? Jaffeux veut le classer à part, en témoignent les dernières lignes : « je te remercie pour la qualité de tes questions mais, d’une certaine façon, je réprouve cet entretien dans la crainte que mon discours sur mes livres risquerait de prévaloir sur leur contenu ».
J’ai évoqué plusieurs fois sur ce blog l’œuvre originale et extrême de Philippe Jaffeux. Cette dernière petite plaquette, publiée par l’éditrice du massif Alphabet, est un entretien avec Béatrice Machet. Est-ce une suite, un prolongement de l’œuvre, ou un simple dialogue où un auteur explicite sa recherche ? Jaffeux veut le classer à part, en témoignent les dernières lignes : « je te remercie pour la qualité de tes questions mais, d’une certaine façon, je réprouve cet entretien dans la crainte que mon discours sur mes livres risquerait de prévaloir sur leur contenu ».
Les critiques ont beaucoup parlé des instruments de Jaffeux (l’ordinateur, le dictaphone, le logiciel de reconnaissance vocale) qui ont bouleversé son rapport à l’écriture. De sa volonté de réunir l’écrit et l’oral, comme de dépasser ou de réconcilier les contraires. De son formalisme créateur. Ils ont moins parlé des liens entre son œuvre et la spiritualité, sur lesquels Béatrice Machet lui pose une série de questions.
Bien qu’il s’en défende en partie (« ma méthode se rapproche peut-être furtivement d’une expérience mystique »), la démarche de Jaffeux m’a toujours paru relever d’une démarche spirituelle et mystique. Ses références, d’abord : « Les écrits taoïstes m’ont permis de retrouver mon électricité intérieure », la kabbale, l’hindouisme, etc. L’effacement de son ego dans l’immensité des possibles : « Les mots trouvent leur place suite à une dissolution de ma personne, qui est alors en connexion avec le chaos autant qu’avec le cosmos, entendus l’un et l’autre comme les deux seules mesures de toute chose. Dans le meilleur des cas, la disparition du sujet révèle enfin un vide divin, indéterminé et impersonnel à l’image de la forme utilisée pour l’approcher ».
« Dans l’idéal, il serait préférable que je n’entende pas ni ne comprenne ce que j’écris afin de rejoindre la dimension universelle d’une vacuité extatique, d’un style abstrait, d’un épanouissement dans une absurdité tragique et presque naturelle. Il ne s’agirait alors plus seulement de questionner l’écriture au moyen de l’écriture mais d’essayer de dépasser le mental, la compréhension ou la pensée pour créer dans une joie ineffable ».
L’artiste idéal selon Jaffeux ne ressemblerait-il pas à Jean-Sébastien Bach ?
Écrit parlé, de Philippe Jaffeux, aux éditions Passage d’encres (collection Trait court).
http://www.inks-passagedencres.fr/
11:29 Publié dans Lectures | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : jaffeux, écrit parlé, passage d'encres